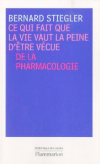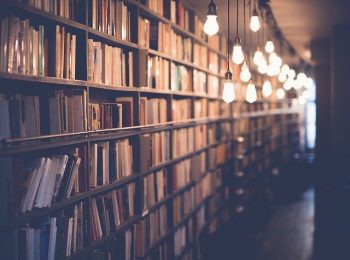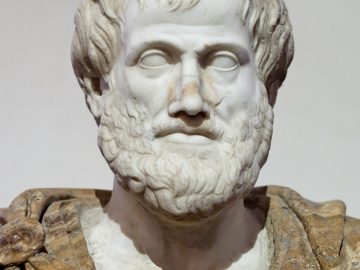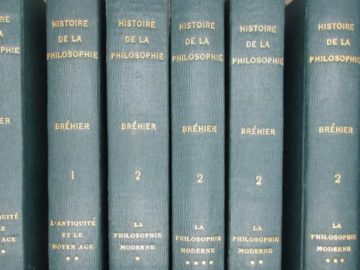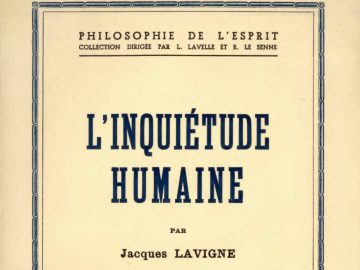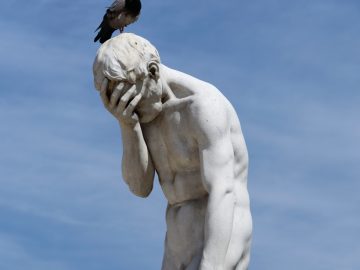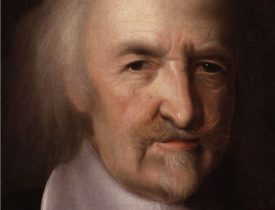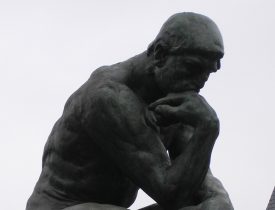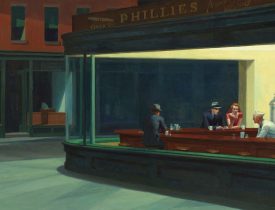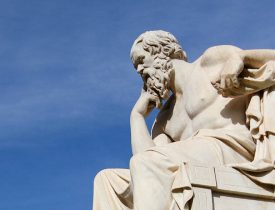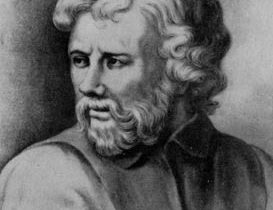«La pensée ne se saisit pas d'abord comme pensée, pour ensuite s'ouvrir à ce qui n'est pas elle. La pensée est toujours-déjà échappée sur le…
Bernard Stiegler, «Ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. De la pharmacologie», Flammarion, 2010. Extrait du compte-rendu d’actu-philosophia : «L’ouvrage de…