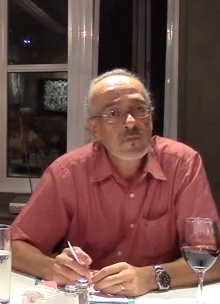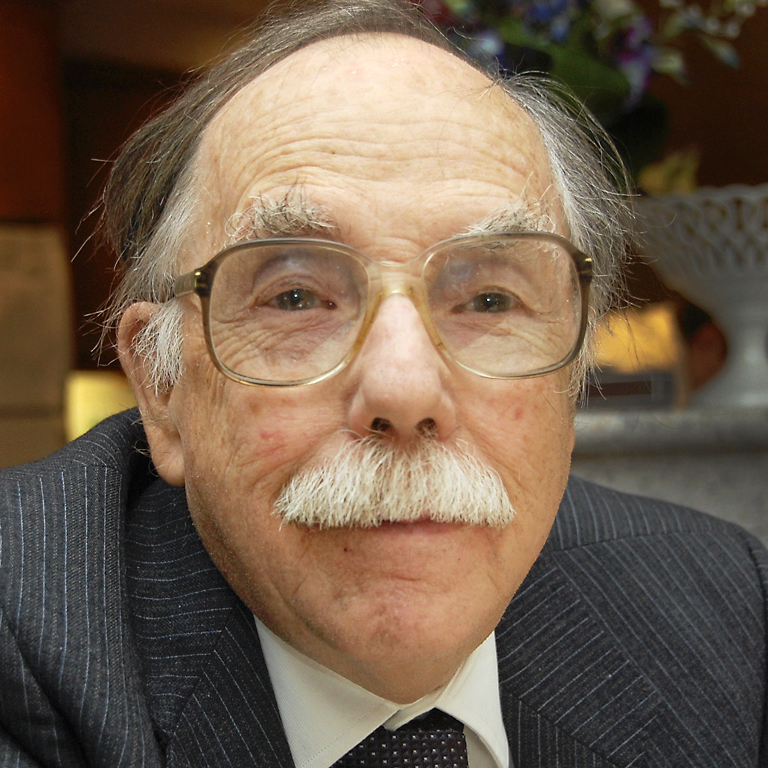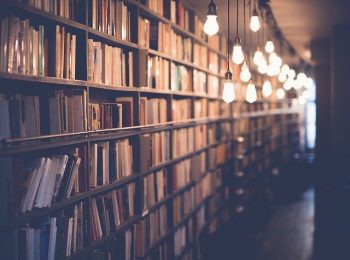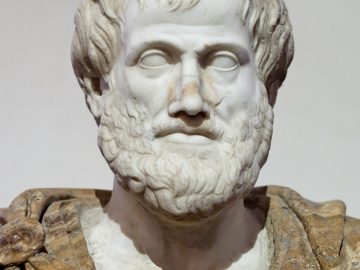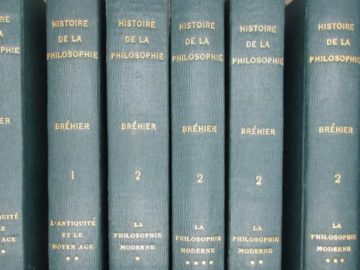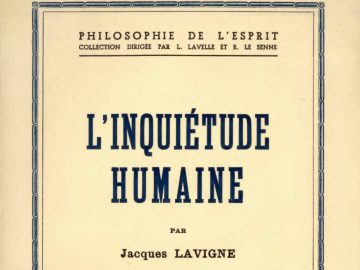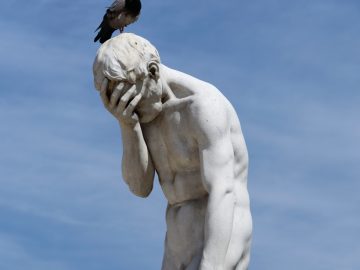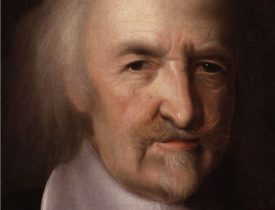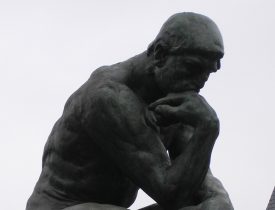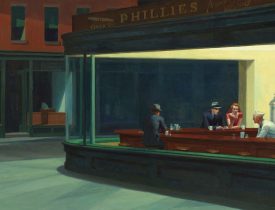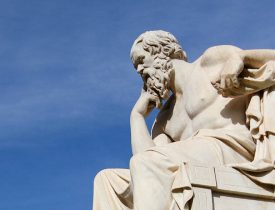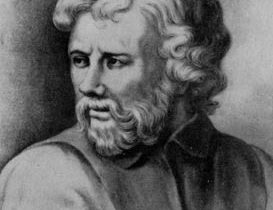Le 23 août 2019 est décédé à l`âge de 92 ans et 7 mois au Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) de Trois-Rivières, le philosophe…
Le 7 juin 2019 est décédé à la Maison Albatros de Trois-Rivières à l`âge de 65 ans le philosophe québécois Yvon Corbeil. Né en 1954,…
Le vendredi 23 août 2019 est décédé Marcel Gaudet, qui fut le tout premier coordonnateur du département de Philosophie de notre institution, lors de la…
Le 19 juin 2018 est décédé d`un arrêt cardiaque à l`âge de 91 ans dans un hôpital de Boston (Massachusetts), le philosophe américain Stanley Cavell.…
Le 8 avril 2019, est décédé à l’âge de 90 ans, après 68 ans de vie religieuse, le philosophe québécois Julien Naud, s.j. Ce dernier…
Le 20 octobre 2018 est décédé au CIUSSS MCQ-CHAUR de Trois-Rivières suite à un accident de voiture survenu le 11 octobre dernier à l`âge de…
Le 28 juillet 2018 est décédé paisiblement à l`âge de 90 ans au CHUM à Montréal, le philosophe québécois Marc Renault. Il a enseigné pendant…
Le 11 juin 2018 est décédé à l`âge de 75 ans à l`hôpital de La Jolla, à San Diego, en Californie (États-Unis), le philosophe et…
Le 25 janvier 2018 est décédé à la suite d`une longue maladie, le Père montfortain Aurèle Daoust, s.m.m. à l`âge de 88 ans à la…
Le 13 février 2018 est décédé subitement à l`âge de 73 ans, le philosophe québécois Claude Paris. Repères biographiques Claude Paris naît le…
Le 25 octobre 2017 est décédé à Richelieu à l`âge de 85 ans le philosophe québécois Léonce Paquet, omi. De retour au Canada, après un…
Le 24 août 2016 est décédé à l`âge de 96 ans, le philosophe et épistémologue français Gilles-Gaston Granger. Ses obsèques par crémation se sont déroulées…
Le 7 août 2016 est décédé à Montréal à l`âge de 95 ans, le philosophe québécois Yvon Blanchard. Il fut professeur titulaire à la Faculté…
Le 27 juin 2016 est décédé à Los Angeles, en Californie, à l`âge de 87 ans, l`écrivain, sociologue et futurologue américain Alvin Toffler. Après…
Le 31 mai 2016 est décédée la religieuse Ghislaine Roquet, c.s.c. à l`âge de 90 ans, au Pavillon Saint-Joseph (l'infirmerie des Sœurs de Sainte-Croix) situé dans l`arrondissement…