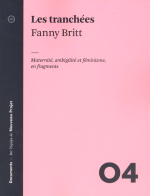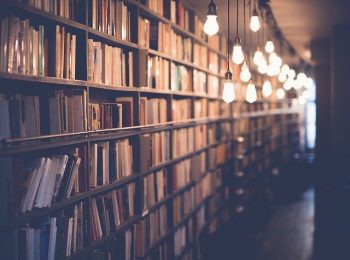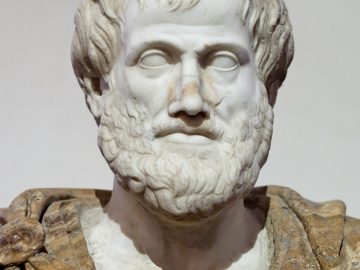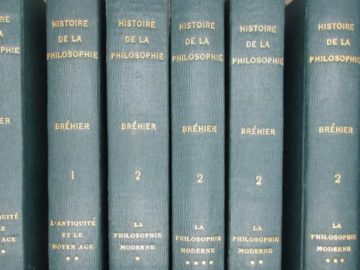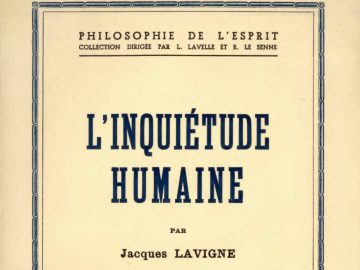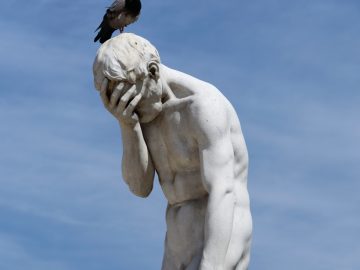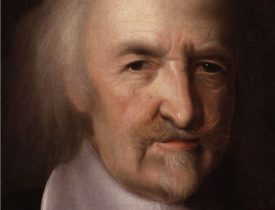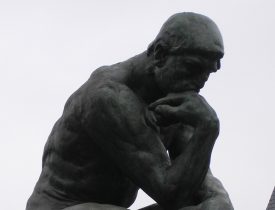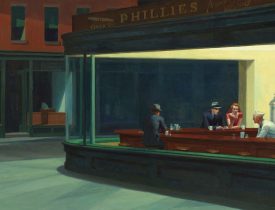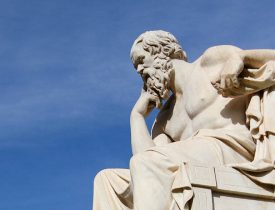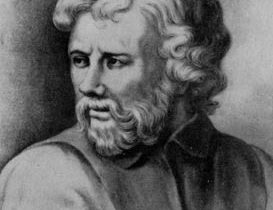Le 29 avril 2019 à 20h00 a eu lieu au Cinéma Le Tapis rouge à Trois-Rivières, la représentation théâtrale du texte Lettre aux escrocs de…
« D'hier à aujourd'hui, du nomadisme au féminisme, la force des femmes autochtones résonne toujours! » Le mercredi 9 mars, dans le cadre…
NDLR : L’article qui suit de notre collègue et amie Natacha Giroux a d’abord été publié dans «Le Devoir de philo» du 8 mars 2014, à…
Écrit librement, presque à la manière du collage ou du blogue, on aimera ou décrochera du style de ce livre. Mais il n’en demeure…
Le Magazine littéraire, no. 471 (janvier 2008), 98p. [8.10$] Dossier « Simone de Beauvoir, la passion de la liberté » Coordonné par Perrine Simon-Nahum, le…
Citation : «La génération MLF discute toujours son héritage. [...]» - Aude Lancelin, La deuxième vie du «Deuxième Sexe» BIBLIOOBS | 02.01.2008
Citation : «Avant-gardiste et radicale, vénérée et contestée, admirable et parfois détestable, Simone de Beauvoir a bouleversé des générations de femmes à travers le monde.…
Dominique Chabrol Agence France-Presse Paris Simone de Beauvoir, icône féministe, engagée dans tous les combats intellectuels du XXe siècle, aurait eu cent ans le 9…