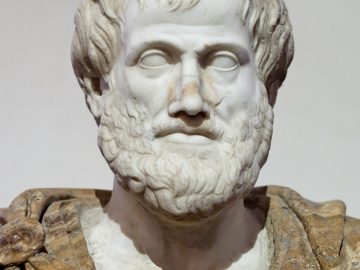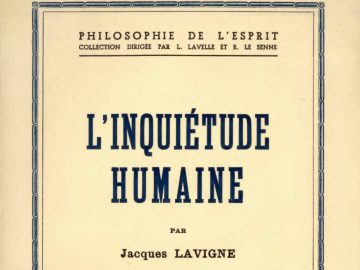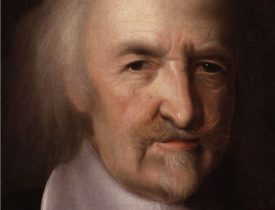«À partir de quel moment les dieux se sont-ils retirés du monde, à partir de quel moment les images ont-elles perdu leur couleur? À partir de quel moment le monde s’est-il vidé de sa substance, à partir de quel moment les signes n’ont-ils plus été des signes, à partir de quel moment il y a eu la rupture tragique, à partir de quel moment avons-nous été abandonnés à nous-mêmes, c’est-à-dire: à partir de quel moment les dieux n’ont-ils plus voulu de nous comme spectateurs, comme participants? Nous avons été abandonnés à nous-mêmes, à notre solitude, à notre peur, et le problème est né. Qu’est-ce que le monde? Qui sommes-nous?»
Eugène Ionesco

La prochaine Philoconférence aura lieu le lundi 19 novembre à l’église St-James de Trois-Rivières (située dans l’arrondissement historique de la ville).
Monsieur Serge Cantin, professeur de philosophie à l’UQTR, nous entretiendra de L’avenir de la culture dans un monde désenchanté.
Le lecteur retrouvera dans la seconde page de ce billet un texte du professeur Cantin, Le paradoxe de la Modernité et l’avenir de la culture. Ce texte permettra d’apprécier les idées, le style et la rigueur de notre conférencier. Nul doute que le propos du philosophe saura retenir l’attention de beaucoup de personnes soucieuses de mieux comprendre le monde qui nous entoure.
Bienvenue à tous et à toutes!
Le paradoxe de la Modernité et l’avenir de la culture
Par Serge Cantin
Après s’être voulu « maître et possesseur de la nature », pour évoquer la fameuse formule du Discours de la méthode, l’homme moderne se retrouverait trois siècles plus tard prisonnier, selon Hannah Arendt, « de deux processus surhumains : la Nature et l’Histoire, condamnés l’un et l’autre à progresser indéfiniment sans jamais atteindre de telos inhérent, sans jamais approcher d’idée pré-établie[1]».
C’est ce paradoxe, longtemps dissimulé par l’utopie d’un nouveau monde à venir, que je voudrais tenter, sinon d’élucider, du moins d’éclaircir un peu dans ce texte, et ce à la lumière des diagnostics concordants que Hannah Arendt et Fernand Dumont ont portés sur la culture moderne. Cela dit, je ne suis pas sans ignorer la méfiance que le concept de modernité ici entendu est susceptible d’inspirer chez certains, pour qui la modernité ne saurait s’écrire qu’au pluriel, comme dans le titre même de ce colloque : Temps, espace et modernités. Ce n’est pas, qu’on le comprenne bien, que je conteste la diversité, dans le temps et dans l’espace, des formes et des contenus culturels modernes. Mais j’estime que cette diversité procède elle-même de la dynamique moderne, qu’elle correspond aux diverses formes sous lesquelles s’est accompli, et continue de s’accomplir, le long processus d’acculturation ou d’adaptation des sociétés traditionnelles à un nouveau mode de civilisation: la Modernité[2].
On aura compris que mon point de vue n’est pas celui – tout à fait légitime, il va sans dire – de l’historien soucieux d’objectivité et attentif à la complexité des phénomènes et à la richesse de leurs connexions. Ma démarche se veut plutôt analytique et réflexive; elle est celle du philosophe-essayiste que je suis, qui cherche tant bien que mal à faire coïncider la connaissance de soi et celle de l’histoire; qui s’évertue, en somme, à trouver ou à donner un sens à ce que les hommes font et défont.
La fin des utopies et le triomphe de l’animal laborans
Persister aujourd’hui à chercher un sens à l’histoire humaine, c’est continuer à faire crédit à une certaine philosophie de l’histoire[3], malgré le discrédit où celle-ci est tombée dans notre modernité démocratique-individualiste. « Dégrisé de son optimisme, écrit Jean-Claude Guillebaud, l’homme occidental avance vers l’avenir de façon étrange; il titube à contrecoeur comme s’il était promis non point à la “fin de l’Histoire” mais à la déportation vers l’inconnu. L’avenir? Sa représentation elle-même est hors de portée[4].» « Aujourd’hui, remarquait de son côté Emmanuel Levinas, nous avons vu disparaître l’horizon qui apparaissait derrière le communisme, d’une espérance, d’une promesse de délivrance. Le temps promettait quelque chose. Avec la disparition du communisme, le trouble atteint des catégories très profondes de la conscience européenne[5]. »
On pourrait multiplier les citations qui, depuis la chute du mur de Berlin, font état du même trouble, de la même inquiétude diffuse face à l’avenir, du même dégrisement paradoxal. Dégrisement paradoxal, en effet, et à un double titre. D’abord parce que les hommes modernes que nous sommes avaient longtemps cru que la modernité allait quelque part, qu’elle était porteuse d’une Vérité se réalisant progressivement dans et par l’histoire. Ce postulat d’immanence de la Vérité à l’histoire, fondateur de la modernité occidentale, a donné lieu, comme on le sait, à un grand nombre d’utopies, de la religion de l’humanité d’Auguste Comte à la société sans classes de Marx en passant par le Nouveau Christianisme de Saint-Simon : autant de « projections dans l’avenir d’un monde autre que celui-ci », autant de « modèles utopiques » qui ont inspiré et justifié à la fois, non seulement les grandes idéologies modernes, mais le travail des sciences de l’homme et des philosophies[6]. Or, si l’idée de Progrès continue certes de fournir une justification aux recherches anthropologiques contemporaines (au sens large, littéral, que Fernand Dumont donne au mot « anthropologie »), force est d’admettre que l’horizon que celles-ci projettent dans l’avenir a perdu beaucoup de sa visibilité, la science de l’homme tendant à devenir elle-même une sorte d’industrie soumise à des règles de fonctionnement de plus en plus formalisées et qui échappent aux chercheurs eux-mêmes.
Pourtant – et c’est l’autre aspect du dégrisement paradoxal que je veux souligner –, si nos sociétés dites postmodernes paraissent avoir définitivement congédié les naïves promesses de l’avenir pour exalter celles du présent et du moi[7], elles n’en continuent pas moins d’être essentiellement tournées vers l’avenir et de prétendre pouvoir se produire elles-mêmes en se projetant dans le futur. Mais que sauraient-elles donc produire dès lors que se trouve récusé tout modèle de l’avenir, que s’est évanouie toute représentation un peu ferme de la fin de l’histoire? La réponse n’est pas longue à chercher: elles produisent, et plus qu’en abondance, des marchandises, des biens de consommation, des gadgets de toutes sortes, toutes ces choses utiles et inutiles qui ressortissent à ce que Hannah Arendt a appelé « le processus dévorant de la vie ». Prédominant depuis deux siècles au moins en Occident, ce processus ne s’est pas moins considérablement accéléré, étendu, amplifié, mondialisé au cours des dernières décennies, au point de mettre en péril les institutions humaines de la permanence, c’est-à-dire la culture elle-même :
« La vie est un processus qui partout épuise la durabilité, qui l’use, la fait disparaître […] La vie est indifférente à la choséité d’un objet; elle exige que chaque chose soit fonctionnelle, et satisfasse certains besoins. La culture se trouve menacée quand tous les objets et choses du monde, produits par le présent ou par le passé, sont traités comme de pures fonctions du processus vital de la société, comme s’ils n’étaient là que pour satisfaire quelque besoin[8]».
Je ne puis résumer ici, même à très grands traits, l’analyse approfondie à laquelle Hannah Arendt, dans The Human Condition, soumet la triade de la vita activa, ces trois activités humaines fondamentales que sont pour elle le travail, l’œuvre et l’action. Disons, pour aller au plus court, que ce que Arendt met bien en évidence dans « son second chef-d’œuvre[9]», ce qui lui apparaît déterminant à l’époque moderne, qui commence pour elle au XVIe siècle, c’est l’apparition sur la scène publique du travail et de l’économie, de ce que les Grecs anciens appelaient l’oikos, c’est-à-dire de toutes ces activités liées au processus vital, à la production et à la reproduction de la vie, activités qui, avant l’époque moderne, avaient été confinées au domaine privé de la maisonnée et de la famille. Or, pour nécessaires et vitales qu’elles soient pour l’homme, ces activités n’en demeurent pas moins, selon Arendt, des activités futiles, en ce sens que les choses qu’elles produisent, grâce au travail humain ou à celui des machines, ne sont pas faites pour durer, pour rester dans le monde, mais pour être consommées ou jetées après usage et remplacés par d’autres objets, par d’autres produits, et cela indéfiniment, en vertu du « métabolisme de travail de l’homme avec la nature ». À la différence de l’œuvre, activité qui fournit au monde ces objets durables que sont les monuments, les livres, les tableaux, etc., l’activité du travail n’a, elle, d’autre but que la perpétuation de l’espèce humaine. Quelle que soit la joie ou la satisfaction qu’il puisse par ailleurs procurer, le travail répond d’abord chez l’homme à la nécessité (animale) de vivre, de subsister.
Tout le problème pour Arendt – et qui la rend si critique, voire méfiante à l’égard de la modernité –, c’est que, loin de disparaître lorsque le travail devient, grâce à la science et à la technique, extraordinairement productif, cette futilité propre à l’activité économique ne fait au contraire que s’étendre quand, obnubilée par cette fécondité inouïe du travail, la société moderne finit par annexer tout le domaine de l’œuvre au travail, à imposer à celle-là la mesure et les critères propres à celui-ci :
« nous avons changé l’œuvre en travail, nous l’avons brisée en parcelles minuscules jusqu’à ce qu’elle se prête à une division où l’on atteint le dénominateur commun de l’exécution la plus simple afin de faire disparaître devant la force de travail (cette partie de la nature, peut-être même la plus puissante des forces de la nature) l’obstacle de la stabilité “contre-nature”, purement de-ce-monde, de l’artifice humain[10]».
Se pourrait-il qu’un jour cet « obstacle » que constitue le monde s’étant écroulé sous la pression du « processus dévorant de la vie », les hommes, éblouis, aveuglés par l’extraordinaire productivité de ce processus, ne sachent même plus en reconnaître la futilité et le non-sens, bref qu’ils n’aient même plus conscience de l’absurdité d’une vie entièrement axée sur la consommation? Tel est en tout cas le danger qu’appréhendait Hannah Arendt. « Ce que nous avons devant nous, prévenait-elle, c’est la perspective d’une société de travailleurs sans travail, c’est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire [11]». En d’autres termes, ceux du « chansonnier » québécois Félix Leclerc, l’infaillible façon de tuer un homme c’est de l’empêcher de travailler en lui donnant de l’argent, surtout quand cet homme « ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté[12]». Il ne lui reste plus alors, comme dirait Dumont, qu’à « s’asseoir au bord du chemin de l’histoire pour regarder le défilé des acteurs, de politiciens, des artistes, des scientifiques, et parfois des philosophes », tant il est vrai qu’« à un milieu livré à la production ne peut correspondre qu’un horizon qui soit spectacle de la production[13]».
N’est-ce pas à un tel danger spectaculaire, si minutieusement décrit par Guy Debord[14], que sont exposés les hommes qui vivent dans des sociétés où la culture n’est plus qu’une industrie parmi d’autres, où l’on fabrique des « œuvres » comme on produit des automobiles ou des frigidaires? Société où la tradition a cédé la place à la production; où l’autre monde, celui que promettait la religion et par rapport auquel prenait sens le monde ici-bas, semble s’être dissous dans l’immanence à soi de l’individu naturel, cet être hypothétique que les théoriciens du contrat social prirent jadis pour point de départ de leurs spéculations politiques:
« La société sortie de la religion, souligne Marcel Gauchet, […] est portée par un “naturalisme” d’un nouveau genre […] où la nature ne s’oppose pas à la “surnature”, mais à la “culture” […] Un naturalisme intimement lié à l’individualisme et qui opère une déculturation au nom de l’individu, de par l’ambition de celui-ci d’accéder à une existence immédiate et directe par lui-même […] Une logique puissante fait revivre l’état de nature parmi nous et tend à faire croire que l’homme existe avant et indépendamment de ces formes et médiations de culture qui lui procurent ce qui n’apparaît plus que comme une identité sociale contingente et extrinsèque. Cet appareillage culturel se trouve disqualifié ou relativisé au nom des besoins, des désirs, des intérêts, de l’authenticité de l’individu, au regard desquels il ne parvient plus à faire figure que de carcan arbitraire et autoritaire. Nous sommes ici à la source de la déshumanisation insidieuse qui travaille notre monde. Elle n’a rien à voir avec l’humanité sauvage de l’âge totalitaire. Elle fait le meilleur ménage avec un humanisme de principe; elle n’est animée par aucune hostilité envers la culture. Elle est une déshumanisation d’indifférence, d’oubli et d’incompréhension. Elle est “bienveillante et douce”, eût dit Tocqueville. Ce pourquoi elle est mal saisissable[15]».
Ce n’est pas uniquement la religion qui se trouve menacée par cette naturalisation de l’homme; c’est, plus fondamentalement encore, « la faculté de prendre conscience de soi en prenant distance », c’est « la persistance millénaire d’un lieu de la Transcendance, d’une césure par laquelle la collectivité ou l’individu pouvaient interpréter leur immanence en la réfractant sur un autre monde[16]». L’homme naturalisé dont parle Gauchet est celui qui aurait appris, ou à qui l’on aurait appris, à se dispenser de cette réfraction; mais à quel prix? C’est bien de déshumanisation qu’il s’agit ici, et d’aliénation, mot banni du vocabulaire politically correct de notre temps. Non pas de l’aliénation du moi, comme le croyait Marx; non pas de l’aliénation du pour soi dans l’en soi, pour employer le vocabulaire sartrien; mais, au contraire, de l’aliénation par rapport au monde (worldlessness). Car s’il est vrai que la fonction de l’artifice humain, de l’œuvre, est d’offrir aux hommes « un séjour plus durable et plus stable qu’eux-mêmes[17]», d’instaurer cette permanence et cette stabilité qui protègent l’homme de l’exubérante monotonie physique ou biologique du cycle naturel; si, autrement dit, l’œuvre est la condition par laquelle l’homme peut vivre, non pas seulement dans un milieu naturel, mais dans un monde dont il a conscience, dans un lieu qui est à la fois distance et mémoire, bref dans une culture[18], alors on peut dire que l’homme moderne naturalisé, l’homme devenu animal laborans (avec ou sans travail), loin d’avoir conquis le monde en voulant le refaire, loin de s’en être rendu « maître et possesseur », l’a perdu, peut-être irrémédiablement.
Le monde perdu et le concept moderne d’histoire
Ce changement de l’œuvre en travail, qui signe la défaite de l’homo faber et le triomphe de l’animal laborans, avec le danger que ce triomphe fait courir à l’avenir de la culture, Arendt l’explique par la position centrale qu’en est venu à prendre, dans la mentalité même de l’homo faber moderne, le concept de processus qui, en substituant à la primauté du « quoi » – de l’objet fabriqué – la primauté du « comment » – du procédé de fabrication lui-même –, a enlevé « à l’homme fabricateur, à l’homme constructeur, les normes et les mesures fixes et permanentes qui, avant l’époque moderne, lui ont toujours servi de guides dans l’action et de critères dans le jugement [19]». Dans un tel cadre, purement instrumental, toutes les fins se dégradent en moyens, tout but atteint n’étant lui-même que moyen en vue d’une fin nouvelle qui, « une fois atteinte, cesse d’être une fin et perd sa capacité de guider[20] ».
Mais cette substitution du comment au quoi, avec la perte de l’Objet qui en est résultée, comment elle-même l’expliquer? Comment le concept de processus est-il parvenu à s’imposer dans la mentalité de l’homo faber? Ce qui revient à se demander ce qui a bien pu se passer pour qu’on en arrive, au XVIIIe siècle, à considérer, la raison « moins comme une possession que comme une forme d’acquisition », « non comme l’idée d’un être, mais comme celle d’un faire », non comme « un contenu déterminé de connaissances, de principes, de vérités » mais comme « une énergie »[21].
On devine que ce n’est pas uniquement le développement de la société commerciale et capitaliste qui est en cause dans cette perte de l’Objet[22], dans ce « vaste mouvement qui, de l’identification de l’homme avec ses œuvres, allait porter l’attention, à l’encontre de l’homme, sur ses œuvres et leur logique interne [23]». Pour Arendt, ce sont des événements et des découvertes survenus au seuil de l’époque moderne, notamment celle du télescope, qui s’avérèrent déterminants en remettant radicalement en question le statut de la raison, son pouvoir de révélation[24]. « Si l’œil humain peut trahir l’homme au point que tant de générations ont cru que le Soleil tourne autour du la Terre, il faut renoncer à la métaphore des yeux de l’esprit; elle se fondait finalement, encore qu’implicitement et même quand elle servait par opposition aux sens, sur la confiance dans la vision corporelle[25].»
Ce renoncement n’implique rien de moins, comme Arendt l’explique minutieusement, que la disparition corrélative du monde donné par les sens et du monde transcendant, disparition qui marque le divorce de l’être et de l’apparaître et le repli de la vérité dans le sujet, conditions de la mathématisation de la physique moderne[26]. Au seuil du très beau livre qu’il a consacré au passage « du monde clos à l’univers infini », Alexandre Koyré, après avoir évoqué un certain nombre de facteurs susceptibles de rendre compte de la « crise de la conscience européenne » au XVIIe siècle, attire l’attention sur « un processus plus profond et plus grave, en vertu duquel l’homme, ainsi qu’on le dit parfois, a perdu sa place dans le monde ou, plus exactement peut-être, a perdu le monde même qui formait le cadre de son existence et l’objet de son savoir, et a dû transformer et remplacer non seulement ses conceptions fondamentales mais jusqu’aux structures mêmes de la pensée[27]».
Par quoi l’homme moderne a-t-il remplacé le monde?
« Faut-il souligner que, dans notre civilisation, le devenir remplace comme référence le cosmos où les Grecs cherchaient le critère ultime des comportements humains; il remplace aussi ce temps eschatologique qui permettait au christianisme d’autrefois de négliger l’explication positive des événements. Contrairement aux Anciens, nous ne disposons plus d’un arrière-monde; ou plutôt, l’arrière-monde, c’est maintenant l’histoire elle-même. Les auteurs des philosophies de l’histoire croyaient l’appréhender, sinon le décrire; nous nous accordons sur la vanité de ces tentatives, mais nous n’avons pas supprimé pour autant le renvoi plus ou moins implicite à ce devenir qui se profile derrière nos reconstructions partielles du passé[28].»
Autrement dit, dans la situation d’aliénation au monde où nous sommes, sans cosmos et sans Cité politique[29], le devenir historique n’est pas plus concevable que la nature elle-même. Comme elle, l’Histoire n’est plus, dit Dumont, qu’une Ombre. Cette Ombre n’est ni l’histoire réelle au sens de ce qui s’est passé (Geschichte) ni la connaissance de l’histoire (Historie); elle est plutôt ce qui permet, sans recours à une transcendance (à une histoire sainte surplombant l’histoire profane), de les concevoir l’une et l’autre, et de rendre par là même possible le travail de l’historien, comme du sociologue ou de l’ethnologue[30]. Et c’est précisément parce que la Nature et l’Histoire ne sont plus que des Ombres – qu’elles n’ont plus, en d’autres termes, de signifiés ou de référents – que l’homme moderne peut être dit (selon la formule d’Arendt placée en liminaire de ce texte) prisonnier « de deux processus surhumains : la Nature et l’Histoire, condamnés l’un et l’autre à progresser indéfiniment sans jamais atteindre de telos inhérent ». Ce qui revient à dire que l’homme moderne « où qu’il aille ne rencontre que lui-même », rejeté qu’il est, en l’absence d’un monde commun, « dans la prison de son esprit, dans les limites des schémas qu’il a lui-même créées[31]».
Dans son article « Le concept d’histoire : antique et moderne », repris dans La crise de la culture, Arendt insiste sur le fait que ces schémas subjectifs, ces processus mentaux toujours en devenir n’ont pas seulement dévoré « l’objectivité solide du donné », mais que, en éliminant « toutes les notions de commencement et de fin », ils « ont fini par retirer son sens au processus unique total qui était à l’origine conçu pour leur donner sens », avec pour résultat d’établir « l’humanité dans une immortalité terrestre potentielle ». Or rien, selon Arendt, n’est plus étranger à l’esprit du christianisme que cette idée d’une immortalité terrestre de l’humanité, qui « ne nous permet pas de nourrir des espérances eschatologiques » et « élimine en fait de l’histoire séculière toutes les spéculations religieuses sur le temps »[32]. En quoi Hannah Arendt, qui était pourtant agnostique, se révèle encore une fois très voisine des positions du chrétien Fernand Dumont, qui a tenu lui aussi à marquer la rupture que les temps modernes représentent par rapport à la temporalité religieuse chrétienne, nonobstant tout ce dont la modernité est redevable au christianisme.
En définitive, en perdant l’autre monde, le monde d’en-haut, les hommes modernes n’ont pas gagné celui d’en-bas, contrairement à ce que d’aucuns voudraient encore nous faire croire[33]. Tout ce qu’ils ont obtenu dans l’échange, c’est le pouvoir de produire indéfiniment, sinon désespérément, le monde, dans une histoire « sans telos inhérent », sans commencement ni fin. « Résolu à accomplir méthodiquement toutes les démarches destinées à le libérer de l’inconfort – celui d’avoir froid, ou celui de se sentir coupable –, l’homme moderne, écrit Pierre Manent, ne voit plus devant lui que des instruments de son projet d’émancipation, ou des obstacles à celui-ci. Plus rien de substantiel, que ce soit loi, bien, cause ou fin, ne retient son attention, ni ne ralentit son avance. Il est celui qui court, et qui courra jusqu’à la fin du monde[34].»
Culture, mémoire, religion
On se méprendrait si l’on ne voyait dans cette critique dumont-arendtienne qu’un long détour pour mieux justifier à la fin (à la manière d’un Leo Strauss) le retour à la bonne vieille tradition conçue comme seul remède efficace pour traiter les maux de notre modernité. Nos deux penseurs savent trop bien que la reconduction pure et simple de la tradition ne peut être qu’un leurre, sinon l’une des mystifications auxquelles seront de plus en plus tentés de recourir des sociétés et des pouvoirs en mal d’unanimité. Ce qui ne veut pas dire pour autant que la tradition s’étant dissoute sous les sunlights de la modernité, il n’y aurait plus qu’à s’asseoir dans son TGV et à contempler « l’ère du vide » et « l’empire de l’éphémère » dont un Gilles Lipovetsky loue depuis trente ans – en toute désinvolture postmoderne – les vertus libératrices pour les individus autosuffisants que nous serions devenus. Un sociologue comme Fernand Dumont est trop sensible au temps réel des sociétés pour souscrire à une telle vue de l’esprit. « En tout cas, dit-il, jusqu’à notre époque, les durées traditionnelles ont coexisté avec les durées empiriquement déterminées. Et si celles-ci sont devenues de plus en plus envahissantes, leur juxtaposition avec les traditions est cruciale pour comprendre l’originalité de la culture moderne[35]. » Elle l’est également pour comprendre le sens de cette « nouvelle praxis sociale », de cette utopie que Dumont appelle de ses vœux à la fin du Lieu de l’homme.
L’ordre qui préside à la vie commune ne relevant plus, dans nos sociétés modernes, d’un principe sacré qui viendrait du dehors garantir le lien entre les hommes, le sort de la culture[36] se trouve dès lors étroitement lié à la participation politique (à l’action, au sens arendtien), à l’aménagement sans cesse repris du monde, du « lieu de l’homme », par des individus que, dans un cadre démocratique, rien ni personne (comme Rousseau l’avait si fortement souligné) ne peut légitimement contraindre. Mais qu’est-ce qui motivera cette participation politique? Dans les termes de Dumont: « À partir de quoi les hommes pourront-ils se représenter l’avènement de leur histoire ? » Quelles seront « les raisons profondes du rassemblement des hommes »[37]?
C’est à ce problème capital – au commencement de la politique moderne et qui n’a jamais été vraiment résolu, sinon dans l’abstrait par les doctrines du contrat social ou dans les faits par le totalitarisme – que cherche à répondre la notion dumontienne de mémoire. Par mémoire, Dumont entend non pas la conservation de tel ou tel héritage du passé, mais la préservation de « l’avènement », c’est-à-dire du « mode d’appréhension de la temporalité que représente la tradition», dont Dumont postule qu’il « est essentiel à la nature de la culture[38]». Or, dans les conditions modernes, cette fidélité à « l’avènement » ne peut s’accomplir que sous le mode de la conscience historique, que par la prise en charge du sens d’un passé qui, « n’éclairant plus l’avenir[39]», exige désormais, si l’homme ne veut pas perdre la mémoire de ce qu’il est, sa profondeur[40], d’être interrogé, interprété, discuté.
Mais ce mode d’appréhension de la temporalité propre à la tradition, dans quelle mesure est-il lié à la religion, dans quelle mesure a-t-il besoin d’elle pour s’exercer? Ce qui frappe en tout cas, c’est que son érosion s’est faite en concomitance avec le mouvement de sécularisation des sociétés occidentales. D’où la question: une sortie totale de la religion ne risquerait-elle pas de se traduire par l’extinction de ce mode d’appréhension traditionnelle de la temporalité dont Dumont postule qu’il est « essentiel à la nature de la culture », et donc à l’homme lui-même? Pour Marcel Gauchet, cette implication semble déjà effective: « Pour la première fois, dit-il, notre compréhension temporelle de nous-mêmes — je parle de la compréhension spontanée, quotidienne, pratique — est réellement et complètement soustraite à l’immémoriale structuration religieuse du temps[41].»
Si c’était vrai, si « la compréhension spontanée, quotidienne, pratique » était « complètement soustraite à l’immémoriale structuration religieuse du temps », à ce que Dumont appelle « l’avènement » par opposition à « l’événement », alors il faudrait bien admettre qu’il n’y a plus grand espoir ni pour la culture ni pour l’homme. Mais c’est sans compter sur les capacités de résistance et d’invention de la culture commune, sur ce que Michel de Certeau appelait le « braconnage »[42]. Pour Dumont, « l’érosion engendre la réaction[43] »; la disparition des traditions suscite, selon l’expression de Danièle Hervieu-Léger, des « politiques de la tradition[44]».
Il n’empêche que Dumont prenait au sérieux « la mort de l’homme » qu’annonça naguère un Michel Foucault. « Un degré zéro de la tradition est-il concevable sans que la culture et l’homme disparaissent ? », demandait-t-il [45].
Certes, « ce degré zéro de la tradition » était, pour Arendt comme pour Dumont, une « hypothèse-limite », dans laquelle l’un et l’autre refusaient de se complaire, mais qu’ils eurent la lucidité et le courage de regarder en face. Car c’est bien à un danger d’amnésie collective, à une maladie d’Alzheimer universelle que nous confrontent la disparition des traditions et « le triomphe de l’animal laborans ». Un danger devant lequel « nos combats d’hommes et de chrétiens peuvent prendre leur sens d’ensemble[46]».
Serge Cantin
Yves Bastarache est professeur retraité de philosophie. Il a fait sa carrière au Cégep de Trois-Rivières où, outre l’enseignement de la philosophie et des publications, il a aussi coordonné le Département de Philosophie pendant de nombreuses années. Il est par ailleurs l’un des instigateurs de l’implantation du programme d’études en Histoire et Civilisation (700.B0 / Liberal Arts) au Cégep de Trois-Rivières — un programme qu’il a aussi coordonné pendant de nombreuses années.