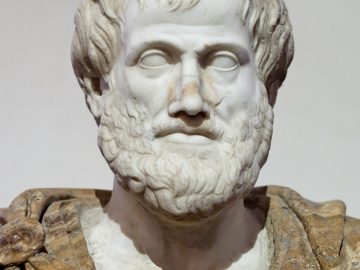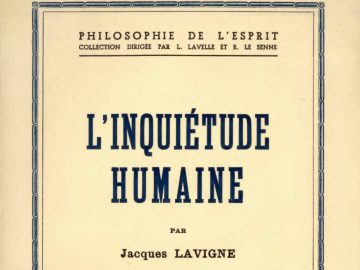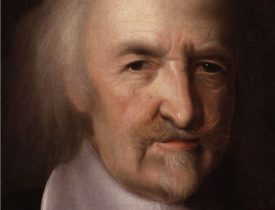[NDLR : Nous publions à nouveau, pour le remettre en avant, le texte toujours aussi pertinent de la conférence de M. Serge Cantin, publié la première fois sur PhiloTR en novembre 2007.]
Serge Cantin
Professeur titulaire en Philosophie à l’UQTR et chercheur au Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ), ainsi que titulaire, en 2008-2009, de la Chaire d’études du Québec contemporain à la Sorbonne Nouvelle-Paris III
Je n’aurais jamais pensé présenter un jour une conférence dans une église et, qui plus est, du haut d’une chaire. Comme quoi – et c’est vraiment le cas de le dire – il ne faut jamais jurer de rien. Mais rassurez-vous: je ne profiterai pas de ma position transcendante pour vous faire un sermon; vous assisterez bel et bien à une conférence, que j’ai intitulée L’avenir de la culture dans un monde désenchanté, un titre que je me propose du reste d’expliquer ou de justifier. Qu’est-ce qu’un monde désenchanté? En quoi peut-on dire que le monde dans lequel nous vivons est un monde désenchanté? Et quel est l’avenir de la culture dans ce monde désenchanté? Telles sont les questions auxquelles je tâcherai ici de répondre, si tant est que l’on puisse répondre à d’aussi énormes questions en moins d’une heure. Disons plutôt, et plus modestement, qu’il s’agira de projeter un certain éclairage sur des questions qui valent selon moi d’être posées et réfléchies, des questions dont je voudrais surtout vous convaincre de la pertinence.
*
Qu’est-ce qu’un monde désenchanté? Comme eût répondu ce cher Monsieur de la Palice, un monde désenchanté, c’est un monde qui n’est plus enchanté… Aussitôt, on pense à l’enfance, à ce temps des commencements et des enchantements premiers dont nous gardons tous, ou presque, la nostalgie. Or il existe aussi une enfance des sociétés humaines dont nos sociétés modernes, aussi adultes, aussi majeures qu’elles se veuillent, entretiennent la nostalgie. « La race humaine eût péri, si l’homme n’eût commencé par être enfant », disait Jean-Jacques Rousseau[1], qui s’y connaissait bien en nostalgie, et en utopie.
L’homme qui a commencé par être un enfant, c’est l’homme des sociétés dites primitives pour qui le monde est peuplé de démons et de merveilles; c’est l’homme qui croit aux âmes et aux esprits, à leur présence et à leur intervention dans la nature; c’est l’homme qui vit dans un monde enchanté, aussi dur et aussi cruel qu’un tel monde puisse nous paraître aujourd’hui.
Ce monde enchanté est un monde foncièrement religieux, au sens que Marcel Gauchet donne au mot religion dans son maître-livre, Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de la religion[2]. Pour Gauchet, en effet, la religion, la vraie religion, celle qu’il appelle la « religion première » ou la « religion pure », ce n’est pas la religion telle que nous l’avons connue ou telle que nous la connaissons encore dans nos sociétés; ce n’est pas le christianisme, ni le judaïsme, ni l’islam, ni le bouddhisme, ni l’hindouisme. La « religion pure », c’est celle plutôt des sociétés archaïques où le mythe est au fondement même de la vie sociale et de la culture. Le mythe : c’est-à-dire des récits symboliques, des histoires exemplaires qui racontent l’origine du monde et qui servent de matrices aux temps présents et de modèles aux comportements des humains. Pour l’homme des sociétés mythiques, ce qui est survenu in illo tempore, en ce temps-là, au temps des origines, en un temps antérieur à celui des hommes, il faut à tout prix le sauvegarder dans le temps des hommes, notamment par le recours aux rites qui réactualisent hic et nunc le temps sacré des origines. Le mythe livre donc un savoir des origines qui permet de comprendre les choses actuelles et, jusqu’à un certain point, de les maîtriser, d’entrer en communication symbolique avec le monde, qui est un monde enchanté plein de signes et de présages où l’homme est en communion avec la nature, un monde où la divinité, bien qu’invisible en elle-même, demeure partout présente.
Ainsi la « religion pure », la religion « pleinement développée » ne se trouverait pas, selon Gauchet, à la fin, au terme d’un long développement des religions; elle serait au contraire au commencement de l’histoire, un commencement que l’on pourrait presque qualifier de préhistorique, dans la mesure où la religion des sociétés primitives se caractérise essentiellement, comme le souligne encore Gauchet, par un « refus de l’histoire », c’est-à-dire du changement, lequel est vu comme une perte, comme une déperdition du passé fondateur, auquel il importe par-dessus tout de rester fidèle, qu’il faut reproduire le plus fidèlement possible puisque ce passé renferme et livre les secrets de l’homme et de l’univers. Comme le disait de son côté Claude Lévi-Strauss, les sociétés primitives, qu’il appelle les « sociétés froides », « baignent dans un fluide historique auquel elles s’efforcent de demeurer imperméables », contrairement à nos sociétés modernes, nos « sociétés chaudes » qui, elles, « intériorisent l’histoire pour en faire le moteur de leur développement[3]». Notez bien que Lévi-Strauss ne dit pas que les sociétés primitives ne changent pas du tout; il affirme plutôt qu’elles s’efforcent à tout prix de ne pas changer.
Mais s’efforcer, tout en baignant dans un fluide historique, de demeurer imperméable à l’histoire, n’est-ce pas refuser la condition historique et, partant, la condition humaine tout court? Aux yeux de Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, et de tant d’autres penseurs modernes, la religion est, comme on le sait, une aliénation, un opium, une consolation. Dans une telle optique, la « religion pure » des sociétés primitives représenterait l’aliénation par excellence, l’expression de la dépossession suprême de l’homme. En bref, l’homme purement religieux ne vivrait dans un monde enchanté que pour autant qu’il est aliéné, littéralement étranger à lui-même, qu’il ne se possède pas, qu’il s’est toujours-déjà perdu.
Or c’est là où la perspective de Marcel Gauchet sur la religion se révèle particulièrement intéressante. Celui-ci ne nie pas que l’homme religieux, l’homme de la religion pure ou première, l’homme du monde enchanté soit un être dépossédé de lui-même; mais cette dépossession de soi, Gauchet la considère en même temps, et paradoxalement, comme la plus parfaite possession de soi dont l’homme puisse rêver. Car en choisissant, inconsciemment, la religion (pure), l’homme primitif aurait choisi « de se posséder en consentant à sa dépossession, en se détournant du dessein de dominer la nature au profit d’un autre dessein, celui-là de s’assurer d’une identité de part en part définie et maîtrisée ».
Bref, et pour le dire d’une façon un peu simpliste, l’homme primitif aurait choisi la religion pour ne pas avoir à se casser la tête, afin d’éviter de s’interroger sur lui-même, celle-ci venant d’avance répondre aux questions fondamentales de l’existence : qu’est-ce que le monde? Qu’est-ce que j’y fais? Pourquoi je nais? Pourquoi je meurs? Là résiderait, selon Gauchet, la raison d’être des religions, « le secret séminal de l’attitude religieuse », une attitude qui aurait du reste subsisté, dans toute sa pureté, jusqu’au XXe siècle, dans ces sociétés dites primitives qu’ont étudiées sur le terrain des ethnographes comme Claude Lévi-Strauss. Quoi qu’il en soit, ce ne serait pas un hasard si la religion a dominé « la presque totalité de l’histoire humaine »; c’est que la religion, comme le souligne encore Gauchet, « exprime une option fondamentale dont, si éloignés que nous soyons, nous retrouvons l’écho au tréfonds de nous-mêmes ». Retrouver l’écho de la religion au fond de soi-même, c’est avoir parfois envie, par exemple, de se dessaisir de sa vie, de renoncer à son statut de Sujet et à la difficulté d’être-soi qui lui est inhérente, à ce qui constitue, autrement dit, le sort commun des hommes vivant dans une société sortie de la religion, dans un monde désenchanté.
*
Tâchons donc de résumer ce qui précède. À en croire Marcel Gauchet, l’homme, ou l’humanité, serait donc placé devant deux options fondamentales: l’option pour la religion, pour la permanence contre le changement, pour l’hétéronomie enchantée, si l’on peut dire; et une autre option, qui est la nôtre, l’option pour l’histoire, pour le changement et l’autonomie, pour la pleine possession de soi, sans dépossession. Reste que si l’on admet, avec Rousseau, que l’homme a commencé par être un enfant, il faut alors aussi admettre que l’option religieuse fut historiquement première, que l’homme a d’abord opté, et pendant des millénaires, pour la religion et contre l’histoire. Comme si l’humanité était entrée à reculons dans l’histoire, en commençant par refuser radicalement l’histoire, c’est-à-dire le changement, le progrès, le développement. Dès lors, toute la question est bien sûr de savoir quand, comment et pourquoi, l’homme, ou plutôt une certaine partie de l’humanité est sortie de la religion pour entrer dans l’histoire, dans l’âge historique. Quand, comment et pourquoi on est passé d’un monde enchanté au monde désenchanté, de la « société froide » à la « société chaude », dans les termes de Lévi-Strauss? C’est la question à laquelle Gauchet s’efforce de répondre dans Le désenchantement du monde, en reconstituant les grandes étapes de la sortie de la religion et de l’entrée dans l’âge historique. Je ne saurais évidemment prétendre exposer en quelques phrases la problématique gauchetienne, particulièrement dense et complexe. Retenons simplement que la sortie de la religion est, pour Gauchet (comme pour Lévi-Strauss d’ailleurs), un long processus qui trouve son point de départ dans l’émergence corrélative de l’État et de l’écriture en Méditerranée orientale au IIIe millénaire avant J.-C. Bref, on ne passe pas brusquement de l’option religieuse à l’option historique, ou de l’avènement à l’événement, pour utiliser le vocabulaire de Fernand Dumont[4]. L’avènement, c’est la conscience de la préexistence du sens à l’existence, c’est l’idée que j’hérite du sens, que le sens me vient du passé, un passé qu’il me faut donc sauvegarder dans le présent et pour l’avenir. L’événement, c’est, au contraire, la conscience de l’immanence du sens à l’histoire; c’est ce que Marx appelait la praxis; c’est l’idée que le sens est à découvrir et à faire dans et par l’histoire.
Nous serions donc ici devant deux manières fondamentalement distinctes de vivre dans le temps, deux manières pour l’homme de se situer dans la durée. Et, pour le répéter, on ne passe pas brusquement de l’une à l’autre. Ce qui s’est produit plutôt au fil des siècles, sinon des millénaires, c’est une modification lente, graduelle du rapport de l’homme au temps, une modification qui va consister à valoriser de plus en plus l’événement au détriment de l’avènement, le changement aux dépens de la permanence, et, par voie de conséquence, à accélérer le rythme réel du changement. Cette nouvelle disposition à l’égard du temps, cette disposition disons pro-historique, mettra beaucoup de temps à se reconnaître comme telle, à s’assumer, à s’affirmer au grand jour. Les sociétés qui, dès le troisième millénaire avant J.-C., entreprennent leur sortie de la religion, vont elles-mêmes demeurer pendant des millénaires dans une économie religieuse de la dette de sens envers le passé, dans la fidélité aux commencements, bref dans la durée traditionnelle. Pensons au christianisme, qui fut, selon Gauchet, « la religion de la sortie de la religion », et donc une sorte de formation de compromis dans la mesure où le christianisme valorise l’histoire mais en tant qu’elle est une histoire du salut, qui fait certes une place à la liberté humaine mais en l’inscrivant dans un schéma encore mythique, en rapportant le sens de cette liberté à un antérieur, à une genèse, à une création divine de l’histoire.
C’est précisément cette antériorité du sens que la Modernité va remettre en question, comme l’illustre parfaitement la philosophie cartésienne, fondée sur le doute méthodique et hyperbolique à l’égard de tout ce qui est donné, de tout ce qui vient du passé, de tout ce que véhicule la tradition, bref du Sens comme avènement. Comme si la Modernité représentait la prise de conscience de cette disposition prohistorique qui était latente depuis des millénaires. Comme si, avec la Modernité, l’humanité occidentale se reconnaissait elle-même comme Histoire, comme mouvement de sortie de la religion, et entrait par le fait même de plain-pied, en toute conscience, dans l’âge historique, dans l’âge du progrès et du développement, dans l’âge du désenchantement du monde. « Dès la Renaissance, écrit Fernand Dumont, se dessine l’idée qui sera ouvertement proclamée au XIXe siècle : il n’y a pas d’essence de l’homme; celui-ci se définit par ses œuvres; il n’a d’être qu’historique.[5]»
Ce qui s’affirme ainsi, dès la Renaissance, c’est l’idée de production, c’est « l’idée que la culture est moins reçue que fabriquée[6]», que la Vérité et le Sens ne sont pas donnés a priori, mais qu’ils sont à faire, à produire, à fabriquer; c’est l’idée cartésienne que l’homme doit se rendre comme « maître et possesseur de la nature ». Et non seulement de la nature extérieure, mais de sa nature propre, c’est-à-dire de la culture elle-même. Bref, ce qui s’affirme avec la Modernité, c’est l’idée que l’homme doit se rendre maître et possesseur de soi dans et par l’histoire.
Cette nouvelle disposition prohistorique implique la disqualification de la culture reçue, de la tradition. L’homme-enfant, l’homme d’avant les Lumières, l’homme encore mineur et responsable de sa minorité, comme dira Kant, cet homme-là est mis hors-jeu en même temps qu’il devient, comme chez Rousseau ou encore dans le mythe du Bon Sauvage, objet de nostalgie.
« Ôtez toute chose que j’y voie[7]», faisait dire Paul Valéry à son Monsieur Teste, ce personnage aussi lucide que désenchanté, ce personnage éminemment moderne. « Ôtez toute chose que je j’y voie », et par-dessus tout ces valeurs sublimes qui enchantaient le monde mais qui aliénaient la conscience humaine, qui maintenaient l’homme dans l’enfance et la dépendance. Ainsi Max Weber, le contemporain de Paul Valéry, caractérisera-t-il « le désenchantement du monde par la science » comme le destin d’une époque, l’époque moderne, qui « a conduit les hommes à bannir les valeurs suprêmes les plus sublimes de la vie publique ».
Mais bannies de la vie publique, du présent politique des sociétés, les valeurs les plus sublimes n’ont pas pour autant disparu du paysage moderne; elles furent plutôt aussitôt projetées dans l’avenir, dans la vie publique future, que l’on espérait radieuse, que l’on se plaisait à imaginer sans conflit, pacifiée et transparente à elle-même.
Comme certains parmi vous, j’appartiens à une génération qui a cru au Grand Soir, à cette génération dite lyrique qui prétendait savoir où cela allait l’Histoire avec un grand H. Le Progrès, le Développement, la Science, la Raison, la Lutte des classes, les Forces productives, tout cela conduisait bien quelque part. Tout ne va-t-il pas quelque part? On y croyait au temps de « notre jeunesse », avant que, pour paraphraser Péguy, notre lyrisme ne fût dévoré par la politique à laquelle il donna naissance. Depuis, on a pas mal déchanté, à telle enseigne que certains ont résolu de quitter une fois pour toutes le terrain miné de l’Histoire pour aller chercher les valeurs les plus sublimes dans la vie professionnelle ou privée.
Quoi qu’il en soit, l’homme moderne, après avoir désenchanté le monde, n’est pas parvenu à le réenchanter, contrairement à ce que certains voudraient bien nous faire croire. En renonçant au monde enchanté, tout ce que l’homme a obtenu en échange, c’est le pouvoir de produire le monde, indéfiniment, dans une histoire sans commencement ni fin, sans telos.
« Dégrisé de son optimisme, écrit Jean-Claude Guillebaud, l’homme occidental avance vers l’avenir de façon étrange; il titube à contrecoeur comme s’il était promis non point à la “fin de l’Histoire” mais à la déportation vers l’inconnu. L’avenir? Sa représentation elle-même est hors de portée[8].»
« Aujourd’hui, remarquait de son côté Emmanuel Levinas, nous avons vu disparaître l’horizon qui apparaissait derrière le communisme, d’une espérance, d’une promesse de délivrance. Le temps promettait quelque chose. Avec la disparition du communisme, le trouble atteint des catégories très profondes de la conscience européenne[9].»
On pourrait ainsi multiplier les citations qui, depuis la chute du mur de Berlin, font état du même trouble, de la même inquiétude diffuse face à l’avenir; une inquiétude qui fait d’ailleurs l’écho à celle que manifestait, il y a plus d’un siècle et demi, Alexis de Tocqueville dans son chef-d’œuvre De la démocratie en Amérique, dont on connaît la célèbre formule: « Le passé n’éclairant plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres ».
*
Nous voilà donc dégrisés de notre optimisme, pour paraphraser Guillebaud. Nous avons congédié les naïves promesses de l’avenir pour exalter les vertus du moi désaffilié, affranchi de toute contrainte. Reste que nos sociétés demeurent essentiellement tournées vers l’avenir, qu’elles continuent de prétendre se produire elles-mêmes en se projetant dans le futur. Mais que peuvent-elles donc espérer produire dès lors qu’elles ont récusé tout modèle de l’avenir, que s’est dissipée toute représentation un peu ferme de la fin de l’histoire? La réponse n’est pas longue à chercher: nos sociétés produisent, et plus qu’en abondance, des marchandises, des biens de consommation, des gadgets de toutes sortes, toutes ces choses utiles et inutiles qui ressortissent à ce que Hannah Arendt a appelé « le processus dévorant de la vie ». Prédominant depuis deux siècles au moins en Occident, ce processus s’est considérablement accéléré, étendu, amplifié, mondialisé au cours des dernières décennies, au point de mettre en péril les institutions humaines de la permanence, c’est-à-dire la culture elle-même :
« La vie, écrit Hannah Arendt, est un processus qui partout épuise la durabilité, qui l’use, la fait disparaître […] La vie est indifférente à la choséité d’un objet; elle exige que chaque chose soit fonctionnelle, et satisfasse certains besoins. La culture se trouve menacée quand tous les objets et choses du monde, produits par le présent ou par le passé, sont traités comme de pures fonctions du processus vital de la société, comme s’ils n’étaient là que pour satisfaire quelque besoin [10]».
Ce dont nous parle ici Hannah Arendt, ce qui lui apparaît déterminant à l’époque moderne, qui commence pour elle au XVIe siècle, c’est l’apparition sur la scène publique du travail et de l’économie, de ce que les Grecs anciens appelaient l’oikos, c’est-à-dire toutes ces activités liées au processus vital, à la production et à la reproduction de la vie, activités qui, avant l’époque moderne, avaient été confinées au domaine privé de la maisonnée et de la famille. Or, pour nécessaires et vitales qu’elles soient pour l’homme, ces activités n’en demeurent pas moins, selon Arendt, des activités futiles, en ce sens que les choses qu’elles produisent, grâce au travail humain ou à celui des machines, ne sont pas faites pour durer, pour rester dans le monde, mais pour être consommées ou jetées après usage et remplacées par d’autres objets, par d’autres produits, et cela indéfiniment, en vertu du « métabolisme de l’homme avec la nature ». À la différence de l’œuvre, cette activité qui fournit au monde ces objets durables que sont les monuments, les livres, les tableaux, etc., – cette activité qui suppose l’appartenance-au-monde, l’inscription dans un monde entendu comme « lieu de l’homme », lieu où je nais et meurs, qui était là avant moi et qui sera là après moi, lieu où s’humanisent les nouveaux-nés et leur permet d’accéder non pas à la nature mais à la culture –, à la différence de l’œuvre, donc, le travail, lui, n’a d’autre but que la perpétuation de la vie de l’espèce humaine. Quelle que soit la joie ou la satisfaction qu’il puisse par ailleurs procurer, le travail répond d’abord chez l’homme à la nécessité (animale) de vivre, de subsister.
Tout le problème pour Arendt – et qui la rend si critique, si méfiante à l’égard de la modernité –, c’est que la futilité propre à l’activité économique du travail, bien loin d’avoir disparu lorsque le travail est devenu, grâce à la science et à la technique, extraordinairement productif, cette futilité n’a fait au contraire que s’accroître et s’étendre avec le triomphe de la culture de masse qui tend à réduire l’œuvre au travail, la culture à la nature :
« nous avons changé, dit Arendt, l’œuvre en travail, nous l’avons brisée en parcelles minuscules jusqu’à ce qu’elle se prête à une division où l’on atteint le dénominateur commun de l’exécution la plus simple afin de faire disparaître devant la force de travail (cette partie de la nature, peut-être même la plus puissante des forces de la nature) l’obstacle de la stabilité “contre-nature”, purement de-ce-monde, de l’artifice humain[11]».
Le danger qu’appréhende ici Hannah Arendt, c’est qu’un jour cet « obstacle » que constitue le monde disparaisse tout à fait sous la pression du « processus dévorant de la vie », et que les hommes, éblouis, aveuglés par l’extraordinaire productivité de ce processus, ne sachent même plus en reconnaître la futilité et le non-sens, bref qu’ils n’aient même plus conscience de l’absurdité d’une vie entièrement axée sur la consommation. « Ce que nous avons devant nous, prévenait Arendt, c’est la perspective d’une société de travailleurs sans travail, c’est-à-dire privés de la seule activité qui leur reste. On ne peut rien imaginer de pire[12].» Comme le chantait naguère Félix Leclerc, l’infaillible façon de tuer un homme c’est de l’empêcher de travailler en lui donnant de l’argent, surtout quand, comme le dit Arendt, cet homme « ne sait plus rien des activités plus hautes et plus enrichissantes pour lesquelles il vaudrait la peine de gagner cette liberté[13]». Que reste-il alors à cet homme-là? Je serais tenté de répondre avec Dumont qu’il ne lui reste qu’à « s’asseoir au bord du chemin de l’histoire pour regarder le défilé des acteurs, des politiciens, des artistes, des scientifiques, et parfois des philosophes[14]».
N’être plus que spectateur, n’est-ce pas en effet le cas de beaucoup de nos contemporains, livrés corps et âme au spectacle de la production? Et n’est-ce pas le sort auquel risquent d’en être de plus en plus réduits des êtres qui vivent dans cette société que Guy Debord, il y a exactement quarante ans, juste avant mai 68, avait désignée comme « la société du spectacle »? Société où la culture n’est plus qu’une industrie parmi d’autres; société où l’on fabrique des « œuvres » comme on produit des automobiles ou des frigidaires. Ce qui n’a au fond rien d’étonnant, tant il est vrai, pour citer encore une fois Fernand Dumont, qu’« à un milieu livré à la production ne peut correspondre qu’un horizon qui soit spectacle de la production[15]». Dans un tel milieu, en effet, dans ce milieu qui est le nôtre et où tout change sans arrêt, où rien n’est durable sinon le développement lui-même, comment les horizons ne deviendraient-ils pas eux-mêmes changeants et relatifs; comment le sens du monde ne deviendrait-il pas lui-même contingent? Comme si l’autre monde, celui que promettait la religion et par rapport auquel prenait sens le monde ici-bas, s’était dissous dans la nature, dans l’immanence à soi de l’individu naturel:
« La société sortie de la religion, souligne Marcel Gauchet, […] est portée par un “naturalisme” d’un nouveau genre […] où la nature ne s’oppose pas à la “surnature”, mais à la “culture” […] Un naturalisme intimement lié à l’individualisme et qui opère une déculturation au nom de l’individu, de par l’ambition de celui-ci d’accéder à une existence immédiate et directe par lui-même […] Une logique puissante fait revivre l’état de nature parmi nous et tend à faire croire que l’homme existe avant et indépendamment de ces formes et médiations de culture qui lui procurent ce qui n’apparaît plus que comme une identité sociale contingente et extrinsèque. Cet appareillage culturel se trouve disqualifié ou relativisé au nom des besoins, des désirs, des intérêts, de l’authenticité de l’individu, au regard desquels il ne parvient plus à faire figure que de carcan arbitraire et autoritaire. Nous sommes ici à la source de la déshumanisation insidieuse qui travaille notre monde. Elle n’a rien à voir avec l’humanité sauvage de l’âge totalitaire. Elle fait le meilleur ménage avec un humanisme de principe; elle n’est animée par aucune hostilité envers la culture. Elle est une déshumanisation d’indifférence, d’oubli et d’incompréhension. Elle est “bienveillante et douce”, eût dit Tocqueville. Ce pourquoi elle est mal saisissable[16]».
Ce n’est donc pas seulement la religion qui se trouve menacée par cette naturalisation de l’homme, c’est bien la culture elle-même, au sens précis où l’entend Fernand Dumont, c’est-à-dire « la culture comme distance et mémoire », ou ce qu’il appelle encore « le dédoublement de la culture »; un dédoublement qui ne soit pas que la projection spectaculaire du changement permanent et de l’innovation programmée, une télé-réalité, mais un dépassement véritable, un survol de l’histoire par lequel les hommes puissent prendre conscience d’eux-mêmes, s’élever au-dessus de leur petite vie quotidienne afin de réfléchir et d’interpréter leur condition.
*
Ce dédoublement, cette distance, Dumont l’appelle aussi mémoire. Non pas la mémoire en tant qu’entrepôt ou musée où l’on conserverait précieusement quelques bonnes vieilles traditions; mais la mémoire comme l’autre de l’événement, comme avènement, comme « persistance millénaire d’un lieu de la Transcendance, d’une césure par laquelle la collectivité ou l’individu pouvaient interpréter leur immanence en la réfractant sur un autre monde[17]».
L’homme naturalisé dont parle Marcel Gauchet est celui qui aurait appris, ou à qui l’on aurait appris, à se dispenser de cette réfraction; mais à quel prix? N’ayons pas peur des mots, de ceux qu’utilisent Dumont, Arendt et Gauchet : car c’est bien de déculturation et de déshumanisation qu’il s’agit ici :
« Nous sommes, écrivait Hannah Arendt il y a un demi-siècle, en danger d’oubli et un tel oubli – abstraction faite des richesses qu’il pourrait nous faire perdre – signifierait humainement que nous nous priverions d’une dimension, la dimension de la profondeur de l’existence humaine. Car la mémoire et la profondeur sont la même chose, ou plutôt la profondeur ne peut être atteinte par l’homme autrement que par le souvenir[18].»
Dans L’avenir de la mémoire, une conférence qu’il a prononcée à la fin de sa vie, Fernand Dumont faisait remarquer que les sociétés fondées sur la tradition étaient des sociétés « sans mémoire », en ce sens que ces sociétés pouvaient se passer de mémoire puisque la tradition leur en tenait lieu[19]. La sociologue française Danièle Hervieu-Léger ne dit pas autre chose quand, à propos des mêmes sociétés traditionnelles, elle parle de « sociétés de mémoire », signifiant par là que de telles sociétés « n’avaient nul besoin de solliciter cette mémoire dont la présence compacte s’imposait dans toutes les situations de la vie[20]». Ainsi, sans leur être identiques, les sociétés traditionnelles ressemblent aux sociétés sauvages et enchantées; elles fonctionnent selon la même économie de l’avènement ou de la dette du sens. Ces sociétés n’ont pas besoin de se donner une mémoire puisque celle-ci leur est donnée a priori dans des traditions et des coutumes. Autrement dit, le sens y advient aux hommes de plus loin qu’eux-mêmes, du passé ou de l’au-delà. Ce qui n’est évidemment plus le cas dans les sociétés modernes et désenchantées, dans nos sociétés que le passé n’éclaire plus, dans nos sociétés tournées vers l’avenir; et c’est pourquoi la mémoire y devient une tâche, celle qui consiste « à trouver ce qui, dans un passé contesté et souvent dérisoire, mérite [encore] de nous inspirer[21]». Si le passé ne peut plus nous éclairer, alors nous n’avons d’autre choix que de l’éclairer, de l’interpréter, de chercher dans ce passé quelque chose comme une intentionnalité commune susceptible de donner sens à l’aventure humaine et de nous inciter, par-delà nos petites vies dispersées et atomisées, à la poursuivre.
Cette tâche-là est éminemment pédagogique. Elle l’est parce qu’elle met en jeu l’avenir même de la culture et que la culture est par-dessus tout une pédagogie. On parle beaucoup de nos jours d’éducation à la citoyenneté. J’en suis, mais pour autant que cette citoyenneté ne se réduit pas à un stock de règles formelles et abstraites que l’on apprend pour réussir un examen. Pour être citoyen, il faut d’abord être un homme, et pour être un homme, pour exister humainement, il faut avoir été humanisé, éduqué, introduit dans un monde déjà humain, dans une culture particulière, dans une histoire qui a commencé avant nous.
Serge Cantin 19 novembre 2007
[2] Sauf indications contraires, les citations de Marcel Gauchet sont tirées de cet ouvrage paru chez Gallimard en 1985, et réédité depuis dans la collection TEL.
[4] Dans Le Lieu de l’homme. La culture comme distance et mémoire, Montréal, Éditions HMH, 1968. Réédité dans Bibliothèque québécoise.
[6] Ibid., p. 35.
[10] Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, 1983, pp. 109 et 116.
Serge Cantin, récipiendaire du Prix Jacques-Parizeau 2016, Professeur retraité de philosophie à l’Université du Québec à Trois-Rivières, il fut aussi chercheur au Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIEQ) ainsi que titulaire, en 2008-2009, de la Chaire d’études du Québec contemporain à la Sorbonne Nouvelle-Paris III. Spécialiste reconnu de la pensée de Fernand Dumont, il a fait partie du comité d’édition des œuvres complètes de Fernand Dumont (PUL, 2008), dont il a signé l’Introduction générale, en plus de publier en 2019 La distance et la mémoire : Essai d’interprétation de l’œuvre de Fernand Dumont (PUL, 2019).