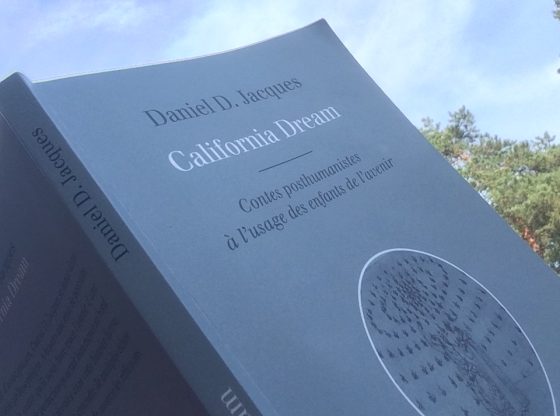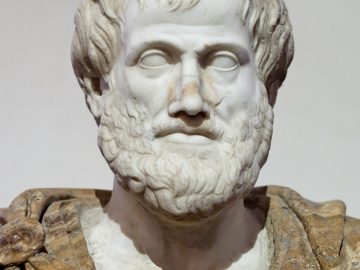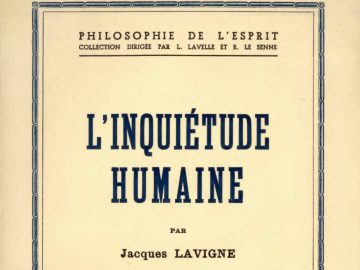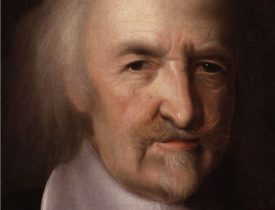Avec California Dream. Contes posthumanistes à l’usage des enfants de l’avenir (Éditions Liber, 2021), on découvre en Daniel D. Jacques un écrivain de talent. Au travers de ce récit d’anticipation, cet auteur ne manque pas de susciter la réflexion. Quel salut peut apporter l’humanisme ? L’être humain livré à lui-même peut-il produire ce qu’il faut pour l’orienter ? L’éthique ne devient-elle pas un illusoire éclairage – une parodie de la lumière – lorsqu’elle est elle-même en carence d’un réel enracinement dans une conception substantielle de la nature humaine ?
Daniel D. Jacques a enseigné la philosophie au Cégep Garneau. Fondateur de la revue Argument, il est aussi l’auteur de livres de haut calibre[1]. Interpellé par la question de la technique et des utopies posthumanistes, il a procédé à une substantielle enquête philosophique sur les humanismes dans La Mesure de l’Homme. Il y examinait les diverses réponses apportées à travers les siècles, à la question de ce qui fait l’Humanité de l’Homme. Une enquête philosophique qui faisait ressortir à quel point notre époque s’est vidée d’une conception substantielle de la nature humaine – de son humanité. Et cela, comme il le notait d’ailleurs, à une époque – la nôtre – qui aura cruellement besoin d’une conception substantielle de l’être humain pour affronter les questions qui émergent avec les utopies posthumanistes et les progrès techniques accélérés que nous vivons. Car, face à ces défis, l’éthique à elle seule semble trop fragile. Du moins, cette considération jaillit de ses écrits.
Il est saisissant de constater à quel point la fiction permet de mieux faire saisir ces enjeux. California Dream est un récit d’anticipation, une fiction. C’est la première incursion de Daniel D. Jacques dans le territoire de la littérature. Sur le plan littéraire, c’est une réussite. Douze contes – auxquels s’ajoutent un prologue et un épilogue – qui constituent autant de récits en soi, mais qui les uns après les autres forment un tout qui dépasse ses parties. Des qualités littéraires indéniables, qui ne peuvent être réduites à un simple divertissement littéraire. Sur le plan du contenu, c’est tout autant une réussite. Longtemps après la lecture, ce récit tend à continuer à habiter le lecteur.
D’entrée de jeu, le prologue indique que les douze contes de ce petit livre de 140 pages mettent « en présence d’une civilisation qui se situait apparemment, lors de son extinction, à un stade intermédiaire de cognition » (page 9). Précisons que ces contes se situent dans un avenir peut-être pas si lointain, se déroulant de 2058 (dans une trentaine d’années d’ici) à 2198. On anticipe donc dès le début du récit qu’il y aura disparition de l’être humain tel que nous le connaissons.
Nul complot. Aucune dictature. Même qu’une convention universelle avec quatre grands principes est adoptée, au début de California Dream, pour protéger la dignité, la liberté, l’intégrité et la diversité humaine. Et pourtant (comme on le lit au début du livre, mais le saisit pleinement qu’à la fin), « les hommes auront-ils convoité leur propre fin, désiré leur extermination totale dans la recherche d’une jouissance universelle » (page 7).
Ce qui étonne – et qui ne cesse de stimuler les réflexions –, c’est de constater, de récit en récit, comment les passions humaines peuvent se revêtir d’apparats éthiques dans leur course effrénée. Et comment diverses revendications « humanistes » peuvent conduire à la perte. L’humanisme, c’est l’être humain qui est placé au centre – voire qui se veut garant du salut de l’humanité. Mais est-ce le bon appui ?
À cet égard, l’ambiguïté de la chute du récit place le lecteur face au travail – et la joie – d’y penser. Ainsi, à un moment « le narrateur » note :
« Je crois toutefois, grâce à la fréquentation de ces vies et des œuvres qui en témoignent, être parvenu à mon tour à ressentir quelque chose qui s’apparente à ces « mouvements de l’âme », soit quelque chose qui n’est pas entièrement réductible à une fluctuation aléatoire de mes fonctions cognitives. C’est alors que je suis parvenu à pénétrer le grand secret : depuis toujours, depuis le commencement, les passions des êtres humains, des naturels, les ont prédisposés à leur propre déchéance. L’homme est, depuis l’origine, un être né pour laisser place à plus que lui-même. » (California Dream, page 129)
L’ambiguïté y est riche à souhait. Rétrospectivement, c’est le lent glissement que montrent les contes, jusqu’à ce que l’être humain laisse effectivement place à « plus que lui-même ». Ce qui réjouira les partisans des utopies posthumanistes, et les personnes en phase avec le rêve que l’être humain puisse parvenir à abolir ses limites. Mais est-ce la seule interprétation de ce que « le narrateur » évoque ? Ce qu’il évoque est ambigu à souhait, car le récit contient aussi de nombreuses allusions, soit à la foi, soit à la religion, soit à la spiritualité. L’adepte du yoga intégral, dans le deuxième conte, eut ses errements, ouvrit la voie à la « Grande Transformation » – grâce à sa fortune dans la biologie de synthèse, au départ pour l’industrie alimentaire. Mais pour ce qui est des personnages faisant allusion à l’héritage chrétien, ils se situent dans des positions de résistance à la « Grande Transformation ». D’ailleurs, les allusions au christianisme dépassent les personnages proprement dits. C’est notable, si bien que le lecteur peut être conduit à se demander si ce n’est pas une autre compréhension possible du passage ci-haut. Au début de la Bible, dans le livre de la Genèse, l’être humain est créé pour adorer Dieu – c’est-à-dire, « pour laisser place à plus que lui-même ». Il est créé pour être en communion constante avec ce Dieu Trinitaire. Il a accès à tout, mais il lui est défendu de se nourrir des fruits de l’expérience du Bien et du Mal. Un interdit qui revient à un test : est-ce que l’être humain fait confiance à Dieu ou est-ce qu’il se fait juge de Dieu en décidant lui-même si la Parole de Dieu est digne d’être considérée ou pas ? L’être humain cherche alors à prendre la place de Dieu, à se diviniser. La chute s’en suit, ainsi que la corruption de la nature humaine. Ses passions le prédisposent alors « à sa propre déchéance ». C’est ainsi que la phrase du « narrateur » pourrait aussi être comprise par un être humain fait de chair et de sang. Mais il y a plus. Le « narrateur », à un certain moment où il « éprouve » une nostalgie particulière, note même (page 132) qu’il a parfois une « appréciation » pour la musique de l’artiste du tout premier conte. Or, le conte sur ce musicien rapporte que celui-ci a fait des études en théologie avant de devenir artiste (page 13), et qu’il « n’écoutait que de la musique sacrée, essentiellement d’inspiration chrétienne ou juive » (page 11). Qui plus est, on y souligne que le répertoire musical de cet artiste exceptionnel avait pour pièce maitresse une œuvre intitulée l’Apocalypse (page 12). Ce qui, bien sûr, est aussi le titre du dernier livre de la Bible. Ce livre qui clôt la Bible est un livre qui se termine avec une pleine restauration – de nouveaux Cieux et une nouvelle Terre, et un jugement de réconciliation éternelle pour les uns, et de perdition éternelle pour les autres. Mais dans ce livre, est aussi évoqué auparavant un temps où l’humanité pourrait être conduite en présence d’une imitation de prérogatives divines – voire en venir à sembler vaincre la mort et faire des « miracles ». Mais cette « victoire humaine » sur la mort ne pourrait-elle pas en même temps être sa fin ? Dans un contexte de « perfectibilité » de soi, qui se dessine progressivement vers la fin de California Dream, il ne semble plus envisageable « d’acheter ni vendre » (Ap 13.17) – c’est-à-dire d’être compétitifs (à l’emploi et dans les affaires) – sans « librement » recourir à une allégeance aux moyens offerts par la « Grande Transformation » (c’est une expression du récit dans California Dream). C’est notamment ce qu’évoque le conte du « professeur » dans l’Iowa (pages 115 à 125). Un tel état avancé des possibilités techniques constitue en même temps une « révolution spirituelle » (pages 29 et 30). Or, devant une telle « révolution spirituelle » telle qu’elle s’articule dans les contes posthumanistes, même si Dieu lui-même – ou Jésus lui-même – revenait en personne sur la terre, on peut se demander s’il trouverait encore la foi en Lui. Trouverait-il la confiance en son espérance (2 Pierre 3.3-4) ? Ou préférerait-on majoritairement s’en remettre aux « miracles » technologiques accessibles pour « vaincre » la mort et se joindre aux « paradis artificiels » évoqués ? Verrait-on dans l’Apocalypse une annonce à considérer sérieusement, ou une fable dépassée ? Verrait-on même cette référence ? Serait-ce une victoire humaine ou sa défaite ? D’une certaine manière, la progression de California Dream peut faire penser à des enjeux du grand récit de l’anthropologie chrétienne et de ce qui culmine dans l’Apocalypse.
Est-ce une considération que le lecteur devrait explorer, face à l’ambiguïté du passage du « narrateur » cité plus haut ? À tout le moins, l’ambiguïté de la fin de California Dream et le foisonnement des allusions (qui se prêtent à plus d’une interprétation) rappellent qu’il fut un temps où une multitude de personnes bénéficiait d’une conception substantielle de la nature humaine – et de sa destinée. Alors qu’à notre époque, il y a de moins en moins d’accords autour d’une telle conception substantielle. D’ailleurs, même l’idée d’une quelconque conception partagée largement pour définir la « nature humaine » semble s’évaporer. Pourtant, nous en aurions besoin pour préserver l’humanité de l’Homme – voire, pour préserver l’espèce humaine. Et cela, à une ère où les progrès techniques fulgurants pointent de plus en plus vers la nécessité de normes internationales pour encadrer ce que la technique rend possible (surtout lorsqu’elle touche à la nature humaine). Ce qui ne facilite pas les choses, si une substantielle conception de la nature humaine (partagée internationalement?) est nécessaire face à l’horizon du posthumanisme qui, lui, tend à prendre la place du vide laissé.
Tout cela se donne pleinement à saisir qu’après être passé au travers de chacun des contes de California Dream. Dans cette mesure, le « récit d’anticipation » de Daniel D. Jacques offre aussi une expérience de la temporalité, de l’effet du passage du temps. Une expérience du passage du temps, et de la manière par laquelle certaines victoires pour l’égalité, la dignité, le respect de la liberté face à son identité, la perfectibilité, et tant d’autres idéaux peuvent eux aussi devenir « humains, trop humains ». À tel point que le lecteur peut se demander jusqu’à quand ce qui à un moment apparait comme « Bien » ne se révèle pas en réalité être « Mal ».
Les douze contes regorgent par ailleurs d’échos de notre temps, et d’abondantes références « culturelles classiques » particulièrement bien choisies. On se surprend alors, ici et là, à avoir envie de « googler » (on n’en sort pas!) pour en savoir plus sur Les Buddenbrook de Thomas Mann, sur Light in August de William Faulkner, sur Roland de Lassus, sur Francesco Salviati, sur les changements culturels qu’a incliné Roméo et Juliette en son temps, sur le Gilded Age, et tant d’autres choses encore. Au fil de la lecture, on se réjouit aussi que chacun des contes est un riche univers en soi, hautement stimulant.
Difficile de terminer la lecture de California Dream sans « ressentir » ce qui se joue alors. On constate ainsi que cette incursion de Daniel D. Jacques dans les territoires de la littérature est précieuse, précisément par la force de California Dream à faire « ressentir » ce qui se joue.
À lire !
*****
En complément : si on le souhaite, on peut aussi s’accompagner de ce Carnet de lecture (cliquez ici).
Référence : Daniel D. Jacques, California Dream. Contes posthumanistes à l’usage des enfants de l’avenir, Montréal, Éditions Liber, 2021, 140 pages.
Site de l’éditeur : là.
Mise à jour de 2024 : on peut aussi lire mon article dans la revue Lampadaire : «California Dream de Daniel D. Jacques : des contes à l’usage de nos classes» (Patrice Létourneau, revue Lampadaire, no 1, 2024-03-01).
___
[1] Daniel D. Jacques a reçu le prix Victor-Barbeau (1999), décerné par l’Académie des lettres du Québec, pour son ouvrage Nationalité et modernité (Boréal, 1998). Il est aussi l’auteur notamment de La révolution technique (Boréal 2002) et de La fatigue politique du Québec français (Boréal 2008), ainsi que de Tocqueville et la modernité (Boréal 19911995) et de La Mesure de l’Homme (Boréal 2012).

Patrice Létourneau est professeur au Département de Philosophie du Cégep de Trois-Rivières depuis 2005. Outre son enseignement, il a aussi été en charge de la coordination du Département de Philosophie pendant 8 ans, de juin 2009 à juin 2017. Il est par ailleurs l’auteur d’un essai sur le langage, le sens et l’interprétation (Éditions Nota bene, 2005), ainsi que d’autres publications avec des éditeurs reconnus. Il collabore à PhiloTR depuis 2005. (Article sur PhiloTR | Site personnel)