Note de la rédaction : Vous trouverez ci-après le texte de la Philoconférence d’Yvon Corbeil sur l’éducation, prononcée au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières le mardi 19 février 2013, dans le cadre de la 2e édition de la Semaine de la philosophie.
_______________________________________________________________________________
TABLE DES MATIÈRES DE LA CONFÉRENCE :
Pour définir l’éducation, on doit d’abord définir l’homme!
L’agir culturel dans la nature; l’éducation comme «formation»!
Un autre chemin: l’éducation comme apprentissage de l’humanité!
Accession à l’humanité et école organisée!
La faillite fondamentale de l’éducation organisée!
La distinction actuelle des savoirs et le sort qu’ils réservent à l’éducation fondamentale!
_____________________________________________________________________________________
Pourquoi l’éducation?
YVON CORBEIL, Ph. D.
Professeur au Cégep de Trois-Rivières, QC.
1. Pour définir l’éducation, on doit d’abord définir l’homme
Dans le Lachès, Socrate rappelle à deux de ses relations qu’on ne saurait concocter un remède pour les yeux si on ne sait pas ce qu’est un oeil, ou qu’on ne saurait fabriquer un mors si on ignore ce qu’est un cheval. Dans le même ordre d’idées, personne ne songerait donc à concevoir l’éducation sans posséder d’abord une bonne définition de ce que l’homme est.
Mais ce n’est évidemment pas dans le dictionnaire, ni même dans des énoncés fondamentaux qu’il convient de chercher cette définition. Car les locutions vides de sens ou les énoncés savants et habiles se contentent le plus souvent de transformer les énigmes fondamentales en énigmes secondaires, laissant le chercheur tout aussi perplexe à l’arrivée qu’il l’était au départ. L’homme – celui-là même qui sait définir toute chose – éprouve bien du mal à se définir lui-même. Et s’il prétend y être parvenu, il s’en trouve d’autres, autour de lui, pour lui signifier leur désaccord.
Renonçant aux méthodes traditionnelles et « métaphysiques » de définitions de l’homme (conceptions religieuses, axiomes philosophiques), nous préférons généralement, de nos jours, « définir » l’homme partiellement, selon une perspective précise (biologie, psychologie, mais aussi économie, politique, etc.). Malgré l’intérêt pratique que peuvent présenter parfois de telles initiatives, elles ratent toutes, par définition, l’objectif consistant à définir non pas tel ou tel aspect de l’homme, mais l’homme lui-même, dans ce qu’il est essentiellement.
Le malaise que distille alors ce renoncement à chercher l’unité essentielle de l’homme se traduit le plus souvent par une tentative de le définir non plus par le biais de telle ou telle perspective particulière, mais plutôt par les valeurs qu’il exprime et tient pour importantes. C’est que les valeurs transcendent en quelque sorte les domaines dans lesquels elles peuvent se réaliser, et peuvent donc sembler être à même de réunifier ce que l’on avait préalablement fragmenté.
Demandant alors à quelqu’un de définir l’homme, il tendra à en décrire les valeurs les plus significatives, tenant celles-ci pour l’illustration la plus expressive possible de ce que l’homme est.
Si l’on utilise ce procédé pour tenter de définir l’homme actuel, je retiendrai, parmi les valeurs les plus significatives et les plus généralement admises dans notre culture, les trois suivantes3:
D’abord ce que j’appellerai la valeur «Nature»: l’intérêt que nous portons à la nature et, conséquemment, à la surexploitation que nous lui faisons subir depuis des temps… bibliques4. Cet intérêt, ainsi que les conclusions auxquelles nous parvenons en le servant, suggèrent, du moins dans ses expressions les plus acérées, une définition de l’homme comme d’un simple vivant parmi les vivants, un parmi les autres, un associé dans la grande communauté de la biosphère.
Ensuite, le «Relativisme des valeurs»: l’idée que des valeurs qualitativement distinctes aient en fait une valeur quantitativement égale. Autrement dit, l’affirmation selon laquelle telle valeur n’a objectivement pas plus de valeur que n’importe quelle autre. Ce qui culmine dans cette autre valeur que nous appelons «respect des valeurs des autres», et qui nous amène à conclure que toutes les valeurs se valent. Comprendre l’homme à partir de cette valeur-là le définit, assez curieusement, comme susceptible d’agir au nom de principes non pragmatiques et essentiellement universels (ce qui est vrai ou bon en soi), tout en reconnaissant et en acceptant le fait qu’ils ne le soient pas…
Finalement, la valeur plus ancienne, mais persistante, d’«Assistance aux faibles»: l’idée que, contrairement à ce qui se passe dans la nature, l’homme doit suppléer aux faiblesses et aux handicaps divers frappant l’un ou l’autre individu de la communauté. Il s’agit d’une valeur «contre-nature» car, évidemment, dans la nature, ces individus sont simplement passés à la trappe. Ce qui nous présente alors l’homme comme un être naturel étonnant, puisqu’il semble susceptible d’agir à l’encontre des directives issues de sa propre essence.
On le remarquera aisément, considérées ensemble, ces trois valeurs-clés sont tout à fait contradictoires. Une célébration cohérente de la Nature nous forcerait à admettre que la justice naturelle est la seule qui vaille, ce qui rendrait absurde la volonté de venir en aide aux faibles et aux inutiles. Par ailleurs, nous
Pour tenter de remettre ce problème à l’endroit, rappelons-nous d’abord Fichte, lequel, lors d’une allocution célèbre, tentait de déplacer l’attention des participants de l’objet visé au sujet qui l’appréhende. «Pensez à ce mur, disait-il, maintenant pensez à celui qui pense le mur.»
Pour le paraphraser, je dirais donc: pensez à ces valeurs, maintenant pensez à celui qui pense les valeurs.
De fait, il est illusoire d’espérer dénicher la définition de l’homme en en traçant le portrait à partir des principales valeurs qu’il exprime. Les valeurs que nous poursuivons sont nombreuses et s’opposent très souvent les unes aux autres. Elles varient selon les époques, les sociétés, voire selon les circonstances. Or, l’essence est nécessairement une et cohérente. Ce qui définit l’homme doit définir tous les hommes, et non pas une partie de ceux-ci, ou un moment ou l’autre de leur histoire.
Prenons la chose par le bon bout et tentons plutôt de mettre à jour quelque caractère qui soit plus universel. Par exemple, pourquoi pas, ce qui, chez l’homme, rend les valeurs possibles.
2. L’agir culturel dans la nature; l’éducation comme «formation»
Ce qui définit est ce qui distingue, car ce qui ne se distingue pas ne peut pas se définir autrement que ce de quoi on prétendait le distinguer. En termes plus simples, si l’homme n’est qu’un singe « amélioré », il n’est essentiellement qu’un singe; mais s’il est un homme, quelque chose doit l’en distinguer. Cette distinction doit être essentielle, qualitative, et non simplement quantitative. Cette distinction, je la pose en principe – quitte à en contester la légitimité plus tard – et je l’appelle «culture». La culture est ainsi le propre de l’homme, dans la mesure où elle le définit, puisqu’elle le distingue. L’homme est peut-être bien dans la nature, mais il est culture. Et dans la mesure où le singe n’est pas culturel, le singe n’est pas un homme.
Mais qu’est-ce que la «culture», et pourquoi le singe ne le serait-il pas? La culture est l’indice d’une adaptation au milieu qui dépasse les strictes consignes de l’instinct, notamment en ce qu’elle permet à l’homme d’agir de manière médiate, réfléchie, c’est-à-dire en faisant des choix, et non pas simplement en suivant les directives de l’instinct, lesquelles, pour leur part, trouvent dans l’action une expression immédiate. Cette faculté d’agir après réflexion initie, dans la chaîne des événements naturels, des causalités qui ne peuvent s’expliquer par les lois naturelles et ont, dès lors, un caractère extraordinaire, entraînant des conséquences imprévisibles. Si l’homme agit naturellement dans la nature, comme tout animal, il y agit aussi culturellement. L’homme est double. C’est une vieille idée, que les siècles nous ont conservée intacte quant au fond et que l’on illustre de mille et une manières; l’homme est matière et esprit, corps et âme, sensible et intelligible… nature et culture…
Ce que j’appelle «culture» s’oppose donc ainsi à la «nature», même si la première n’a d’effet que dans la seconde. La culture est rendue possible par l’espace de médiation entre la cause, le moteur de l’action, et l’action comme telle. Cet espace, nous l’appelons «liberté». La liberté est la condition de possibilité de la culture. Quel que soit le degré de détermination que l’on conçoive pour la liberté par la nature – autrement dit, peu importe que l’on pense cette «liberté» comme autonome ou, à l’opposé, comme secrètement contrainte par des motifs naturels -, ce caractère médiat de la relation qui lie la cause de l’action à l’action est la seule chose à laquelle nous puissions donner ce nom de «liberté».
On ne peut cependant pas laisser les choses en l’état. Car selon que nous pensions la liberté comme autonome ou, au contraire, comme déterminée, directement ou indirectement, par les nécessités naturelles, nous n’obtenons pas de l’homme la même définition.
Qu’en pense, par exemple, Rousseau? «Je ne vois dans tout animal, écrit- il, qu’une machine ingénieuse, à qui la nature a donné des sens pour se remonter elle-même, et pour se garantir, jusqu’à un certain point, de tout ce qui tend à la détruire, ou à la déranger. J’aperçois précisément les mêmes choses dans la machine humaine, avec cette différence que la nature seule fait tout dans les opérations de la Bête, au lieu que l’homme concourt aux siennes, en qualité d’agent libre.»
«les mêmes choses…», écrit Rousseau. En d’autres termes, l’action libre continuerait donc de servir le même maître que l’action instinctive des animaux: c’est-à-dire, en gros, la conservation de soi, la survie, qu’elle soit individuelle ou envisagée pour toute l’espèce. Culture et liberté n’ouvrent donc pas ici un nouveau champ d’actions pour l’homme, mais constituent plutôt un moyen parmi d’autres d’atteindre les mêmes objectifs. À cet égard, chaque espèce ayant ses propres moyens, culture et liberté se laissent donc comprendre comme de tels moyens, mais propres à l’homme. Le lion a des crocs, la gazelle a des jambes, l’homme possède la pensée réfléchie.
On trouve grosso-modo la même idée chez Nietzsche: «(…) j’en arrive à la conclusion que la majeure partie de la pensée consciente doit être imputée aux activités instinctives, s’agît-il même de la pensée philosophique (…) À l’arrière- plan aussi de toute logique et de son apparente liberté de mouvement, se dressent des évaluations, ou pour parler plus clairement, des exigences physiologiques qui visent à conserver un certain mode de vie.»
Toutefois, les défenseurs de cette idée – selon laquelle la liberté n’est (ou ne devrait être) qu’au service des «opérations de la Bête» – semblent généralement mieux disposés à montrer les défauts de cet animal-culturel que d’en célébrer les mérites.
Rousseau: «L’un [la Bête] choisit et rejette par instinct, et l’autre par un acte de liberté; ce qui fait que la Bête ne peut s’écarter de la Règle qui lui est prescrite, même quand il lui serait avantageux de le faire, et que l’homme s’en écarte souvent à son préjudice.»
On trouve bien entendu des idées similaires chez Nietzsche. La «vie» est l’unique source d’actions. Tous les «moyens» dont disposent les vivants servent cette seule fin. L’homme a le pouvoir d’agir consciemment, mais le motif de l’action reste le même que celui du chameau, de la tarentule ou du pissenlit. Cependant, ce pouvoir de l’homme a une conséquence troublante: contrairement à tous les autres vivants, l’homme, parce qu’il réfléchit avant d’agir, peut se tromper.
On peut être d’accord ou pas avec Rousseau et Nietzsche, il reste que la possibilité de l’erreur, dont ils nous parlent chacun à leur manière et qui constitue, dans une bonne mesure, le leitmotiv de leur oeuvre, montre clairement qu’indépendamment de la question de savoir si la culture est un bien ou un mal pour l’homme, elle est bien réelle. En d’autres termes, nul ne nie que l’homme puisse agir culturellement dans la nature, peu importe le jugement porté ensuite sur cet agir.
Que ce soit pour son bien ou pour son malheur, l’homme est «libre» et culturel. Et voilà qu’est ainsi posée la nécessité de l’éducation. Car si le côté «bête» de l’homme évolue tout naturellement au cours de sa vie – comme cela se produit chez tous les vivants -, le côté culturel ne jouit d’aucune «raison interne»10 susceptible d’apprendre à l’homme comment user de cette faculté consistant à agir après réflexion. L’animal périrait si son instinct défaillait. Il en va de même pour l’animal en l’homme. Mais l’homme comme tel – pensé dans son essence distinctive, c’est-à-dire comme libre et culturel – périra si on ne l’éduque pas. Il faut donc l’éduquer, et puisque l’homme est le seul être qui soit culturel, il est le seul à devoir l’être.
Face aux apprentissages strictement naturels, qui se font par transmission de bagages génétiques et probablement aussi, du moins chez certaines espèces plus complexes, par mimétisme, les apprentissages culturels propres aux hommes semblent au départ sérieusement handicapés, astronomiquement complexes. L’entreprise éducative ne procède pas suivant des automatismes physiologiques, et les desseins que l’éducation permet de poursuivre ne
montrent pas toujours – c’est le moins que l’on puisse dire – un rapport immédiat aux nécessités naturelles.
Dans ce vaste chantier qu’ouvre la nécessité de l’éducation, gardons cependant les pieds sur terre et restons, encore un moment, avec Rousseau et Nietzsche. Les «opérations» de l’homme sont les mêmes que celles de la Bête, disent-ils. La seule source de motifs d’action est la «Vie». Le premier problème éducatif semble donc être le suivant: comment éduquer la liberté, la culture, pour qu’elle ne vienne pas contrecarrer ces motifs qui, par ailleurs, sont les seuls et sont déjà si bien réalisés par l’instinct? Comment s’assurer que la culture serve la nature? Comment faire en sorte qu’elle ne soit pas seulement une erreur de la nature? (Car les autres vivants sont, à l’égard des nécessités naturelles, bien mieux lotis que l’homme: ils ne s’encombrent pas d’une faculté perturbatrice qui, peut-être, lui promet parfois de mieux réaliser ses objectifs, mais qui, la plupart du temps, lui nuit, en permettant la réalisation d’objectifs chimériques qui sont éloignés des fins véritables.)
Le risque est clair: s’il n’est pas bien éduqué, l’homme culturel peut devenir son propre ennemi; en court-circuitant la Règle, en travestissant sa propre cause. Rousseau l’affirmait à propos de l’homme de son époque, devenu «artificiel» et méchant à force de se regrouper pour survivre; Nietzsche l’écrivait à propos du sous-homme rabougri et christianisé; la «hard ecology» l’affirme aujourd’hui à propos de l’espèce tout entière et de la menace qu’elle représente pour «Gaïa»… À ce compte-là, il eût mieux valu pour l’homme d’avoir de fortes griffes ou de grandes dents, plutôt que d’être culturel.
Mais bon, puisqu’il faut éduquer, éduquons! Comment le fera-t-on, quelles fins poursuivrons-nous? Dans la logique à essence unique d’un Rousseau ou d’un Nietzsche (l’homme-bête, l’homme-volonté de puissance), la culture devra être entièrement au service de l’instinct, seul maître à bord. Il s’agit donc, il ne peut donc s’agir que de la conservation, individuelle et collective. Le programme éducatif est alors assez simple à concevoir (peut-être complexe à réaliser, mais simple à concevoir): apprendre à chaque homme comment survivre et s’assurer que cette entreprise ne vienne pas menacer celle de l’espèce
Les jeunes devront donc apprendre de leurs «maîtres», parents ou professeurs, comment survivre: comment cueillir, comment chasser, comment se protéger des rigueurs du climat, comment gérer les problèmes inhérents au
besoin d’assurer sa descendance… Puis, éventuellement, comment dominer, puisque tel est le fond trop souvent gardé secret de tous les avatars de la «loi naturelle».
Dans les sociétés archaïques aux structures économiquement et politiquement peu complexes (elles peuvent l’être davantage aux points de vue religieux, éthique ou social), l’acquisition des éléments culturels nécessaires à cette adaptation se faisait (se fait) par transmission filiale. Les parents sont les premiers «maîtres», éventuellement remplacés par des «spécialistes», au fur et à mesure que les sociétés deviennent plus compliquées et les techniques de réalisation d’outils plus sophistiquées.
L’éducation, qui règne donc sur le champ culturel en tant qu’elle supplée à l’absence de directions instinctives, a fondamentalement alors pour but de rendre la Bête-homme apte à survivre. C’est-à-dire qu’elle vient en quelque sorte colmater la brèche que la culture crée entre les besoins fondamentaux exprimés par l’instinct et le fait que l’homme a cet étrange pouvoir consistant, comme l’écrivait Kant, à pouvoir faire «un mauvais usage de ses forces».
À toutes fins utiles et exprimé en langage contemporain, l’éducation sert donc à… apprendre un métier, puisque ce dernier représente le mode suivant lequel l’homme supplée à ses lacunes «naturelles». Car de toute manière, peu importe les atouts physiques que l’on pourrait imaginer – quand bien même il pousserait à l’homme des ailes ou deux nouvelles mains -, ces atouts ne lui permettraient pas de survivre dans ce monde mécanisé et compliqué que nous avons créé.
C’est à cette conclusion que conduit inévitablement la pensée qui fait de l’homme une bête comme une autre. Si la vie n’a d’autre but que de se perpétuer, le vivant libre et culturel n’a d’autres possibilités que de mettre ses ressources à ce service-là. Le programme éducatif est alors tout tracé, et ce, malgré le fait qu’il procède au départ d’une impulsion négative: empêcher d’abord la liberté de devenir une entrave à la «vie», puis employer cette liberté afin de réussir, c’est-à-dire de survivre.
Quelle conception extraordinairement étriquée de l’éducation! Quelle conception étonnamment réductrice de la culture! Quelle conception désespérante de l’Homme!… Mais surtout, quel oubli de l’essentiel…!
3. Un autre chemin: l’éducation comme apprentissage de l’humanité
Notons d’abord que l’éducation15 servant avant tout à apprendre un métier – que l’on pourrait désigner aussi par «formation» – est quelque chose de tout à fait récent dans l’histoire de l’humanité. Si l’on remonte à l’Antiquité grecque, l’éducation était en fait l’affaire de quelques privilégiés, la plupart du temps appelés, par leur naissance, à des destins qu’ils pouvaient espérer prestigieux, et qui se voyaient donner diverses notions relatives à l’histoire, à la philosophie, à certains arts, en gros aux sciences dites «théorétiques» (cause première, mathématique) ou «pratiques» (politique, éthique), ces deux dernières se distinguant nettement d’une troisième catégorie d’études, dites «poiétiques». Les sciences théorétiques et pratiques n’ont alors que peu ou prou de rapport avec les «poiétiques», ces dernières renvoyant aux techniques permettant de faire, de fabriquer ou de produire. L’utilité des études théorétiques et pratiques était donc toute relative, voire inexistante. Malgré les prétentions amusantes d’un Thalès de Milet, qui estimait pouvoir réaliser des profits en s’efforçant de pénétrer les secrets de la météorologie16, les étudiants d’alors se voyaient surtout donner des notions que l’on pourrait qualifier de métaphysiques, (définitions du Bien, de la Vérité, de la Justice…), ou de «logiques», au sens étymologique du terme, c’est-à-dire des notions permettant de comprendre comment bien raisonner17. C’est dire qu’il s’agissait essentiellement soit de notions qui n’avaient aucun usage direct, soit que cet usage renvoyait seulement à des charges publiques.
Cette inutilité des études n’était évidemment pas comprise comme un défaut. Au contraire, Aristote et, après lui, l’ensemble de la culture occidentale jusqu’aux Temps dits Modernes, tiendront cette soi-disant «inutilité» pour une preuve de leur grandeur. Qu’il s’agisse de la contemplation des Mouvements Éternels chez Aristote, ou, plus tard, de la fréquentation du Plan Divin, l’homme qui tente de pénétrer les arcanes de la Structure Universelle séjourne près des dieux et utilise la part en lui qui est la plus digne, la moins « bestiale ».
Pendant ce temps, celui qui devenait charpentier de marine ou maçon apprenait son métier sur le tas. Et vingt siècles après Aristote, il l’apprendra encore sur le tas, ou alors au sein de confréries instituées à cette fin, mais toujours à l’écart de la véritable «éducation».
La scolastique (qui n’est rien d’autre que la perpétuation chrétienne de la pratique philosophique greco-latine, ne s’en distinguant, pour l’essentiel, que par le recours à un certain nombre de dogmes) reste le mode du savoir jusqu’aux renouvellements de l’Université – progressivement à partir du XVIIe siècle et jusqu’à tard au XXe -. Plus ou moins trois siècles au cours desquels on va admettre progressivement dans les institutions – bouleversant ainsi l’ordre tranquille du trivium et du quadrivium – les sciences dites «empiriques» et les recherches «pures», c’est-à-dire des champs d’études dont l’une des caractéristiques importantes consiste à (ou aura pour conséquence de) secouer le joug de la tutelle des dogmes religieux.
À partir de là, les traditions universitaires européennes connaitront des développements montrant quelques variantes: centralisation et systématisation du savoir en Allemagne (règne de la philosophie, idéalisme et «système» de la Raison); diversifications et «utilitarisme» du savoir anglais (là où le pragmatisme est certes mis en valeur, mais où ce pragmatisme reste fondamentalement lié à des fondements philosophiques, soit qu’il en découle, soit que ces derniers y reconduisent).
Ce qui est remarquable, c’est que durant toute cette période qui va, disons, de Socrate jusqu’au XXe siècle – 25 siècles tout de même…-, jamais l’éducation n’a-t-elle été pensée comme étant au service de tel ou tel métier, profession, discipline. Même dans les cas où les facultés produisent des «spécialistes», ces derniers sont d’abord éduqués au nom de LA science et, secondairement seulement, en fonction des activités qu’ils envisagent de pratiquer.
Vingt-cinq siècles donc d’éducation… inutile! C’est beaucoup…
À moins, bien entendu, que l’éducation ne serve pas d’abord à apprendre un métier…
L’homme vit les mêmes problèmes que la Bête: il doit survivre. Son monde est infiniment plus complexe que celui de la Bête, et ce que la Nature lui offre au berceau s’avère insuffisant. L’instinct ne fabrique pas un ouvrier spécialisé, un programmeur informatique ou un comptable. Cependant, cette complexité est récente; or, l’éducation ne l’est pas. Pourquoi ne sont-ils pas apparus ensemble, s’il se trouve qu’ils soient intrinsèquement liés? Ils ne le sont évidemment pas. L’éducation se donne peut-être désormais aussi pour tâche d’apprendre aux hommes un métier leur permettant de survivre, mais ce n’est certes pas là son premier et plus essentiel objectif.
Bien avant que la complexité du monde ait besoin de l’éducation, celle-ci existait. C’est qu’elle sert d’abord à l’homme comme tel. «L’homme ne peut devenir homme que par l’éducation. Il n’est que ce que l’éducation fait de lui.»
Ce qui distingue l’homme du singe n’est pas sa complexité, pas son intelligence. Les espèces animales montrent toutes diverses formes complexes d’organisation, elles témoignent toutes aussi d’une certaine intelligence. (Le tournesol, déjà, est assez «intelligent» pour suivre la course du soleil…). Ce qui le distingue est la capacité de créer des événements naturels dont la source est médiate: réfléchir avant d’agir; choisir d’abord, agir ensuite. Il est possible, voire courant, que l’action qui est alors choisie suive tout à fait l’une ou l’autre commande instinctive. L’action est alors posée en vue de la survie, mais même lorsqu’elle est réfléchie, elle ne se distingue pas essentiellement de l’action naturelle. Mais la possibilité qu’a l’homme de réfléchir avant d’agir va lui proposer un ensemble d’alternatives, parmi lesquelles il devra choisir celle qui lui paraît être la meilleure, au détriment d’autres, qui lui apparaîtront mauvaises, ou simplement moins bonnes. Ce faisant, il accueille en lui ce qui fait de l’homme un vivant tout à fait exceptionnel: la distinction entre le bien et le mal19. Par la suite, il pourra lui arriver d’agir non plus en fonction directe de l’utilité de telle ou telle action, mais plutôt en suivant ce qu’il aura considéré comme bonnes et mauvaises actions. Voilà un événement se produisant dans la nature et qui recèle des caractéristiques bien plus extraordinaires que les trous noirs ou la fonte des glaciers, car s’inscriront alors, dans la causalité naturelle, des événements extraordinaires, imprévisibles selon les mécaniques naturelles.
Nous donnons à ces bien et mal des noms plus spécifiques en fonction du domaine auquel ils se rapportent plus précisément. Ils deviennent alors efficacité et inutilité, mais aussi justice et injustice, courage et lâcheté, honnêteté et malhonnêteté, beauté et laideur… Ce sont les valeurs, que nous retrouvons donc ici, mais dont nous connaissons maintenant la source.
Voilà ce qu’il faut éduquer. C’est là, et nulle part ailleurs, que se situent l’acte de naissance et la nécessité de l’éducation. Elle est requise aux origines de l’homme, car rien dans la nature ne peut venir lui indiquer le mode d’emploi d’une source d’action qu’elle – la nature – ignore essentiellement.
Contrairement aux concepts mathématiques, dont on peut vérifier les assemblages par déduction, et contrairement aux concepts de choses sensibles, dont on peut vérifier la vraisemblance dans l’expérience, les concepts de valeurs sont de purs fantômes de la rationalité. À tel point qu’un même concept (disons, par exemple, celui de la justice) semble pouvoir endurer le fait d’avoir autant de
définitions qu’il y a d’hommes pour en faire usage, ce qui constitue, tout à la fois, un paralogisme extraordinaire et un formidable défi à la raison.
C’est par l’éducation seulement que l’homme peut apprendre à gérer ces «fantômes» au nom desquels il lui arrive d’agir. L’éducation est nécessaire à la seule fin de faire d’un homme… un homme. C’est par elle que l’homme accède à l’humanité.
4. Accession à l’humanité et école organisée
Il va donc de soi que l’éducation n’a pas attendu les institutions d’enseignement telles que nous les connaissons aujourd’hui pour exister. Elle est apparue simultanément à la venue de l’homme. Est-ce à dire que cette éducation-là, l’éducation fondamentale, véritable, continuerait de se réaliser, ici et maintenant, comme elle l’a toujours été, et que l’école organisée telle que nous la connaissons ne servirait qu’au reste (autrement dit, apprendre un métier)?
C’est compter sans le fait que nous avons progressivement confié à l’école organisée toute une série de nécessités d’apprentissages que les hommes du passé confiaient aux seuls milieux familiaux. Pourquoi l’avoir fait? Cela tient à plusieurs facteurs, parmi lesquels les plus significatifs m’apparaissent être les suivants:
• La complexité de notre monde fait en sorte qu’un individu du XXIe siècle est en contact avec l’humanité entière, plutôt qu’avec la même dizaine ou vingtaine de personnes durant toute sa vie, comme cela a pu être le cas pendant des millénaires. Que ce soit par l’entremise de la mécanisation (pouvoir se rendre aux antipodes, pouvoir bombarder un ennemi éloigné de milliers de kilomètres) ou de la communication (mon «mur» Facebook, que peuvent consulter instantanément tous les hommes), l’action individuelle peut désormais avoir des conséquences qui vont bien au-delà de l’environnement immédiat.
• La portée des valeurs d’un individu s’étendant au même rythme que celle de son action, la responsabilité individuelle s’accroît et nécessite un temps de maturation plus long.
• L’environnement religieux, qui avait traditionnellement pris à sa charge, tant bien que mal, la poursuite de la tâche éducative fondamentale au-delà du milieu familial, a pratiquement disparu.
• Nos différents projets de sociétés laïques exigent tous, comme données de base et condition de possibilité, que les citoyens soient d’abord et avant tout des hommes, et non simplement des fonctions.
Nous avons donc progressivement, depuis quelques décennies ou quelques siècles (selon les paramètres que nous privilégions pour lire l’histoire), confié à l’école organisée la poursuite de la tâche éducative fondamentale, commencée dans les familles.
Et comment s’en acquitte-t-elle? Eh bien pas du tout… ou alors par la bande, occasionnellement et, pour ainsi dire, par hasard…
5. La faillite fondamentale de l’éducation organisée
L’oeuvre éducative consiste à faire en sorte que les hommes deviennent… des hommes. Or, dans les faits, l’éducation organisée, structurée, pensée et mise en place par la société, dévie toujours de cette fonction principale. En effet, lorsqu’on regarde comment les hommes ont, historiquement, conçu l’éducation, on découvre qu’il est rare, exceptionnel et sans suite, que l’éducation ait été mise au service de la découverte et de l’apprentissage du pouvoir que possède l’homme d’agir librement, culturellement. Ce n’est que très exceptionnellement, selon les hasards de la venue d’un véritable éducateur de l’humanité ou encore de quelque révolution, que l’on trouve des moments dans l’Histoire où l’éducation a vraiment été ce qu’elle devrait être, c’est-à-dire une entreprise au sein de laquelle des hommes faits en aident d’autres à découvrir les sources profondes du phénomène des valeurs, à en comprendre le mécanisme et à en traiter les difficultés.
Dans les faits, l’éducation sert plutôt, non pas à apprendre aux hommes ce qu’est le phénomène des valeurs, mais à transmettre des valeurs toutes faites, toutes définies.
Il faut bien noter que tout système éducatif prend en charge, explicitement ou non, le phénomène strictement humain d’une action dans la nature dont l’origine puisse être non naturelle, culturelle, démontrant par là le caractère essentiel de celui-ci. Mais l’éducation organisée gère ce phénomène en aval, c’est-à-dire en fournissant des définitions des valeurs, et non pas en en dévoilant l’origine.
Autrement dit, on fait l’impasse sur l’essentiel pour parer à ce que l’on tient peut-être pour du plus urgent: transmettre les valeurs courantes, bref «éduquer», au sens large et couramment admis. Ce faisant, on fait en sorte que l’éducation soit toujours au service du «projet de société» ambiant, mais jamais à celui de l’humanité en l’homme. Il en a bien sûr toujours été ainsi: le jeune Grec était éduqué selon les valeurs de la Grèce antique, le moinillon selon celles du christianisme triomphant, l’adolescent d’aujourd’hui selon les valeurs actuelles (nature, respect des valeurs des autres, assistance aux faibles…).
L’éducation organisée se présente donc plutôt comme un système qui détient d’ores et déjà les bonnes définitions, et qui se contente de les inculquer à ceux que l’on «éduque». On peut appeler cela un «projet de société» ou encore une «participation à la citoyenneté»; les plus érudits (ou les plus critiques) feront état de l’«idéologie dominante», mais peu importe le nom que l’on donne, il s’agit toujours du même procédé: faire passer, explicitement ou pas, un «kit» de valeurs préétablies, le fournir prêt à l’emploi. On n’éduque pas pour la liberté, on dresse la liberté.
Si à certaines époques ou a certains moments de l’Histoire cette transmission est explicite et parfois même tyrannique – pensons à l’éducation que l’on dispense dans une société totalitaire, ou encore, plus près de nous, à l’école christianisée que les plus âgés d’entre nous ont bien connue -, notre époque peut sembler se distinguer quant à elle par une éducation moins dogmatique. C’est une grave erreur, qui oublie que l’implicite est, par définition, plus insidieux que l’explicite. Bien avant d’apprendre aux jeunes un métier ou une profession, l’éducation contemporaine «suinte» en quelque sorte les valeurs courantes, avec d’autant plus d’allégresse que, d’une manière générale, elle ignore totalement qu’elle le fait. Qu’il s’agisse de rentabilité, de compétitivité, de réussite (lesquelles, comme je l’ai dit plus haut, ne sont en fait que de fausses valeurs, ce qui rend l’affaire encore plus affligeante…), ou encore du respect des «différences», de la tolérance, de la rectitude politique, de la nature, de l’écologie…, toutes ces valeurs sont transmises implicitement par l’entreprise éducative, et il y a un prix à payer pour tous ceux qui seraient tenté de les contester d’une manière ou d’une autre.
C’est que l’éducation a partie liée avec la société, dont elle constitue le moment fondateur et essentiel. Et on ne peut demander à une culture donnée d’être autre chose que ce qu’elle est, c’est-à-dire, justement, un ensemble de prédéterminations des valeurs. L’éducation érigée en «système» ne peut donc jamais être autre chose qu’une entreprise de transmission des valeurs courantes et, en tant que «système», ne peut jeter un regard sur elle-même; seul l’homme individuel possède ce pouvoir.
En d’autres termes, l’éducation organisée rate toujours l’objectif essentiel de l’éducation… Tare qu’on ne peut vraiment lui reprocher puisqu’il ne peut en être autrement.
Et un examen rapide de l’organisation actuelle des savoirs dans l’entreprise éducative organisée le montre, je pense, assez bien.
6. La distinction actuelle des savoirs et le sort qu’ils réservent à l’éducation fondamentale
Lorsqu’on regarde l’état actuel de l’entreprise éducative dans les sociétés occidentales (et la dichotomie occident/orient a-t-elle encore quelque sens?), on voit une séparation entre deux grands domaines. En français on dit «sciences de la nature» et «sciences humaines». Les anglophones préfèrent généralement parler de «Science» et d’«Humanities». Cette distinction recoupe à peu près l’antique découpage entre «poiétique» («Science») et théorétique / pratique («Humanités»), c’est-à-dire entre le «faire» et l’«inutile». L’un ou l’autre de ces domaines est-il mieux à même de s’acquitter de l’essentiel?
En regard de la tâche fondamentale de l’éducation, on peut estimer que le sort du domaine dit «sciences de la nature» est d’ores et déjà réglé, en tant que celles-ci passent complètement à côté. Pour la première fois dans l’histoire, en effet, les sciences «poiétiques» (les savoirs destinés au «faire», au «produire») ont damé le pion aux disciplines plus traditionnelles. Ce qui aurait semblé, aux yeux de Platon et d’Aristote, mais aussi à ceux d’Augustin, de Thomas d’Aquin, et encore à ceux de Kant, de Hegel ou de Humboldt, comme une entreprise consistant à marcher sur la tête, est devenu la norme. Les techno-sciences sont actuellement un monument à l’ombre duquel les «sciences humaines» apparaissent bien dérisoires. (Bien fait pour ces dernières, pourra-t-on dire, elles n’avaient qu’à ne pas se nommer elles-mêmes de telle manière qu’elles s’obligent, de ce fait, à traîner constamment un complexe d’infériorité, complexe qu’elles ne compensent tristement qu’en se drapant de statistiques…)
Pourquoi «sort réglé» en ce qui a trait aux «Sciences»? Tout simplement parce qu’une activité poiétique n’a pas à s’intéresser aux valeurs. S’il se trouve que c’est parfois le sens des reproches qu’on lui adresse, il s’agit d’un reproche puérile et inutile, si l’on veut bien considérer soit, factuellement, qu’il n’a jamais empêché la marche du «faire», soit, plus philosophiquement, parce que c’est un reproche qui n’a pas de sens. Un savoir servant au «faire» est postérieur à la décision de fabrication, qui elle a pu être valorisée. Lorsque l’on fabrique un autobus, on sait déjà à quoi il servira et on a déjà décidé de s’en servir. Le problème de la valeur de l’acte – c’est-à-dire l’affaire proprement humaine dans l’action – a soit été posée auparavant (dans le meilleur des cas), soit ne l’a pas été du tout, ce qui est de toute façon plus fréquent.
Pourtant, derrière ceux qui font, qui produisent, il y a des hommes, et ceux- ci ne sont pas moins hommes que les autres. Mais ils se trouvent comme emportés dans des activités où le pourquoi de l’action est une question préalablement réglée, ou apparaît comme secondaire.
Voilà pourquoi la réflexion sur le faire ne semble pas pouvoir venir des «Sciences». Il est vrai que sous l’appellation «Sciences» on plaçait autrefois un type d’entreprise de connaissances voulues «pures», c’est-à-dire une volonté de connaître qui ne soit pas a priori déterminée par l’une ou l’autre nécessité de production. Mais, d’une part, la connaissance «pure» peut être étrangère à toute forme de dévoilement des arcanes de l’acte valorisé et, par ailleurs, ce type d’entreprise a pratiquement disparu dès lors que la recherche scientifique actuelle est presqu’entièrement soumise aux dictats de la production.
Il ne resterait donc alors que l’autre domaine, celui des «Humanités», pour prendre en charge l’éducation fondamentale. Le fait-elle?
Les mérites éducatifs des enseignements dispensés par les Humanités et mis de l’avant par ceux qui y dispensent de l’enseignement – ou simplement par ceux qui s’en font les défenseurs – peuvent être regroupés sous trois types argumentaires:
1. Il n’y a pas que les techno-sciences qui puissent être utiles et profitables; les Humanités peuvent l’être également
2. Les Humanités sont la «conscience morale» d’une techno-science sans âme.
3. Les Humanités constituent le seul moyen, le passage obligé qui seul peut permettre d’espérer une «meilleure» société, plus juste, plus tolérante, plus ouverte…
a. Utilité et profitabilité des «Humanités»
Au jeu de l’utilité et de la profitabilité, les Humanités vendent leur âme au diable en se condamnant à ne jamais pouvoir la racheter. Les Humanités ne s’inscrivent pas dans la dynamique du poiétique et, lorsqu’elles le font, c’est au détriment de leur essence. Que l’on pense, par exemple, à l’usage de la psychologie ou de la sociologie dans des entreprises de marketing, ou encore à la gestion des dites «ressources humaines»21. Dans de tels cas, les Humanités sont entièrement au service du faire et l’analyse précédente vaut autant pour elles que pour les techno-sciences.
Dans toute autre perspective, les Humanités représentent un poids financier et structurel jugé inutile par ceux qui sont occupés à produire. On retrouve essentiellement de telles activités dans le secteur «public», où elles permettent de garantir une meilleure stabilité sociale, mais elles sont tenues généralement pour des maux nécessaires, et non pour des éléments participant directement au progrès et à l’avancement des sociétés. Ces disciplines sont d’ailleurs toujours soumises aux aléas circonstanciels, économiques ou autres, et constamment
dénigrées par ceux qui estiment qu’on y déploie en pure perte des énergies (entendre du fric…) qui seraient mieux employées autrement.
Les Humanités ne sont en fait «utiles» et «profitables» que dans la mesure où leur absence totale signifierait une gêne évidente pour l’utile et le profitable… À force de vouloir leur donner des caractères réservés aux savoirs poiétiques, on les dénature (en les appelant, par exemple, «sciences humaines») et on les condamne à être jugées selon les mêmes critères que ceux qui servent à évaluer le faire. À ce jeu-là, on perd… On ne devrait pas employer des arguments qui peuvent se retourner si aisément contre nous…
b) Les Humanités en tant que «conscience morale»
Les analyses et les critiques venues des Humanités et visant le faire aveugle des sciences ne sont pas nouvelles. Elles ont commencé, au plus tard, dès que se sont manifestés les premiers signes de la domination à venir des techno-sciences. Le point culminant, historique, a peut-être été les deux guerres mondiales et l’horreur nucléaire qui en a constitué la fin. Cette prise de conscience a fourni un rôle de chien de garde aux Humanités, qui se sont en quelque sorte trouvé là une «niche»: servir de «conscience morale» à une Science qui semblait ne pas en avoir.
Être la «conscience morale» du faire veut dire: proposer une lecture valorisée de l’action produite et, éventuellement, critiquer les valeurs que cette dernière exprime implicitement. Si cela possède au moins le mérite de faire apparaître les valeurs sous-jacentes d’une action quelconque, on aurait tort de confondre cette conséquence avec l’oeuvre éducative fondamentale. Car cette dernière – qui consiste, rappelons-le, à dévoiler le mécanisme par lequel une valeur peut être la cause d’un acte – n’est pas accomplie du seul fait que l’on orchestre une lutte de valeurs.
Tout acte proprement humain, c’est-à-dire tout acte qui n’est pas simplement la conséquence d’une commande naturelle, est valorisé, et ce, peu importe si les valeurs en cause sont exprimées clairement ou plutôt implicites. Or, il est impossible de donner une signification quelconque à une valeur donnée sans avoir recours à sa négativité, à son contraire. En effet, contrairement à tout autre concept, dont le sens tient à son unité intelligible, la valeur n’est compréhensible qu’en référence à sa négation. Par exemple, il est impossible de suggérer l’idée d’un développement «durable» sans une référence automatique au «non durable» (ou à l’éphémère), tout comme il l’est de parler de «courage» sans une référence signifiante nécessaire à la «lâcheté». Puisqu’il n’existe pas de définitions universelles des valeurs (au grand dam de Socrate…), et que toute valeur positive est interprétée par opposition à la contre-valeur (ou négative, par exemple, justice et injustice), tout acte valorisé – et interprété comme tel – donne naissance automatiquement à une lutte des valeurs, plus
exactement, fait potentiellement apparaître dans la sphère de son interprétation toutes les définitions possibles, et effectivement apparaître toutes les définitions proposées.
La conséquence est claire, bien que rarement comprise: dès que le faire est interprété en termes d’acte valorisé il engendre automatiquement une critique du faire. Il ne reste plus, par la suite, qu’à voir qui endossera l’un et qui l’autre. Que ces rôles semblent s’être séparés au point où l’un (les «Sciences») fait et l’autre (les Humanités) critique ne doit pas nous faire oublier que si une telle séparation des savoirs n’existait pas, le faire engendrerait sa propre critique de toutes manières.
L’expérience montre par ailleurs que, progressivement, tous ces combats finissent par gagner un équilibre satisfaisant, au moins jusqu’à ce qu’ils reprennent… On «trace» la provenance du boeuf afin d’éviter les malheurs de la vache folle, on retire le cadmium de la peinture jaune et l’amiante des murs, on développe «durablement», on produit de l’énergie «propre»… Le faire absorbe progressivement les résultats des combats éthiques et, en cela, témoigne toujours des valeurs courantes. Et lorsque cette critique du faire ne vient pas des Humanités, elle vient d’ailleurs, tout simplement.
Ce n’est donc pas parce qu’elles tiendraient un rôle d’interlocuteur critique face aux Sciences et aux techniques que les Humanités font pour autant oeuvre éducative véritable. Il y a certes un mérite à être l’instigateur d’un débat éthique, ou encore à l’entretenir, mais il importe d’abord de comprendre pourquoi et comment de tels débats peuvent exister, compréhension qui n’est pas fournie du simple fait qu’on y participe. Pour celui que l’on prétend éduquer, ces luttes, dont il ne connaît pas la raison d’être, créent un climat confus qui finit par le persuader simplement que «toutes les valeurs se valent», ce qui est sans conteste la pire «éducation» que l’on puisse recevoir…
c) Les Humanités, condition de possibilité de la réalisation d’une «meilleure» société
Avec le dernier de nos trois groupes d’arguments, nous approchons cependant plus près du vrai problème. En gros, cet argumentaire énonce qu’une société plus juste, plus tolérante, bref meilleure, ne peut être réalisée en se contentant de laisser faire les techno-sciences. L’homme est plus que ça; il veut être heureux, il lutte pour diverses valeurs auxquelles il croit. Tout absorbée dans sa production, la techno-science ne donne pas à l’homme ce qu’il désire. Elle ne lui procure pas le bonheur. Bref, on a affaire ici à une analyse plus large, qui semble mettre en cause un peu plus que l’affairisme quotidien.
Qu’entend-on dans ce genre d’argumentaire? Bonheur plutôt que malheur… justice plutôt qu’injustice… meilleure plutôt que pire… Et puis, pourquoi pas, beau plutôt que laid, prometteur plutôt que désespérant… Tout le monde est
pour la vertu… mais on attend toujours des définitions plus précises… Que veut dire ici «bonheur», ou «justice», ou «mieux»? Allons-nous croire que ceux qui sont investis dans les disciplines poiétiques sont pour le malheur? Pour l’injustice? Pour le pire? Il est absurde, pour les Humanités, de croire que les techno-sciences veulent le malheur ou l’injustice…
De fait, lorsque ce genre de critique se fait valoir, ce qu’elle dit en propre, explicitement ou non, c’est que les valeurs actuelles ne lui conviennent pas. Et donc, explicitement ou non, ce qui est alors proposé est une simple correction des valeurs.
Or, là non plus on ne fait pas oeuvre éducative… Le remplacement d’un «kit» de valeurs donné (qu’on l’appelle « idéologie dominante », ou « projet de société », ou « vision du monde », ou « vision de l’homme »…) par un autre, c’est l’histoire même de l’humanité. Et au travers de tous les remplacements d’un «kit» par un autre, qui donc s’intéresse au phénomène même de l’existence de ces «fantômes», qui sont néanmoins les forces obscures au nom desquelles nous pouvons agir?
L’homme est culturel et, de ce fait, agit au nom de valeurs. L’éducation est une affaire essentielle car, comme le disait Kant, sans éducation, il n’y aura pas d’homme. L’affaire essentielle de l’éducation consiste à montrer à chaque homme ce que sont les valeurs, comment elles naissent et quel usage on en fait.
Au lieu de cela, nous avons, historiquement, une éducation organisée qui est relative et soumise à nos projets, c’est-à-dire qui est toujours principalement occupée à transmettre des valeurs déjà définies, plutôt qu’à instruire l’homme quant à son pouvoir.
Il n’y a qu’à considérer les multiples réformes et réformettes de l’éducation organisée pour s’en convaincre, lesquelles se succèdent à un rythme effréné depuis quelques décennies. Il s’agit toujours de redistribuer les cartes un peu autrement, le faisant, à chaque fois, au nom de celui qui, à ce moment-là, « tire le plus fort sur la couverture », que ce soit au hasard des changements de gouvernements ou des soubresauts qui énervent les milieux économiques. Il faut toujours que l’école « reflète » les valeurs courantes, et comme notre monde change vite, des nouvelles « réformes » apparaissent nécessaires alors même qu’on n’a pas fini d’installer la précédente…
Nous ne pensons l’éducation que relativement à nos projets de société, qui ne sont jamais que des portraits de nos valeurs. Et pendant ce temps, nous ne maîtrisons rien du phénomène fondamental qui permet aux valeurs d’avoir un tel impact.
Nous pensons la nécessité de l’éducation comme relative. Il faudrait la penser comme une nécessité absolue.
7. Le loup dans la bergerie
Ni les «Sciences», ni les «Humanités» ne semblent pouvoir s’acquitter de la tâche fondamentale de l’éducation. Alors quoi? L’éducation raterait donc toujours son objectif essentiel?
Ne désespérons pas encore, car il s’agit bien ici de l’éducation structurée, encadrée par la société qui la met en oeuvre et la supervise. Peut-être y a-t-il, ou peut-il y avoir, un «loup dans la bergerie»…
En fait, c’est sous l’emprise d’une éducation systématisée qui ne peut que transmettre aux jeunes générations les valeurs dominantes que s’effectue l’oeuvre éducative véritable. Elle s’ouvre sous la forme de la relation parent / enfant, relation à laquelle se substitue ensuite celle du «maître» et de l’«étudiant». Si le maître est, de nos jours et depuis déjà plusieurs siècles, un fonctionnaire, et qu’à ce titre il a le devoir de respecter la charge qui lui est collectivement confiée, il est aussi, d’une manière plus large, homme et éducateur. Lui est ainsi conféré un double devoir qui comporte des caractères contradictoires: celui de transmettre, au nom de la société à laquelle il appartient et qu’il représente, certaines valeurs, et, cette fois au nom de sa dignité d’homme et de la profession qu’il a choisie, de dévoiler le processus fondamental suivant lequel les valeurs naissent22. Ce faisant, il est à même de mettre l’étudiant sur la piste du secret essentiel, dont la connaissance est seule à même de permettre à un homme d’atteindre la dignité de son essence, et qui culmine notamment par ce constat capital, et, pour certains, dérangeant: peu importe les valeurs d’une société donnée, elles ne sont ni vraies, ni fausses… Du coup, bien entendu, ceux qui pensent que nos valeurs sont nécessairement les bonnes s’en trouvent fort déçus, et parfois amers…
Théoriquement, tout homme digne de ce nom peut réaliser la tâche éducative fondamentale. Parmi ceux-ci, les enseignants et les professeurs sont évidemment ceux à qui on demanderait expressément d’y pourvoir.
Mais la «formation» actuelle, l’école telle qu’on l’organise de nos jours, fragmentée en une multitude de champs spécialisés, ne facilite pas les choses. Il serait trop long, ici, de débattre de toutes les conséquences fâcheuses de cette malheureuse tendance, mais quelques brèves remarques m’apparaissent nécessaires:
• la formation spécialisée en vue de l’apprentissage d’un métier ou d’une profession quelconque, bien que requise de nos jours, ne constitue pas la tâche première et fondamentale de l’éducation;
• cette spécialisation intervient beaucoup trop tôt dans le processus éducatif, faisant en sorte que l’unité et l’intégrité du fonctionnement de la rationalité ne sont pas perçues;
• la spécialisation des champs d’études identifie chacun de ceux-ci comme raison d’être de l’étude, ce qui éloigne encore l’étudiant de l’éducation fondamentale;
• elle laisse croire à l’enseignant que sa tâche principale est entièrement circonscrite dans et par le champ spécialisé, ce qui conduit à des conséquences similaires;
• elle fait en sorte que l’on engage, à titre de professeurs, des spécialistes qui n’ont pas nécessairement les qualités requises pour éduquer (au sens large).
Au sein de cette pléthore de champs, l’éducation véritable ne peut se réaliser que… par hasard, et à partir d’actes éducatifs qui ne peuvent que venir se greffer en marge des cursus officiels. Il ne fallait pas s’attendre à ce qu’il en aille autrement puisque, comme j’ai tenté de le montrer, l’école organisée rate toujours l’objectif fondamental de l’éducation. C’est donc dire, en résumé, et même si cela peut sembler curieux, que cet objectif ne peut être atteint que malgré l’organisation de l’éducation…
À ce titre cependant, certaines activités ou, comme on aime à le dire de nos jours, certains «programmes» éducatifs se prêteront davantage à une telle possibilité.
Réduites lorsqu’il s’agit de champs spécialisés destinés aux apprentissages du faire, les chances de réaliser l’éducation fondamentale augmentent lorsqu’il s’agit des «Humanités», à la condition expresse qu’il ne s’agisse pas alors de «sciences humaines» se prenant elles-mêmes au piège de la techno-scientificité.
Là où elles restent cependant les meilleures – sans pour autant qu’il y ait là quelque garantie – c’est du côté de ce que l’on nomme malencontreusement (au Québec) la «formation générale», et à propos de laquelle il ne s’agit pas tant de se demander si tel «programme» est meilleur que tel autre, mais, plus fondamentalement, dans quelle mesure il facilite l’accès aux «compétences» suivantes:
1. Apprendre à raisonner; s’y retrouver parmi la nature complexe et nuancée des concepts; les utiliser à bon escient dans des argumentaires valides.
2. Étudier l’histoire, s’imprégner de la culture, c’est-à-dire de l’homme, de ce qu’il a été, de ce qu’il a fait.
3. Réfléchir sur la nature humaine, définir l’homme, le distinguer grâce à ce qu’il est en propre tout en reconnaissant ce qu’il partage par ailleurs avec d’autres vivants.
4. Comprendre l’insigne caractère ontologique qu’il possède et qui le montre capable d’agir dans la nature à partir de causes non naturelles – phénomène qui ressortit à la problématique globale des valeurs.
5. Assumer le fait que, peu importe à quel homme on s’adresse, l’individu est toujours une fin en soi, jamais un moyen, et que l’objectif de tous est la «vie heureuse», que chacun définit selon son loisir, sa liberté et sa dignité.
Ce programme, tout système éducatif devrait l’assumer, mais il ne le fait pas. Ce programme, tout maître peut le prendre à sa charge (s’il est lui-même un homme…), mais ce n’est pas toujours indiqué dans sa «définition de tâche». Parmi toutes les micro-disciplines qui figurent désormais dans les cartons de l’Éducation Nationale, la philosophie, l’histoire, les arts et la littérature sont celles qui offrent les meilleures conditions pour que se réalise l’éducation véritable, à la condition expresse qu’aucune ne soit soumise aux dictats d’un «programme» précis, ce qui transforme alors une possibilité de réflexion en une simple entreprise d’acquisition de compétences dont les applications sont prédéterminées.
Mais quelques cours de philosophie ou de littérature au Cégep ou au Lycée, ce n’est pas assez. C’est bien loin d’être assez. Pour maximiser les chances de réaliser une éducation véritable, il faudrait de toute urgence bonifier ce «programme». Il faudrait, surtout, faire en sorte qu’il s’étende dans le temps. Il faudrait qu’il commence plus tôt23 et se continue plus longtemps, se frayant un chemin jusqu’à tard à l’université.
Comme l’espérait Humboldt à la création de l’Université de Berlin, il faudrait que l’université (élargissons: l’éducation comme telle, incluant l’université…) soit une entreprise de culture générale qui ne chercherait pas – en tout cas pas d’abord – à dispenser une formation professionnelle…
À défaut de satisfaire à cette exigence, peut-être pourrions-nous à tout le moins nous assurer de garder à cette «culture» une place raisonnable et de la tenir dans l’estime qu’elle mérite.
Yvon Corbeil, PhD, Professeur au Département de Philosophie du Cégep de Trois-Rivières de 2002 à 2019. Son site personnel, Queue de mots : cyllycyl.wixsite.com/queuedemots



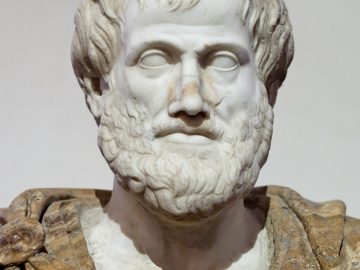

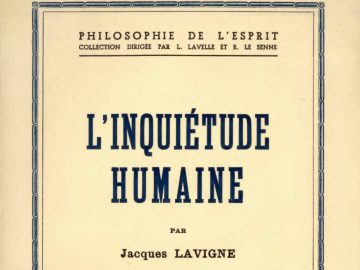

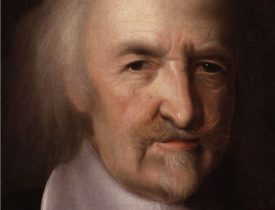







J’aurais apprécié un petit résumé de 10-15 lignes au début qui présente l’objectif visé par l’article. Il me semble que lorsque l’on ajoute »PhD » après son nom on indique que le doctorat concerne le sujet de l’article traité. Est-ce le cas ? Ne faudrait il pas indiquer le domaine du PhD : chimie, poèsie, philo …
Bonjour Monsieur Leroux,
Le Ph.D. d’Yvon Corbeil est en philosophie. Ses études post-doctorales aussi, d’ailleurs.
Merci ! Même si c’est avant tout la valeur de l’argumentaire qui doit avoir prévalence, nous aurions dû le préciser. Donc, merci.