Où sommes-nous ?
De la transmission des valeurs. [*]
(Janvier 2006)
Patrice Létourneau
Professeur de philosophie
au Cégep de Trois-Rivières
Je remercie la Société des Écrivains de la Mauricie pour l’invitation à cette rencontre, autour de la question de la transmission des valeurs. Il y a moins d’un mois, c’était Noël. Si on a mis les pieds dans un centre commercial après cette fête, on aura remarqué que les échanges/retours de cadeaux ont été nombreux. Cette image m’est revenue à l’esprit à la lecture de la question Qu’avons-nous à offrir aux jeunes ? Si nous souhaitons offrir quelque chose, ce serait bien que ce ne soit pas un de ces « cadeaux » mal adaptés. Il m’a donc semblé utile d’essayer avant tout de nous situer, de tenter d’entrevoir quelques repères composant notre contexte.
D’ailleurs, il convient de le dire directement, la question des valeurs est aussi la question des repères. Par conséquent, je vais d’abord m’intéresser à cette autre interrogation : Où sommes-nous ? Je ne suis cependant pas celui qui fait le meilleur usage des cartes : des détours sont donc à prévoir dans ce repérage, mais après tout, si ça peut vous rassurer, évoquons ce qui est probablement devenu des lieux communs : le chemin importe plus que le point d’arrivée ; et il faut parfois se perdre pour se retrouver.
Débutons donc…
Notre paysage
En prévision de cette table ronde, et afin de mieux me situer, j’ai relu une analyse récente que la sociologue Andrée Fortin a faite de l’éditorial du premier numéro des revues québécoises fondées dans les dix dernières années (un corpus d’une cinquantaine de revues) [1]. Il n’est peut-être pas inutile de mentionner le titre de son article : De l’intellectuel désincarné et d’un Québec évanescent. Globalement, qu’est-ce qui ressort de son analyse ? S’interrogeant sur ce que veulent « faire entendre les fondateurs de revues », madame Fortin mentionne que :
« En un sens, on a l’impression qu’ils ne veulent pas tant prendre la parole que de créer un « dispositif » permettant la prise de parole (créer un espace de la parole) ; mettre en place une procédure permettant le pluralisme, mais ne le garantissant pas. Le pluralisme visé demeure abstrait, car nulle part n’est précisé ce autour de quoi se met en place ce pluralisme : question nationale, mondialisation, genres, équités…? » (page 36).
Et plus loin, elle ajoute en guise de conclusion :
« Fait-on des revues pour les auteurs plutôt que pour les lecteurs ? Du corpus ici étudié se dégage l’image générale d’intentions sans cause, d’une pensée sans objet, d’intellectuels désincarnés, sans ancrage temporal ni spatial fort, et d’un Québec évanescent. » (page 37).
Après la lecture de l’analyse de la sociologue, on est porté à ne pas être des plus optimistes quant aux revues fondées dans les dix dernières années. Sous l’émotion, on est enclin à se demander si, en généralisant un tant soit peu, ne se dégage pas de ce corpus des dix dernières années la prévalence d’un discours creux.
Que doit-on en penser ? Que peut-on en penser ? Qu’une revue d’idée ne se donne pas d’objet d’analyse a priori est-il nécessairement problématique ? Ça ne me semble pas certain. Nommons un de mes « ancrages » : je suis professeur de philosophie, au Cégep de Trois-Rivières – et pour l’éventuelle question de repère temporel : j’ai 30 ans. Comme vous le savez sans doute, la philosophie peut avoir ceci de déstabilisant pour les néophytes : c’est qu’elle n’a pas d’objet d’étude particulier. La philosophie est d’abord une démarche, qui se caractérise par une réflexion critique pouvant toucher à peu près tous les sujets, pour peu que la problématisation soit de nature fondamentale. Lorsque je regarde le corpus des revues analysées par la sociologue, je remarque que certaines sont issues de milieux près de l’univers philosophique, par exemple les revues Argument (où madame Fortin a publié son article), Combats et Les Cahiers du 27 juin. Que des revues d’idées soient créées, dans les dix dernières années, sans qu’un sujet particulier de réflexion leur soit attitré a priori me semble pouvoir présager autant du meilleur que du pire – peut-être est-ce là quelques germes de la philosophie qui éclorait enfin [2] dans le sol québécois, mais peut-être aussi qu’il n’y a là que l’expression d’un vide de notre ère. Sans doute y a-t-il des deux.
Quant aux intentions des fondateurs de ces revues, ce qui ressortirait du corpus des dix dernières années, ce serait d’abord une volonté de mettre en place un pluralisme pour lui-même – ou un « pluralisme abstrait ». Encore là, que peut-on en penser ? Il est vrai qu’un « espace de parole » ouvert au pluralisme, sans plus de spécification, peut être le lieu d’une multitude de pratiques, bien hétéroclites – après tout, le simple bavardage peut aussi avoir lieu dans un espace de parole ouvert à la pluralité des points de vue.
Dans l’émergence de revues, sans objet a priori, qui se veulent des lieux de dialogues pluriels, il y a sans doute là le signe qu’on souhaite rejeter la tentation des idéologies toutes faites, de même que celle des discours corporatistes ou hautement polarisés, ce qui me semble de bon augure pour l’enracinement d’une réflexion ouverte. Si on peut s’en réjouir, ne soyons pas dupes non plus. Il faut bien reconnaître que parallèlement, le « dialogue pour le dialogue » est probablement devenu l’une des idées largement valorisée à notre époque, et ce de manière un peu fourre-tout. À partir du moment où on en est conscient, il serait dommage de simplement vouloir tout rejeter en bloc. Il serait préférable de tenter de ne pas se laisser berner simplement sous prétexte qu’il y a les mots dialogue, échange ou pluralisme, et essayer, plus humblement, de juger sur pièce de la valeur des propositions – ce qui peut sans doute, là aussi, être le lieu du meilleur comme du pire.
S’il est préférable de juger sur pièce, on comprendra qu’il est souhaitable d’éviter les crispations de postures. J’aimerais mentionner l’une de ces postures, aux conséquences paradoxales, qui me semble récurrente dans l’horizon actuel : une tentation vers un tolérationnisme (ou si l’on veut, une posture de tolérance agressive). Les expressions de « tolérationnisme » et de « tolérance agressive » ne sont pas de moi, elles sont de Gérald Allard, qui les utilise dans un article intitulé Pourquoi et comment la philosophie disparaîtra [3]. Ces expressions ne font bien sûr pas référence à la tolérance en tant que vertu, mais plutôt à l’attitude selon laquelle on ne peut juger rien ni personne, parce que tout serait, au fond, équivalent – à chacun sa « vérité », en somme. Soit. Ce phénomène a beau être présent, pour peu qu’on tende l’oreille, on ne manquera pas de remarquer que ça n’empêche pas les jugements sur autrui – de même pour les préjugés et les stéréotypes, qui ne manquent pas.
Essayons d’y voir un peu plus clair. Voici un extrait de ce que nous en dit Gérald Allard dans son article :
« La confusion du discernement et de la discrimination est liée au phénomène fascinant de la tolérance agressive. Tolérer ne veut plus dire reconnaître que telle ou telle opinion a droit d’être portée […] Tolérer veut [maintenant] dire accepter sans questionner. La paresse intellectuelle et l’impérialisme qu’elle soutenait (« notre pensée est la seule qui puisse être pensée ») ont été remplacés par la paresse intellectuelle de la tolérance tous azimuts et son nouvel impérialisme (« tu ne peux pas examiner avec l’intention de juger sur la vérité ou la bonté ou la justice des idées, des cultures et des hommes »). » (page 105 ; ou voir l’article en ligne).
En quelque sorte, ce « tolérationnisme » est lui-même devenu un nouveau préjugé – bien que celui-ci soit certes utile pour le dialogue. On peut considérer que cette problématique se rattache à celle du « relativisme mou (ou paresseux) » – le « relativisme mou » étant cette croyance selon laquelle toutes les idées, valeurs et opinions se valent. On remarquera que s’il est vrai que toutes les opinions se valent, c’est qu’elles ne valent rien, qu’elles n’ont pas de valeur. Il pourrait sembler à première vue que le « relativisme mou » est une position faite d’humilité en stipulant que les opinions se valent toutes, mais en fait il y a plutôt là un refus d’assumer ses propres jugements. Ce n’est pas être modeste, mais être prétentieux que de décréter que le bien-fondé de ses propres opinions ne peut être jugé. Peut-être est-il utile de rappeler qu’à la base, juger c’est d’abord établir un lien entre un sujet et un prédicat. En cela, juger est un acte quotidien. Ce vin est bon, l’hiver est agréable, Kundera est un écrivain important, la circulation est fluide, sont des types de jugement.
Dans les marécages du « relativisme mou », une position « subjectiviste » apportera cette remarque : les jugements ne seraient rien de plus que l’expression de goûts (de la subjectivité), et comme des goûts et des couleurs on ne doit pas discuter… Ainsi donc, on n’aurait pas le droit de juger autrui, mais on pourrait s’exprimer à son sujet. Par exemple, je ne devrais pas dire qu’autrui est agressif ou manipulateur, mais je pourrais dire que je le trouve agressif ou manipulateur. Et mon opinion serait alors nécessairement vraie : elle serait conforme à ma pensée. Évidemment, selon cette croyance, on ne peut pas être à la fois sincère et idiot. L’honneur est sauf à tous coups. Mais surtout, on peut ainsi toujours prétendre qu’on ne juge pas : on aime ou on haït, on a des passions et des ressentiments, mais présumément qu’on ne juge pas.
On a du cœur ou de la rancœur, mais pas nécessairement de tête. Visiblement, il est à la fois possible de clamer qu’on ne doit pas juger les idées ni les opinions, et de s’adonner aux attaques ad hominem les plus basses. Ce n’est pas parce qu’il « ne faut pas juger » qu’il n’y a plus de punching bag public. Une fois l’écran de fumée du « tolérationnisme » levé, les préjugés et les stéréotypes peuvent continuer à proliférer aisément grâce au « subjectivisme » – qu’il ne faudrait d’ailleurs pas juger. La machine est bien huilée, semble-t-il.
Qu’est-ce que la tolérance ? Si on y songe, on pourra reconnaître qu’à tout le moins, la tolérance implique qu’il y ait à la fois des différences et de l’intolérable dans celles-ci. Dire que tout se vaut ou prétendre que tout est du pareil au même, ce n’est pas faire preuve de tolérance, mais d’indifférence – d’indifférence tant à l’égard des idées qu’à l’égard d’autrui ! À quoi bon vouloir faire intervenir la tolérance si tout se vaut, si tout est équivalent ? Qu’est-ce que la diversité dans un pareil aplanissement des différences ? La tolérance est une vertu seulement dans la mesure où tout n’est pas indifférent.
En travaillant avec les concepts « vérité » et « opinion », une étudiante – très perspicace, soit dit en passant, et j’assume ce jugement – m’indiquait qu’elle ne croyait pas vraiment que toutes les opinions puissent avoir la même valeur, mais par contre que s’il n’y avait qu’une vérité, alors probablement que bien des gens n’oseraient pas dire leur opinion. Elle avait visé juste. Il y a sans doute une crainte bien humaine de se faire dire que ses jugements ou raisonnements sont erronés. C’est tout de même compréhensible, surtout en contexte d’apprentissage – et comme on apprend toute notre vie… En creusant un peu, on pourrait trouver là un sens fécond à la tolérance, qui ne soit pas que simple « tolérationnisme ». On pourrait sans doute la rattacher à un certain scepticisme modéré, ou du moins une probité intellectuelle qui ne serait ni un désaveu de la notion de vérité, ni un cynisme à l’égard de celle-ci ou de nos capacités, mais plutôt une position plus humble de reconnaissance à l’effet que si nos croyances peuvent être fortes, nos certitudes peuvent être fragiles.
Pour le dire simplement, il me semble qu’il y a dans le « relativisme mou », tout comme dans le « tolérationnisme », le symptôme d’un désarroi d’une pensée qui cherche vainement à se dire, qui ne parvient pas à se déplier. Est-ce parce que la pensée n’est pas suffisamment exercée ? Est-ce dû à un penchant naturel vers la paresse intellectuelle ? Est-ce l’effet de complaisances ? Est-ce une fatalité ? Est-ce dû à une faiblesse de la volonté ? Difficile à dire précisément – et sans doute qu’il y a un peu de tout cela. Sans entrer ici dans ces considérations, on peut tout de même dire que la difficulté à déplier sa pensée est compréhensible. On a beau avoir parfois l’impression que « penser par soi-même » est devenu un slogan publicitaire, soyons franc : à moins de supposer que « penser par soi-même » soit à peu près équivalent à tout ce qui nous passe par la tête (et en quelque sorte revenir à la croyance selon laquelle toutes les opinions se valent – sont sans valeur), il faut être honnête et reconnaître qu’habiter sa pensée, c’est souvent difficile. Parfois ça nous pousse, parfois ça nous entraîne, parfois ça nous épuise, parfois ça nous libère, mais c’est rarement facile – sans compter que la pensée ne tournant pas à vide et nécessitant par le fait même des points d’appui, ça fait en sorte que notre pensée comporte l’écho de tout un paysage d’autres pensées, rendant fuyant l’assurance qu’on ait pleinement été au bout de « sa » pensée en assumant de manière critique les imbrications d’échos. Ressentir, en revanche, n’est peut-être pas toujours agréable, mais c’est quelque chose d’accessible ; alors que déployer sa pensée, la déplier et l’articuler est moins aisé. Si cela est vrai, s’il y a dans le « relativisme mou » le symptôme d’une pensée qui ne parvient pas à se déplier, que fait-on ? Fait-on la morale en répétant simplement le mot d’ordre : « pensez par vous-mêmes » ? Il me semble que si le constat est juste, alors il faut tenter dans la mesure de notre possible de fournir des points d’appui où poser le pied, d’offrir des prises où s’agripper.
Comment y répondre convenablement ? S’il y a dans le « relativisme mou » et dans le « tolérationnisme » des parcelles du désarroi que j’ai mentionné, alors la problématique est globale. Loin de concerner que la question de la tolérance (ou de la citoyenneté), il s’agit d’un appel qui en définitive touche tout autant aux interrogations sur les visions du monde que les questionnements sur les conceptions de l’être humain, les rapports aux valeurs, notre place au sein d’un sédiment de sens, nos rapports à autrui, etc., etc. Bien que la complaisance du « relativisme mou » puisse être bien plus confortable, il y a là un signal auquel on ne doit pas demeurer sourd.
Cependant, ce qui a été dit sur le « relativisme mou » et le « tolérationnisme » ne doit pas faire oublier les pièges inverses : les dogmatismes, les réductionnismes et les Absolus. Le « tolérationnisme » a beau sembler en façade plus doux que l’intolérance, il n’en demeure pas moins que le faux dilemme qui nous enjoindrait à choisir entre l’un ou l’autre serait comme nous solliciter à choisir entre Charybde et Scylla. Ce qu’il faudrait à cet égard, c’est davantage un approfondissement méticuleux des interrogations, plutôt que la simple recherche de prises de postures. On peut espérer que la place qui serait ainsi faite à la culture ne serait ni celle se réduisant à une simple consommation, ni celle d’un regard à distance, mais qu’elle tendrait davantage vers une appropriation, quelque chose que l’on habite, qu’on enveloppe de nos mains [4].
Les vases communicants
Je reviens sur la question qui m’a été posée : Que pouvons-nous offrir aux jeunes ? De prime abord, disons qu’il faudrait offrir un peu de notre présence. Au Québec, on déplore parfois que la place accordée aux intellectuels dans les débats publics se rétrécît comme peau de chagrin [5]. Les intellectuels reçoivent peu d’écho au Québec – et à plus forte raison s’ils sont eux-mêmes originaires du Québec, seront tentés de rajouter certains. De même pour la place faite aux émissions littéraires et culturelles, qui fond comme neige au soleil, et ainsi de suite. Je serais presque tenté de dire à la blague que si l’on veut conchier l’existence, nous ne serons pas pris au dépourvu, car nous avons des caves bien garnies.
Cela étant dit, je dois avouer que je me sens parfois mal à l’aise face à ces récriminations. Non pas que je songe à les contester, mais plutôt parce qu’il me semble qu’en revanche la présence sur internet est quant à elle peu exploitée par les intellectuels, écrivains et autres acteurs québécois soucieux de culture. On est maintenant rendu au Web 2.0 : en simplifiant, disons que ça signifie qu’une connaissance précise des langages de programmation n’est plus essentielle pour avoir pignon sur Web, et ça signifie aussi que les contenus deviennent dynamiques. Cette donne fait non seulement en sorte de rendre la publication Web accessible pour tous, mais elle s’accompagne aussi d’une mobilité des contenus pouvant être aisément suivis (et rassemblés) grâce à des fils [6], ce qui fait que la concentration de la diffusion n’a plus la même importance [7] – le façonnement semble davantage être à l’image d’archipels. Je ne veux pas faire dériver cette discussion vers l’univers des TICs, mais j’estime important de mentionner ces considérations, dans la mesure où ma question de départ était « Où sommes-nous ? » et que ça fait parti du paysage, sans oublier qu’à la question « Que pouvons-nous offrir aux jeunes ? », j’ai évoqué notre présence – il serait dommage que ce ne soit un rendez-vous manqué.
Dans cette optique, je proposerais à chacun de réfléchir à ce qui suit. Si je mentionne l’Université de Paris 8, peut-être pensera-t-on à ce foyer du post-modernisme qu’elle a constitué, ou pensera-t-on à certains précurseurs des arts technologiques. Qu’on en apprécie les travaux ou qu’on les juge sévèrement, on y reconnaîtra certains contours contemporains qui s’y sont esquissés. Si je mentionne l’École de Francfort, très probablement pensera-t-on alors aux penseurs de la Théorie critique. Il faut avoir conscience que les Départements de nos cégeps et universités sont des structures essentielles à la vie des idées, tout comme votre Société des écrivains l’est. Il y a dans toutes ces entités des milieux de vie des idées ! Mais nous les connaissons malheureusement si peu. Quelles sont leurs atmosphères ? Leurs souffles ? Leurs sèves ? Ne pas être désincarné, c’est aussi tout ça.
Pensons à ce que peut signifier que leurs contours se laissent entrevoir sur le Web. Pensons à ce que peut signifier que des écrivains (individuellement ou en regroupement) y aient une présence et que leur parole s’y articule là aussi. Cela dit, il ne faudrait cependant pas penser à le faire parce que ce serait la mode, ni l’envisager simplement parce que l’on serait soi-disant à une ère des communications. Il est sain, je crois, de se garder des réserves à cet égard. Mais en même temps, ne pas être désincarné, c’est aussi permettre que transpirent l’atmosphère et la sève des milieux de vie des idées [8].
En pensant à la présente rencontre, je feuilletais le Dictionnaire des écrivains de la Mauricie (Écrits des forges, 444 pages), réalisé par Réjean Bonenfant et le président de votre Société d’écrivains, Gérald Gaudet. Vous connaissez cet ouvrage, mais j’espère que vous me permettrez de prendre tout de même quelques instants pour lire cet extrait de la quatrième de couverture :
« La région, c’est le lieu des origines, celui qui façonne et construit. C’est le lieu de l’accueil de l’étrange et de l’étranger, le lieu de l’ouverture aux autres. C’est le lieu centrifuge des œuvres qui partent à la conquête du monde. C’est un milieu de vie, « un » centre du monde où se joue et se déjoue, dans la quotidienneté, l’avenir de l’être humain. »
« […] un milieu de vie, « un » centre du monde où se joue et se déjoue, dans la quotidienneté, l’avenir de l’être humain. » Lorsqu’on aborde la question de la transmission des valeurs, il convient de garder ça en mémoire, la transmission est une affaire de présence, de présences partagées autant que de prégnance à des lieux. C’est en songeant à ça que je suggérais la possibilité que les pores des essentiels milieux de vie des idées transpirent aussi dans cet autre espace virtuel. Non pas comme substitution à d’autres manifestations, surtout pas, mais en l’envisageant comme faisant partie de vases communicants. Bien entendu, il convient de simultanément se dire et redire l’importance de la chaleur des interactions directes, en chair et en os – mais les gens présents à un événement organisé par une Société d’écrivains doivent bien savoir que présence « réelle » et « virtuelle » ont des limites floues lorsqu’il est question de présences signifiantes.
Voilement et dévoilement
Ayant évoqué le risque que peuvent représenter les postures, j’ai avant tout tenté d’identifier quelques repères composant notre paysage, de même que j’ai évoqué la transpiration de notre présence. En terminant, j’ajouterais quelques mots sur l’un des aspects de la manifestation d’une présence dans cet horizon, en considérant rapidement la question de l’interaction entre voilement et dévoilement.
Non pas parler de l’absence, mais bien du voilement lors de manifestations de soi pourra paraître étrange à première vue. Regardons ça de plus près. En évoquant cette question, en fait, je n’oublie pas la sous-question : « Quelle place faisons-nous ainsi au livre ? » Dans Des corps et du papier (Leméac Éditeur, 2005), Marc Chabot souligne l’érotisme de la littérature. Au-delà des genres, toute littérature aurait un caractère érotique. Pour bien comprendre cette affirmation, peut-être convient-il de préciser que l’érotisme de la littérature est avant tout à comprendre dans les termes d’un appel de l’autre – appel de l’autre et de l’altérité qui s’effectue dans un jeu qui à la fois voile et dévoile. En un sens, pourrait-on aussi dire, l’écriture recèle quelque chose d’intime – à commencer par l’intimité d’une pensée. Est-ce qu’on oubliera alors que les littératures sont toutes tissées de ces jeux de voilement et de dévoilement ? On ne dit jamais tout ce que l’on voudrait dire en même temps que l’on dit toujours plus que l’on ne voudrait dire. On n’y échappe pas.
Quels que soient les avis et les comportements des écrivains à l’égard de l’intimité, il demeure que l’étoffe de leur travail en est tissée : les efforts dont témoignent leurs œuvres impliquent un effet chaque fois unique des jeux de voilement et de dévoilement, des dits et des non-dits – et d’un style particulier de rapport au vécu. L’écrivain peut être impudique ou ne pas se soucier de cette valeur, mais il connaît cette étoffe – il a dû s’y mesurer.
En quoi cela devrait-il être d’intérêt aujourd’hui ? Pourquoi devrait-on se soucier d’exemples où se joue le voilement et le dévoilement ? J’ai mentionné qu’il y avait à notre époque une valorisation de l’idée de « dialogue pour le dialogue », et ce, parfois de manière un peu fourre-tout – mais j’ai aussi mentionné que l’idée des dialogues n’était pas à rejeter en bloc pour autant. Au passage, j’ai souligné l’accessibilité de la publication Web, dont la facilité et la rapidité comportent d’indéniables intérêts comme leurs revers – l’instantanéité n’empêchant d’ailleurs pas que des inscriptions puissent perdurer, via l’indexation aux fichiers cache de Google par exemple, ou encore via www.archive.org. Parallèlement, on pourra aussi dénicher des cas qui nous incitent à penser que la frontière entre vie privée et vie publique s’évapore, se laisse moins aisément discerner. Des exemples où se tissent le jeu du voilement et du dévoilement ne peuvent-ils rien nous apprendre à ces égards ? Les livres [9], qui commandent bien souvent un retrait de l’instantanéité, n’ont-ils pas de par leur étoffe et leur action, bien autant que par ce qu’ils disent et font vivre, une possibilité de nourrir quelques réflexions à ce sujet, sinon quelques habitus ? Les écrivains, familiers de l’exigence de l’écriture, n’ont-ils pas une expérience de ces jeux et enjeux ? Leurs actes d’écritures ne peuvent-ils pas offrir quelques exemples de conduites ?
Entre le manque de sincérité et le terrorisme de « tout » dire, qu’est-ce qu’il peut y avoir sinon cette ligne mince et fugace tracée par ce jeu – chaque fois unique. En d’autres termes, une sorte d’éthique toujours à (re)faire entre deux postures. Une tension à l’œuvre (tant au niveau éthique qu’ontologique) [10] dans les multiples jeux de voilement et de dévoilement que soulèvent l’acte d’écriture – et dont l’étoffe aurait à nous apprendre.
Voilà, en trois temps, des éléments d’horizon qui ont retenu mon attention. Je remercie la Société des Écrivains de la Mauricie pour l’occasion de réflexion offerte.
***
Notes :
[*] Texte réalisé en vue d’une rencontre sur la transmission des valeurs, qui a eu lieu à Trois-Rivières le dimanche 22 janvier 2006 – à paraître dans Les Soirs rouges, la revue de la Société des Écrivains de la Mauricie. L’auteur met ce texte sous licence Creative Commons, selon les conditions by-nd-nc (Paternité – Pas de Modification – Pas d’Utilisation Commerciale).
[1] Andrée Fortin, De l’intellectuel désincarné et d’un Québec évanescent. Intellectuels et revues au Québec, 1995-2004, dans « Argument. Politique, société, histoire. », volume 8, numéro 1, automne 2005-hiver 2006, pages 23 à 37.
[2] Pour mieux saisir l’emploie du « enfin », concernant l’éclosion de la philosophie au Québec, je conseille vivement la lecture de Aux sources d’une philosophie vivante. Entretien avec Marc Chabot, dans la revue Combats, volume 7 (no. 1-2), pages 5 à 7. Cet entretien est accessible en ligne, au :
< http://www.combats.qc.ca/vol7no1-2/vol7no1et2.pdf >
[3] Gérald Allard, Pourquoi et comment la philosophie disparaîtra, dans « Argument. Politique, société, histoire. », volume 6, numéro 2, printemps-été 2004, pages 100 à 114.
[4] Je viens du domaine de la philosophie et j’espère qu’on ne m’en voudra pas trop si je l’évoque ici. Évidemment, les mauvaises langues pourront dire « on sait bien… ». Même s’il vaut parfois mieux ne pas répondre à ce genre de remarque, mentionnons tout de même qu’on pourrait prendre la chose par l’autre bout de la lorgnette. Pourquoi est-ce que me préoccupant d’éducation et de culture, il m’a semblé que la philosophie devait tenir une place essentielle, même si pour autant je ne conçois pas la philosophie comme une « régente de toute forme de pensée » ? La philosophie se caractérisant par un approfondissement méticuleux des questions, des possibles et des problématisations – que ce soit sur les visions du monde, les conceptions de l’être humain, notre rapport à un milieu de vie, etc., etc. – elle me semble particulièrement féconde et propice à un accompagnement plus individualisé sur les chemins de la réflexion – une démarche qui me semble essentielle sur la crête entre les problématiques mentionnées et ce qu’elles appellent. Bien sûr, lorsqu’il est question d’éducation tout comme de culture, Sisyphe n’en a pas fini de pousser sa pierre.
[5] Pour un exemple pertinent et bien articulé, on peut entre autres considérer l’entrevue qu’a accordée Georges Leroux à Indicatif présent le 21 octobre 2004, plus précisément lorsqu’il aborde le « rétrécissement de l’espace public » et la concentration des médias. Entrevue disponible en ligne au :
< http://www.radio-canada.ca/radio/indicatifpresent/chroniques/41141.shtml > (voir le lien audio au bas de la page).
[6] On peut, par exemple, facilement gérer des contenus en ligne avec des outils de publication Web comme un Content Management System (CMS), un Wiki ou encore un carnet Web (blog). Et par ailleurs, on peut rapidement suivre les mises à jour de nombreux sites grâce aux fils RSS. À cela s’ajoutent aussi de nouvelles possibilités de circulation de ce qui est créé, par exemple avec la déclinaison des licences de type Creative Commons, plus souples et adaptables. Au sujet des nouvelles possibilités de mobilité des créations, on peut aussi mentionner au passage le mouvement pour la culture libre, qui ne s’oppose ni à la reconnaissance de la paternité des œuvres, ni aux possibilités de rémunération – pour une vue d’ensemble de ce mouvement pour la culture libre, on peut écouter la chronique que Nicolas Langelier y a consacrée le 16 janvier 2006 à Indicatif présent. Entrevue disponible en ligne au :
< http://www.radio-canada.ca/radio/indicatifpresent/chroniques/68438.shtml > (voir le lien audio au bas de la page).
[7] Ce qui n’enlève pas les avantages d’un véritable travail d’éditeur, au sens classique du terme.
[8] J’ai bien dit transpire plutôt que dire, car il me semble en définitive que le style d’incarnation soit quelque chose de vivant – et qu’il s’appréhende indirectement.
Patrice Létourneau est enseignant en philosophie au Cégep de Trois-Rivières depuis 2005. Outre son enseignement, il a aussi été en charge de la coordination du Département de Philosophie pendant 8 ans, de juin 2009 à juin 2017. Il est par ailleurs l’auteur d’un essai sur la création, le sens et l’interprétation (Éditions Nota bene, 2005) ainsi que d’autres publications avec des éditeurs reconnus. Il collabore à PhiloTR depuis 2005.



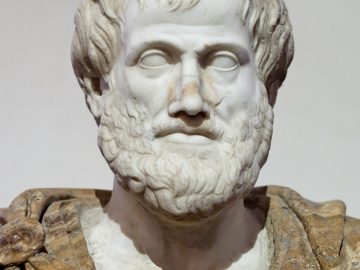

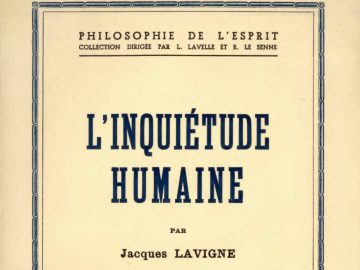

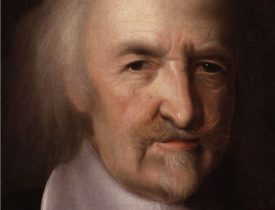







Comments
Comments are closed.