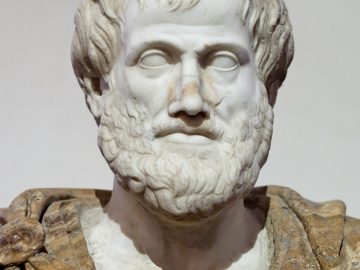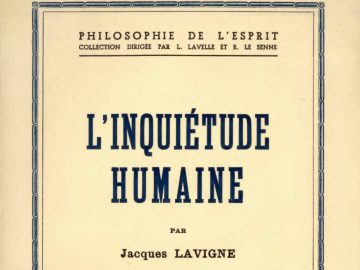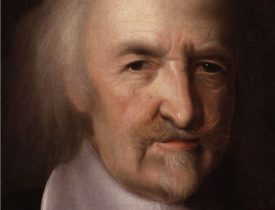Suite à un bref échange de courriels, monsieur Jacques Darriulat m’a généreusement accordé la permission de reproduire in extenso (environ vingt pages en version papier) son texte Michel-Ange et la théologie de la Sixtine dans PhiloTR.
Monsieur Jacques Darriulat est maître de conférences à Paris IV- Sorbonne.
On pourra retrouver d’autres textes du même auteur en visitant son site. Je ne saurais trop en recommander la visite. Il s’agit d’un espace intellectuellement riche. Indéniablement une des mines d’or du Web! On y retrouvera principalement des leçons prononcées au cours des douze dernières années devant des étudiants de Paris IV, et, pour certaines d’entre elles, devant les élèves de classe terminale ou de Lettres Supérieures du lycée Henri IV, à Paris. Leçons de philosophie générale et leçons de philosophie esthétique se partagent la part du lion.
Concernant le texte Michel-Ange et la théologie de la Sixtine, monsieur Darriulat veut montrer comment l’oeuvre du sublime Florentin, dans ce haut lieu du catholicisme, annonce les angoisses des Temps Modernes. Il nous propose ainsi un voyage dans l’univers théologique, philosophique et artistique d’une des plus glorieuses périodes de l’histoire de l’art. Je me permets de souligner en terminant comment ce texte fait bien ressortir le rôle de la philosophie néoplatonicienne dans l’oeuvre de Michel-Ange. Et ne serait-ce que pour cela, il s’agit d’un document vraiment intéressant.
Je vous laisse maintenant à votre plaisir!
Yves Bastarache
________________________________________________________________________
Michel-Ange et la théologie de la Sixtine
Conférence prononcée au lycée Henri IV le 14 mai 2001
Par Jacques Darriulat
La chapelle Sixtine n’est pas un lieu de culte tout à fait semblable aux autres : elle est Magna Capella Sacri Palatii, la Grande Chapelle du Sacré Palais, le centre liturgique de la chrétienté romaine, c’est-à-dire de la catholicité, et de nos jours encore seul le Pape peut célébrer la messe sur l’autel que surplombe, depuis le milieu du XVIe siècle, l’immense fresque de Michel-Ange représentant Le Jugement Dernier. L’extrême dignité sacerdotale du lieu le destinait en priorité à une organisation hautement symbolique, en laquelle rien n’était laissé au hasard, et qui devait résumer en sa totalité le message chrétien de la Rédemption, une sorte de compendium de la chrétienté, depuis la création du monde et le premier péché jusqu’à la fin du monde et la résurrection des morts.
C’est en effet dans cet esprit qu’elle a été conçue. Érigée, telle que nous la connaissons, sous le pontificat de Sixte IV, vers 1475 (d’où son nom de chapelle « Sixtine »), ses dimensions s’inspiraient des proportions en longueur, largeur et hauteur (3 x 2 x 1) de la description du Temple de Salomon dans le Livre des Rois, proportions en lesquelles l’interprétation allégorique croyait voir, ainsi que dans celles de l’Arche de Noé, une image matérielle de l’Église spirituelle. On comprend alors que la planimétrie de la chapelle est bien davantage que la délimitation d’un volume : elle enclôt une totalité, non seulement dans l’espace, mais bien davantage encore dans le temps, et dans ce microcosme de la Révélation, c’est toute l’histoire de la chute, du rachat et du salut qui doit se trouver contenue. De sorte que lorsque nous nous trouvons dans cette chapelle, nous nous trouvons au sein d’un système théologique symboliquement représenté, et qui nous donne la clé non seulement de l’ordre divin du monde créé, mais aussi de la destination de la créature, c’est-à-dire de l’histoire de la création, du premier péché, et de la Rédemption. Seule une interprétation théologique de la condition de l’homme permettait d’enfermer ainsi, dans un espace fini, c’est-à-dire dans un jeu de correspondances symboliques, l’infinité des espaces et des temps. Toute la conception de la Sixtine exprime cette volonté de totalisation, et ceci jusqu’au Jugement Dernier non compris, découvert la veille de la Toussaint 1541, qui pulvérisera par sa violence cette architectonique savamment organisée et ouvrira un abîme illimité qui marque la fin d’un monde et le commencement d’un autre monde, sans repère visible ni certitude théologique, celui des « temps modernes ». En 1528, un an après le sac de Rome par les Impériaux, dans un dialogue intitulé Le Cicéronien, Érasme, condamnant le pagano-christianisme de la première Renaissance, et l’admiration éperdue qu’avaient pour l’Antiquité les humanistes du Quattrocento, écrit : « De quelque côté que je me tourne, je vois que tout a changé, je suis dans un autre théâtre, je vois une autre scène ou plutôt un autre monde. Que faire? » . Il n’est pas difficile de trouver dans l’iconographie de la Sixtine une fastueuse représentation de cette rupture qui désoriente Érasme. Michel-Ange, unique auteur de la voûte comme de la grande façade orientale du Jugement Dernier, résume à lui seul ce changement de scène, et non seulement de décor. Et c’est là très exactement l’objet de cette conférence.
Comment rassembler la totalité des temps dans le volume clos de la chapelle? Toute l’organisation symbolique de la Sixtine est construite sur une périodisation théologique dont l’origine remonte, à ma connaissance, à saint Augustin. On la trouve particulièrement développée dans un recueil de questions doctrinales (De diversis questionibus), à la question 66, qui est en fait un commentaire de l’épître aux Romains de saint Paul, chapitres VII et VIII. Selon Augustin lisant Paul, on doit distinguer quatre états dans le devenir de l’humanité : avant la Loi ou ante legem, sous la Loi ou sub lege, sous la grâce ou sub gratia, et enfin dans la paix ou in pace. Avant la Loi, l’humanité est ensevelie dans le péché et obéit à la concupiscence sans même en prendre conscience : cette race perdue pour le Salut est anéantie dans les eaux du Déluge. Après la Loi de Moïse, l’humanité s’élève à la pensée du Mal par la transgression, la Loi n’ayant pas pour fonction de refouler le péché, mais plutôt de l’élever à la conscience de lui-même. Sous la grâce, le cœur de la créature incline de lui-même au bien, touché par les rayons de la grâce divine, la Loi, d’extérieure qu’elle était, devenant alors intérieure : cette ère nouvelle commence avec le sacrifice du Fils, et marque l’étape décisive dans l’accomplissement de la Providence, la créature étant alors capable, au prix il est vrai d’un combat moral, de participer elle-même au salut de son âme. Mais c’est seulement dans la paix, quand surviendra la fin des temps, le jour du Dernier Jugement et de la résurrection de la chair, dans la béatitude de la contemplation de la Sainte Face, que le corps redevenu glorieux obéira sans résistance à l’élan de l’Esprit, et que toute trace du premier péché sera abolie.
Ces quatre états ne sont pas sans relation avec les quatre sens que l’allégorisme médiéval attribuait à l’Écriture : si le sens littéral enregistre la réalité historique de l’événement, en revanche le sens symbolique se divise lui-même en trois modalités qui recoupent les trois grandes époques de l’histoire de la Révélation : le sens allégorique correspond à l’Ancien Testament, c’est-à-dire à l’état sub lege, sous la Loi mosaïque, quand l’annonce du Salut s’exprimait sous le voile de l’image prophétique ; le sens moral est celui du Nouveau Testament, sub gratia, Jésus donnant des préceptes clairement énoncés et parlant enfin sans énigme (la parabole évangélique n’est pas une allégorie, mais seulement une fable pour les simples, et qui rend mieux accessible le sens moral de son enseignement) ; enfin le sens anagogique annonce, dans les temps présents, c’est-à-dire sous le règne de la grâce, la Jérusalem céleste qui paraîtra dans toute sa splendeur quand l’écran du ciel se déchirera, au jour du Dernier Jour. On le voit, l’organisation de l’histoire de la Révélation en quatre états, tels que saint Augustin les définit, fonctionne comme un système herméneutique qui rend possible un nombre à peu près indéfini d’associations et d’analogies, et grâce auquel le temps de l’histoire humaine n’est plus un quasi infini qui vient de l’abîme et se perd dans l’abîme, mais une totalité close sur elle-même et saturée de correspondances. C’est ce schéma très général qui rend compte de ce qu’on peut, sans exagération, nommer la théologie de la Sixtine, à l’exception, il est vrai, du Jugement Dernier, qui vient d’un autre monde et annonce d’autres temps.
Bien avant que Jules II ne confie au jeune Michel-Ange (il a trente-trois ans) la décoration de la voûte, Sixte IV, dès la fin du Quattrocento, avait déjà entamé le programme iconographique de la chapelle pontificale. Il reposait surtout sur les deux ères les plus riches en associations symboliques, sub lege et sub gratia, l’Ancien et le Nouveau Testament, le premier préfigurant de manière allégorique ce que le second, après que le voile du Temple se fût déchiré à l’instant précis de la mort du Christ, rendait pour tous explicite. Sixte IV avait en effet convoqué à Rome, pour peindre la partie inférieure des deux longs murs de la chapelle, les grands maîtres florentins, Botticelli, Ghirlandajo, Cosimo Roselli, Piero di Cosimo, mais également Pérugin, Pinturrichio et Signorelli. Sur la paroi sud, ils avaient représenté les scènes de la vie de Moïse, et sur la paroi nord les scènes de la vie de Jésus, faisant ainsi se correspondre, terme à terme, les gestes accomplis par les deux grands fondateurs, le premier de l’ère de la Loi, le second de l’ère de la Grâce : c’est ainsi par exemple, que Moïse sauvé des eaux est associé à la Nativité, que la remise des Tables de la Loi sur le Sinaï fait face au sermon sur la montagne, et le testament et la mort de Moïse fait face à la Cène. On rassemblait ainsi les deux grands moments du Rachat, quand le peuple juif était le seul témoin de la majesté de Dieu, et quand l’humanité entière, touchée par la grâce, était appelée à faire son Salut. La continuité des temps, sous le règne de la Grâce, était encore soulignée par la continuité, sur le trône pontifical, des successeurs de Pierre : dans des niches peintes en trompe-l’œil, entre les fenêtres, dans la zone supérieure, on avait figuré les trente premiers papes, de saint Pierre à saint Marcel.
Vers le mois de mai 1506, le pape Jules II décide, contre l’opinion de Bramante, l’architecte de Saint-Pierre, qui soulignait auprès du Saint-Père combien Michel-Ange était inexpérimenté dans l’art de peindre (il avait pourtant réalisé un chef-d’œuvre, un panneau à la détrempe représentant la Sainte Famille et connu aujourd’hui sous le nom de « Tondo Doni », ainsi qu’un très célèbre carton pour une fresque qu’il n’avait jamais exécutée, représentant un épisode de la guerre de Florence contre Pise, La Bataille de Cascina), et tout particulièrement dans l’art de peindre à fresque (il avait pourtant fait son apprentissage, entre treize et quatorze ans, dans l’atelier de Ghirlandajo, du temps que celui-ci réalisait les grandes fresques florentines de Santa Maria Novella représentant les scènes de la vie de la Vierge et de la vie du Baptiste), de confier à Michel-Ange la décoration de la voûte de la Sixtine. Selon un « mémoire » contemporain, les travaux commencèrent le 10 mai 1508 et s’achevèrent, après une interruption de près d’une année, d’août 1510 à juin 1511, au mois d’octobre 1512. La voûte fut peinte en deux temps, car le grand échafaudage que Michel-Ange avait lui-même conçu ne permettait de travailler que sur une moitié de la surface. Il fallut donc le démonter puis le remonter, sans doute au mois de juin 1511. Michel-Ange commença par la zone qui se trouve au-dessus de la porte d’entrée, sur le mur occidental, et progressant travée par travée, acheva son œuvre au-dessus de l’autel, c’est-à-dire en rejoignant le mur oriental. Il voulut tout d’abord se faire aider par ses anciens compagnons, qu’il avait connus dans l’atelier de Ghirlandajo, mais, insatisfait, renvoya bientôt ses aides et résolut de venir seul à bout de cette colossale entreprise, ce qui est sans doute sans équivalent dans toute l’histoire des arts.
Les histoires de Moïse et les histoires de Jésus donnaient forme aux correspondances allégoriques qui faisaient s’accorder le règne de la Loi avec le règne de la Grâce. La voûte évoquera donc l’ère ante legem, d’avant la Loi et jusqu’au Déluge, qui manquait pour que soit achevé le cycle total de l’histoire du Salut, de la création du monde jusqu’aux temps présents : telle est la fonction des rectangles qui sont au centre et qui représentent ce qu’on nomme traditionnellement « les histoires de la Genèse ». Mais la voûte complète encore les fresques de la zone inférieure en comblant le vide qui séparait la vie de Moïse de la naissance de Jésus : l’attente du Sauveur, en ces temps où la Révélation ne se manifestait que sous le voile de l’allégorie, s’exprimait alors en images par l’inspiration prophétique. C’est en effet une chose remarquable qu’en ce haut lieu de la chrétienté catholique, la figure littérale du crucifié n’apparaisse jamais. Tout pourtant se rapporte à elle comme à un centre invisible, puisque tout exprime par allégories l’événement de la Rédemption. Il y a loin en effet de la réalité infamante de la croix, telle qu’elle paraît de façon saisissante sur la crucifixion à peu près contemporaine que Grünewald, disciple de Luther et admirateur de Thomas Müntzer, réalise aux alentours de 1515, à la théologie savante de la Sixtine, qui sublime l’instrument du supplice dans la forme allusive du symbole. Michel-Ange placera donc, de part et d’autre des scènes de la Genèse, pour signifier la longue attente du rachat, de la mort de Moïse à la nativité du Christ, les Devins ou les Voyants qui ont annoncé allégoriquement la venue du Sauveur : ce seront les prophètes de l’Ancien Testament pour le peuple d’Israël, et les Sibylles des antiques oracles pour les Gentils, c’est-à-dire pour le monde païen. Il faut ajouter à ce système symbolique la longue série des ancêtres du Christ, dans les triangles de la voûte et les lunettes qui encadrent la partie supérieure des fenêtres, humanité ensommeillée et mélancolique qui semble attendre que le souffle de l’Esprit ne l’éveille à la vie ; dans les pendentifs, grands triangles curvilignes et concaves aux quatre angles de la voûte, les quatre moments miraculeux qui firent, en des situations désespérées, le salut du peuple juif, et qui préfigurent sous le règne de la Loi le triomphe de l’Église romaine sous le règne de la grâce : Judith et Holopherne, David et Goliath, le Serpent d’airain et le supplice d’Aman, qui voulait exterminer les Juifs, et le triomphe d’Esther, qui voulait les sauver. Il faut ajouter enfin, à ce complexe jeu d’images, et je simplifie la composition en passant sous silence les putti porteurs d’écriteaux et les médaillons de bronze, de superbes éphèbes qui encadrent avec complaisance les scènes de la Genèse, supportant de lourdes guirlandes tressées de feuilles de chêne, allusion selon Vasari au règne heureux, qui fut un âge d’or pour les arts, de Jules II, de la maison della Rovere, c’est-à-dire du chêne. On les appelle les Ignudi, les « nus », dont la beauté païenne, dans ce temple de la chrétienté, peut choquer et a choqué les esprits, et cela dès leur création. Vasari rapporte qu’au court de son bref règne (1522-1523), le pape Adrien VI « avait déjà commencé à penser qu’on pourrait jeter bas la chapelle du divin Michel-Ange, en la déclarant une salle pleine de nudités, una stufa d’ignudi ». C’est sans doute à cette condamnation sans appel, et qui sera réitérée par la suite, qu’ils doivent ce nom d’Ignudi qui est resté le leur.
Si nous voulons comprendre le sens de cette étrange composition, et dont l’iconographie est sans équivalent, il nous faut évoquer, ne serait-ce qu’allusivement, le climat intellectuel dans lequel travaillait Michel-Ange. Quand le jeune apprenti quitta l’atelier de Ghirlandajo pour travailler la sculpture dans le jardin des Médicis, à San Marco, il devint rapidement familier de Laurent le Magnifique et, s’il faut en croire du moins une tradition qui s’apparente parfois à une pieuse légende, participa à la vie de la Cour et connut là le grand humaniste, érudit et poète, Ange Politien. C’est par Politien sans doute qu’il prit connaissance de la pensée néoplatonicienne qui dominait alors dans les cercles lettrés, depuis la fondation en 1462 de l’Académie platonicienne par Cosme l’Ancien, ancêtre des académies qui se multiplieront en Italie au XVIe siècle et en France au XVIIe, et qui tenait ses réunions dans la villa médicéenne de Careggi, aux environs de Florence. Il serait certes outré de faire de Michel-Ange un véritable humaniste et savant, mais on peut deviner ce qu’il doit aux deux plus grands esprits qui se retrouvaient à l’Académie platonicienne : Marsile Ficin et Pic de la Mirandole.
A l’image de la voûte de la Sixtine, unifiée par un système complexe de correspondances, l’univers, ou plutôt le cosmos de Ficin est gouverné par la ressemblance et la sympathie, chaque élément étant ainsi étroitement corrélé, par des forces occultes, à l’harmonie de l’ensemble. Pour ce grand admirateur de Platon, surtout celui du Banquet et du Phèdre, le monde visible est une image du monde intelligible, l’amour humain est comme l’ombre portée, dans le monde sensible, de l’amour divin, et la beauté de l’objet de l’amour comme le pressentiment de l’ineffable beauté divine. L’âme amoureuse, en proie au désir passionné de s’élever jusqu’au divin, passe par les quatre formes de délire dénombrées dans le Phèdre (244 b sq) : le délire amoureux selon la Vénus terrestre arrache l’âme à elle-même, c’est-à-dire à la part sensible d’elle-même, et lui apprend à mourir ; le délire poétique selon les Muses l’éveille à l’harmonie qui ordonne le cosmos ; le délire mystique selon Dionysos abstrait l’âme du sensible en lui découvrant, non la splendeur qui est en l’univers, mais le principe intelligible de son unité ; enfin le délire prophétique selon Apollon l’élève à la vision de l’unité, par l’intellect qui est le sommet de l’âme. C’est selon les degrés de cette échelle mystique, commentait Ficin, que saint Paul fut enlevé jusqu’au septième ciel. Ficin se pensait sincèrement chrétien, et ne soupçonnait pas qu’on puisse taxer d’hérésie ce curieux mélange de paganisme et de christianisme. Il était convaincu que les plus sages parmi les païens, et plus particulièrement Platon, avaient pressenti la révélation chrétienne, et qu’une seule et même idée de Dieu inspire toutes les philosophies et toutes les religions : il existe une harmonie secrète entre la sagesse juive (Moïse), la philosophie des païens grecs (Platon et Orphée), égyptiens (Hermès Trismégiste) ou perses (Zoroastre), et l’enseignement du Christ. C’est encore cette hypothétique unité de tout le savoir humain qui fonde, à la fin du Quattrocento, l’encyclopédisme de Pic, à la recherche du système commun qui ferait se correspondre toutes les sagesses, auxquelles s’ajoutaient encore la philosophie arabe et les interprétations de la Kabbale. Il est vrai que cette réconciliation du christianisme et du paganisme n’est pas propre à l’Académie platonicienne, mais qu’elle vaut pour toute la Renaissance, et cela depuis le XIVe siècle, c’est-à-dire depuis Pétrarque.
Mais l’enseignement de Ficin comme de Pic marque encore en un autre sens l’art de Michel-Ange. Pour Ficin, l’âme humaine, qui n’existe que dans sa liaison au corps, est le trait d’union entre le corps matériel et l’esprit divin, elle est vincula ou copula mundi : « L’âme humaine, écrit-il au livre III de la Théologie platonicienne, est le plus grand miracle de la nature […] si bien qu’on peut l’appeler justement le centre de la nature, le milieu de toute choses, l’enchaînement de l’univers, le visage de toutes choses, le nœud et le lien de l’univers. » Les anges habitent le règne du spirituel, comme les bêtes habitent le règne du matériel. L’homme seul s’élève à la frontière, et lui seul est susceptible de s’arracher à l’un pour s’élever à l’autre. La création est anthropocentrique, et l’homme, seul responsable du salut de son âme, est supérieur en dignité aux anges mêmes, qui sont déjà sauvés sans avoir à se sauver eux-mêmes. Dans un texte célèbre, souvent cité à propos de la voûte de la Sixtine, et plus particulièrement à propos de la scène de la création d’Adam, Pic imagine que le créateur s’adresse à sa créature : « Je ne t’ai fait ni céleste, ni terrestre, ni mortel ni immortel, afin que, souverain de toi-même, tu achèves ta propre forme librement, à la façon d’un peintre ou d’un sculpteur. Tu pourras dégénérer en formes inférieures, comme celles des bêtes, ou, régénéré, atteindre les formes supérieures, qui sont divines. »
On retrouve dans l’art de Michel-Ange les grands traits du platonisme de Ficin comme de Pic : la révélation chrétienne complète harmonieusement la méditation païenne, et ne s’oppose pas à elle. C’est ainsi que sur la voûte, à l’exception toutefois de Zacharie et de Jonas, qui commencent et terminent la série, les prophètes de l’Ancien Testament sont exactement corrélés aux Sibylles qui étaient, dans les sanctuaires païens, douées de divination : Joël avec la Sibylle de Delphes, Isaïe avec la Sibylle d’Érythrée, Ézéchiel avec la Sibylle de Cumes, Daniel avec la Sibylle de Perse, et enfin Jérémie avec la Sibylle de Libye. Cette association entre les Prophètes et les Sibylles pouvait se réclamer de l’autorité des Pères de l’Église, Lactance (Institutions divines, IVe siècle) et Augustin (Cité de Dieu), qui s’appuyaient eux-mêmes sur un texte ésotérique, que l’on croyait alors très ancien, les Oracles Sibyllins, en vérité composé à Alexandrie au IIe siècle de notre ère. L’association Prophètes – Sibylles était il est vrai dans l’esprit du temps, puisqu’un ouvrage d’un dominicain, Domenico Barbieri, avait associé, quelques années auparavant, douze Sibylles à douze Prophètes (les corrélations qui sont celles de la voûte recoupent par trois fois, mais transgressent par quatre fois, celles du dominicain). Par ailleurs, les Sibylles n’étaient pas inconnues de l’art renaissant, puisqu’on les voit par Pérugin au Cambio de Pérouse, ou par Pollaiuolo sur le tombeau de Sixte IV à Rome. Mais jamais on n’avait placé, avec autant d’audace, à égalité de taille et de dignité, la Révélation faite aux fils d’Israël avec la divination de l’ancien paganisme.
L’esprit païen souffle encore sur cette voûte par la beauté du corps humain, unique objet de cet art, et qui se montre parfois, et surtout dans les radieuses figures des Ignudi, dans une souveraine nudité. Les réminiscences antiques sont nombreuses, celles du Laocoon récemment découvert (en janvier 1506), aussi le Torse du Belvédère, les deux citations les plus fréquentes, mais on a reconnu encore la pose d’un Hercule portant un jeune Bacchus dans la figure d’un Ignudo, et dans un putto, la figure d’un amour associé à Psyché, un groupe conservé dans les collections des Médicis. Pour Michel-Ange comme pour Pic et Ficin, le corps humain est l’unique théâtre qui puisse représenter dignement l’histoire de la Rédemption. Il apparaît ici comme la seule expression plastique d’un mystère divin, à l’exclusion de tout autre décor (la nature est absente) ou de tout autre forme de vie (sauf quand elle intervient sur la scène biblique, comme dans le cas du serpent d’airain). Art anthropocentrique, qui interprète toute l’histoire de la Révélation comme un long débat entre le Créateur, le plus souvent invisible, et la créature humaine, c’est-à-dire l’esprit, ici représenté par le corps visible.
Zacharie ouvre la série des douze Voyants, c’est-à-dire des sept Prophètes et des cinq Sibylles. Il avait en effet prophétisé la venue d’un Roi, humble et chevauchant un âne, qui entrerait en triomphateur dans Jérusalem ; la clé allégorique n’avait pas manqué de reconnaître, dans cette figure du vainqueur, celle du Christ entrant à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Zacharie se trouvant au-dessus de la porte d’entrée de la chapelle, rappelle ainsi que le pape, chaque fois qu’il pénètre dans cette enceinte, y fait son entrée comme autrefois le Christ dans Jérusalem.
Puis de part et d’autre de l’ivresse de Noé, en laquelle on reconnaît, à la suite de saint Augustin, une figure de la Dérision du Christ (mais le patriarche, plantant la vigne du Seigneur, laisse entendre que cette humiliation sera féconde et non stérile), le prophète Joël, qui avait prophétisé une grande sécheresse qui anéantirait momentanément les récoltes d’Israël, et la Sibylle de Delphes qui, selon Lactance, avait prophétisé l’avènement d’un Sauveur « qui tomberait aux mains des Infidèles et serait couronné d’une couronne d’épines ».
Le second rectangle de la voûte, plus large que le premier, car dépourvu de l’encadrement des quatre Ignudi, s’ouvre sur la scène du Déluge. On remarque que la raison de cette suite, pour un spectateur qui entre dans la chapelle, du côté occidental, et se dirige vers l’autel qui se trouve à l’orient, est, dans le temps, régrédiente, et non progressive : l’ivresse de Noé, si l’on s’en tient au fil du récit biblique, devrait en effet succéder à, et non précéder l’événement du Déluge. Mais on comprendra peu à peu que toute la composition se propose d’accomplir l’œuvre de la Rédemption, puisqu’elle va du temps du péché, d’avant la Loi, c’est-à-dire quand la Loi n’était pas même présente pour éveiller le péché à la conscience de lui-même, jusqu’au premier instant de la Création, quand le mal n’avait pas encore fait son entrée dans le monde. La logique de la voûte est donc bien celle d’une Rédemption, et de la restauration du divin dans le spectacle de la création. Si l’histoire de l’humanité est celle d’une chute, alors, progresser, c’est la recommencer à rebours. En progressant vers l’autel, on s’approche du mystère divin. En inversant le sens de la lecture, la voûte substitue, au sens chronologique, un sens théologique. La progression théologique est une régression chronologique. C’est maintenant que le temps procède à l’envers ; sur la voûte, Michel-Ange le remet à l’endroit. Si nous suivons ici cet ordre régrédient, c’est non seulement parce qu’il gouverne tout le symbolisme de la voûte, mais aussi parce que c’est celui de Michel-Ange lui-même dans l’avancée de son travail.
Selon l’interprétation allégorique, le Déluge est une image du baptême, de même que l’Arche est une image de l’Église, c’est-à-dire du bois de la croix qui sauve. Ceux qui sont exclus de l’Arche figurent donc les hérétiques. Les commentateurs contemporains, Vasari puis Condivi, ont remarqué combien Michel-Ange avait manifesté de la pitié au sujet de cette humanité que le plan de la Providence condamne à la plus totale extermination.
Vient ensuite la scène du sacrifice de Noé qui devrait, si l’on respectait littéralement l’ordre de la régrédience, venir dans l’ordre de notre lecture, avant, et non après la scène du Déluge : Noé en effet fait un sacrifice à Yahvé pour lui rendre grâce de l’avoir sauvé des eaux mortelles. Il est vrai que l’interprétation de la scène est problématique, puisque Vasari comme Condivi voient dans ce compartiment la représentation du sacrifice de Caïn et d’Abel, non de Noé. Pourtant, comme on se plaît aujourd’hui à le souligner, si l’on se réfère au sens allégorique et non au sens littéral, il est naturel que le sacrifice de Noé, qui préfigure le sacrifice du Christ, précède allégoriquement le Déluge, qui préfigure le salut par le baptême. De part et d’autre de cette scène, le prophète Isaïe, qui serait ici le prophète de la Passion du Christ allégoriquement représentée par le sacrifice de Noé, semble incarner l’idée qui vient à l’esprit, et l’instant de l’inspiration. A l’inverse de Zacharie, savant vieillard plongé dans sa lecture, de Joël, dont la pose est plus animée mais qui lit, absorbé, un rouleau de parchemin, Isaïe délaisse le Livre pour n’écouter que l’esprit. Plus nous approcherons du Fiat lux, qui est comme le foyer originaire de l’énergie qui diffuse tout au long de la voûte, et plus les figures des Prophètes s’animent, soulevées par le vent de l’Esprit, tandis que les Sibylles au contraire vieillissent et, comprenant sans doute que leur temps est révolu, referment le Livre qu’elles lisaient depuis si longtemps (Sibylle de Libye). Associée à Isaïe, voici la Sibylle d’Érythrée : pour un poème acrostiche qui lui était attribué, et que rapporte Augustin au chapitre XVIII de la Cité de Dieu, texte célèbre au Moyen Age comme à la Renaissance, elle passait pour avoir prophétisé de façon saisissante le Jugement Dernier ; aussi était-elle nommément citée dans le Dies Iræ. Lactance l’associait encore à la prophétie de la dérision, de la mort et de la résurrection du Christ, ce qui rend compte également de son association avec la scène du sacrifice de Noé. Le souffle prophétique l’appelle à la vie de l’Esprit : au-dessus de sa tête, un ange allume la flamme d’une lampe.
Le grand rectangle suivant, dépourvu de l’encadrement des Ignudi, représente le premier péché et l’exclusion du paradis : le crucifié est encore allégoriquement présent dans cette scène, puisque le bois de la croix sera taillé dans l’arbre dont Adam cueille le fruit, afin que toute faute soit remise. On remarquera comment Michel-Ange a associé le diable tentateur et l’Ange qui refoule hors du paradis nos premiers parents : comme si, dès l’origine, la chute et sa Rédemption, le Démon et l’Ange, étaient indissolublement liées. Puis vient la création d’Eve, souvent interprétée comme une allégorie de la création de l’Église, qui préfigure la Vierge, qui est la nouvelle Eve. On remarquera que cette scène est la première où paraît la figure du Créateur, imposante, immobile et massive : nous sommes en effet exactement au milieu de la voûte, qui correspond au sol à l’ancien emplacement (il sera modifié au cours du XVIe siècle) de la grille qui séparait, pendant les offices, le clergé des laïcs. En deçà du premier péché, nous commençons donc d’entrer dans le saint des saints, Sancta Sanctorum, dans la proximité de Dieu. De part et d’autre de cette scène figurent Ézéchiel, qui avait prophétisé la naissance de la Vierge et l’édification d’un Temple purifié : figure fervente, qui entre dans un débat animé avec un ange qui semble lui indiquer la clé du mystère ; il laisse tomber le rouleau qu’il tient de la main gauche et n’est attentif qu’à la seule inspiration ; et la Sibylle de Cumes, vieille matrone alourdie par les ans, à laquelle on associait depuis le haut Moyen Age la quatrième églogue de Virgile, qui prophétise le règne de Saturne, un nouvel âge d’or, sous le signe d’une Vierge, et cela en un temps qui est contemporain de la venue du Fils de Dieu sur la terre des hommes. Entre l’ancienne et la nouvelle Eve, c’est donc à l’allégorie de l’Église que toute cette travée est consacrée.
Voici enfin la création d’Adam, vaste scène qui vaut pour elle-même, sans Ignudi, ni prophète ni Sibylle. Augustin interprète allégoriquement l’événement comme une image de la Pentecôte et de la vie inspirée par l’Esprit saint dans le corps de l’Église, le doigt du Créateur transmettant ici à sa magnifique créature le souffle de l’Esprit, qui le fait ébaucher le geste de se soulever de la terre. La beauté, sans doute plus païenne que chrétienne, du premier homme fait penser aux divinités fluviales de l’antiquité romaine, et semble pressentir les statues qui figureront les quatre heures du Jour sur les tombeaux des Médicis, à San Lorenzo (la même remarque a été faite à propos de certains des Ignudi). Quant au Créateur, il abandonne l’immobilité qui est la sienne dans la scène précédente et semble soulevé par l’élan inspiré du geste créateur.
Le rectangle suivant s’ouvre, selon Vasari, sur le troisième jour, lorsque Dieu sépare la terre et les eaux et qu’apparaissent les premiers continents. Le Créateur est maintenant un foyer d’énergie, le centre d’un tourbillon primordial duquel l’univers est issu. Son animation se transmet au prophète Daniel, qui lit fiévreusement et passe surtout de la lecture réceptive à l’écriture active, notant sur le pupitre qui se trouve à sa droite la pensée qui l’illumine un instant ; sa vivacité s’oppose à la vieillesse de la Sibylle de Perse, qui se détourne en profil perdu du mystère de la création qui est au centre et, myope, rapproche de ses yeux usés un texte qu’elle ne semble plus comprendre.
La création du soleil et de la lune ajoute au dynamisme de la « gestuelle créatrice » par cette double figure de l’Éternel vu deux fois, en champ et contre-champ, face et dos, sans doute pour montrer l’habileté du sculpteur (ce travail a été imposé à Michel-Ange, il n’a jamais voulu se dire peintre et signait ses lettres : Michelangelo scultore), capable de rendre la même image sous un double point de vue. Par ce dédoublement, la véhémence croissante du chef d’orchestre de la création du monde est encore accentuée.
Vient enfin la dernière des scènes de la Genèse, un dieu volant et indistinct, qui se confond avec les volutes, ou plutôt le tourbillon dont le cosmos est issu. Cette scène est encadrée par le prophète Jérémie, dont les prophéties annoncent un nouveau pacte d’alliance du Seigneur avec son peuple, figure du penseur, ou du mélancolique, abîmé dans sa méditation, en laquelle on a cru reconnaître un autoportrait de Michel-Ange (c’est en effet dans une pose semblable que Raphaël a représenté Michel-Ange, dans L’École d’Athènes, sous la figure d’Héraclite). Toutefois, Jérémie est le premier des Devins qui ne sonde que sa propre pensée, et s’affranchit du secours du texte écrit. Dans la proximité de l’origine des temps, le savoir discursif s’abolit dans l’intuition et l’immédiateté de la révélation, comme cela se fera plus évident encore dans la puissante évocation de Jonas. Face à Jérémie, la Sibylle de Libye ferme le grand livre des temps, non parce qu’elle s’affranchit de la dépendance envers l’écrit, mais parce que prend maintenant fin la divination païenne, tandis que seuls les prophètes du vrai Dieu approchent de l’ultime révélation.
Cette ultime révélation, elle est précisément superbement représentée avec Jonas — on devine le monstre marin sur la droite — qui fut enseveli trois jours et trois nuits dans le ventre du Léviathan comme le Fils de l’homme le sera dans le sein de la terre. Jonas ne consulte ni volume, ni rouleau, vêtu de façon plus humble que les autres, il est le seul parmi les prophètes qui lève les yeux vers l’Éternel, c’est-à-dire vers la scène primitive du Fiat lux. L’immédiateté de la vision mystique s’est substituée au lent travail d’interprétation de la lecture. Rejeté en arrière par la violence de la déflagration, il semble nier par son attitude la concavité de la voûte sur laquelle se dépose son image. C’est cette figure, qu’en connaisseur, Vasari jugeait la plus spectaculaire de tout l’ensemble : « Qui ne sera éperdu d’admiration devant la force terrible de Jonas dernière figure de la chapelle? Par la puissance de l’art, la voûte qui avance naturellement selon la courbe du mur est comme poussée par l’aspect de cette figure pliée en arrière, et semble plane ; c’est le triomphe de l’art ; dessin, ombre, lumière, elle semble vraiment s’enfoncer en arrière. »
C’est ainsi que tout l’ensemble de la composition forme comme une immense allégorie de l’âme qui s’éveille progressivement à la vie, et par l’enthousiasme, le furor divinus du délire platonicien, parvient par degré à la connaissance du divin. La peinture, plus que l’écriture que finissent par dédaigner les prophètes, est digne de dire cette Révélation. La longue série des ancêtres du Christ, selon le premier chapitre de l’évangile de Matthieu, montre une humanité mélancolique qui attend le rayon de la grâce, et les maternités qui y figurent donnent le sentiment d’une longue et lente gestation qui s’accomplit en secret dans la généalogie de l’humanité. Puis les Sibylles antiques frémissent au souffle prophétique, les Prophètes sont soulevés par l’enthousiasme du vrai dieu, et les Ignudi eux-mêmes, anges sans ailes et dont la beauté est toute païenne, croissent en taille tandis qu’on s’approche du Fiat de l’origine, et leurs attitudes sont de plus en plus véhémentes, comme s’ils participaient émotionnellement au mystère divin qui se joue au-dessus de leurs têtes. C’est la voûte tout entière qui est composée comme une ascension de l’âme vers son Créateur, et la vie éternelle qu’il insuffle à sa créature, à la façon d’un prisonnier platonicien, d’abord enseveli dans le sommeil de la matière et qui s’éveille progressivement à la vie de l’Esprit. En cet élan, l’âme créée est secourue par Dieu lui-même, comme le montrent aux quatre angles de la composition, dans les « pendentifs », les quatre miracles auxquels le peuple d’Israël, sous le règne de la Loi, a dû son Salut.
D’où vient l’idée de cette grandiose allégorie, allégorie elle-même composée des allégories qui préfigurent, dans l’état d’avant la Loi, ante legem, la Rédemption sous la grâce, sub gratia? On ne le sait pas. On a supposé, à l’origine de ce programme iconographique, une invention d’Égide de Viterbe, vicaire général des Augustiniens, influent théologien et bon connaisseur de Platon dans la première moitié du seizième siècle ; ou bien du franciscain Marco Vigerio, parent de Jules II et familier des doctrines platoniciennes ; ou bien encore le savonarolien Sante Pagnini, et l’on sait les sympathies de Michel-Ange pour le prieur de San Marco condamné au bûcher en 1498. Pourtant, aucun document ne vient étayer ces attributions, mais seulement des rapprochements toujours litigieux entre les textes et les images. Dans une lettre extraordinaire datée de 1523, Michel-Ange raconte à l’un de ses amis qu’au projet initialement prévu par le pape — peindre aux lunettes les douze apôtres et remplir le plafond d’ornements — l’artiste avait persuadé le souverain Pontife de substituer la composition que nous voyons aujourd’hui : « Alors il m’a fait une nouvelle commande en me disant de faire ce que je voulais, et qu’il m’approuverait, et que je pouvais peindre toute la voûte jusqu’aux scènes qui figurent en-dessous. » Il paraît invraisemblable que le pape ait abandonné à la seule fantaisie de l’artiste la décoration de ce haut lieu de la catholicité. Pourtant, les historiens n’ont jamais réussi à convaincre Michel-Ange de mensonge, et sont incapables d’identifier, encore aujourd’hui, avec certitude, le théologien qui serait à l’origine de cette étrange iconographie .
Les choses ont bien changé quand, près de trente ans plus tard, en 1534 (Michel-Ange avait commencé à travailler pour la voûte au cours de l’année 1506), le pape Clément VII souhaite faire peindre par l’artiste, sur la paroi du fond de la chapelle, un Jugement Dernier. Vasari nous apprend même que Clément avait prévu, non seulement sur la façade orientale, donc au-dessus de l’autel, un Jugement Dernier, mais encore sur la façade occidentale, donc du côté de la porte d’entrée, un Lucifer chassé du ciel, c’est-à-dire une chute des anges. Pourtant, le pape meurt à la fin de l’année et Michel-Ange, soulagé, se croit délivré de ce fardeau. Il se trompe : Paul III, le successeur de Clément VII, est encore plus déterminé à réaliser cette œuvre. L’échafaudage est monté au début de l’été 1536. Le travail durera cinq ans, et la fresque sera dévoilée pour la veille de la Toussaint 1541. Michel-Ange a alors soixante-six ans. Son élève Sebastiano, dit Sebastiano del Piombo, avait cru bien faire en préparant le grand mur (vingt mètres en hauteur, treize en largeur) pour qu’il soit peint à l’huile, ce qui permet de prendre son temps et autorise les repentirs, à l’inverse de la peinture à fresque qui exige, comme son nom l’indique, de déposer la peinture pendant que l’enduit est encore frais, de façon à ce que les pigments imprègnent le matériau, leur assurant ainsi une plus grand résistance. Sebastiano avait pensé que l’effort physique de la peinture à fresque outrepassait les forces de Michel-Ange vieillissant. Quand le maître l’apprend, selon le témoignage de Vasari, il fait jeter par terre le crépi, et fait recrépir le tout de façon à pouvoir y travailler à fresque, en lançant : « La peinture à l’huile est un art de femmes et de riches fainéants, comme frà Sebastiano ». Deux philosophies de la peinture s’opposent ici : celle de Léonard, patiente et savante, cosa mentale, vision d’un mage initié aux mystères, et celle de Michel-Ange, sculpteur plutôt que peintre, qui n’envisage l’avènement de la forme et la naissance de la beauté qu’à l’issue d’un combat héroïque de l’Esprit confronté à la résistance du matériau.
Entre 1508, date de l’achèvement de la voûte, et 1541, date de l’achèvement du Jugement, que s’est-il donc passé? L’âge d’or de l’époque de Jules II, que Vasari croyait voir représenté par la beauté des Ignudi porteurs de guirlandes tressées de feuilles de chêne, est bien révolu. La descente de la formidable armée française de Louis XII, puis de François 1er, au début du siècle, qui fit découvrir aux Italiens l’extrême brutalité de la guerre moderne, mais qui épargna Rome — qui fut l’occasion d’un défilé plutôt que d’une conquête — et surtout les terribles prise et sac de la Ville Éternelle par les armées impériales sous l’autorité du connétable de Bourbon en 1527, qui laisseront la ville épuisée, diminuée de la moitié de ses habitants, les palais saccagés, les reliques profanées par les luthériens, les lansquenets Suisses et Allemands, seront vécu en Italie comme un châtiment divin — les Réformés n’avaient-ils pas prédit, sur les planches de l’Apocalypse, la destruction de Rome à l’image de la destruction de Babylone, prophétisée par saint Jean? — et la fin d’un monde, c’est-à-dire la fin d’une ère où Rome était le centre du monde, où tous les chemins menaient à Rome. Guichardin, témoin profond et résigné de cet effondrement, assiste à ce renversement sans qu’il lui semble désormais possible d’invoquer, à la façon de son prédécesseur, correspondant et ami Machiavel, le modèle de la vertu antique, l’ancienne grandeur de la Rome républicaine, qui semble maintenant à jamais révolue.
C’est ce monde qui a perdu ses repères, emporté dans la violence, dans le tourbillon de l’Histoire, que représente Michel-Ange en évoquant le séisme du Dernier Jour. Le Jugement Dernier entre comme un ouragan dans la chapelle Sixtine, précipitant dans l’abîme le complexe système de relations allégoriques, où se réfléchissait l’harmonie du cosmos platonicien, que l’architecture de la voûte avait mis en place. Nous avons vu en effet combien la voûte était savamment articulée en compartiments distincts, et l’on a cru reconnaître, en cette succession dense de niches et de cadres, l’architectonique du tombeau de Jules II, chef-d’œuvre jamais achevé de Michel-Ange, auquel il aurait voulu se consacrer tout entier et dont Jules II l’avait détourné, contre son gré, pour qu’il se consacre à la Sixtine. Ce découpage est pulvérisé par le cataclysme du Jugement Dernier, et la marée humaine est emportée dans un mouvement giratoire que commande un Christ de Colère, et non de Charité, au sommet de l’orbite, dans un espace de nulle part, un ciel tourmenté où flottent des nuages. Au plan continu et cohérent de l’histoire de la Rédemption succède l’image angoissée d’une humanité emportée dans la tourmente. Pas de perspective : les corps semblent se mouvoir dans le vide, entraînés par un inexorable mouvement d’ellipse, qui est un cercle dépravé. La tradition du triptyque commandait une tripartition exacte qui permettait d’ordonner ce chaos : les élus s’élevant, accompagnés par les anges, sur le volet de gauche, le Christ de l’Apocalypse siégeant entre le glaive et le lys au sommet de l’arc-en-ciel au centre, et sur le volet de droite (celui qui se trouve à gauche du Christ), les damnés précipités dans la gueule du Léviathan. En rassemblant ces espaces distincts dans un fantastique maelström, Michel-Ange brouille tous les repères, réduisant la part de l’enfer à la zone du tiers inférieur droit, donnant souvent aux élus la face grimaçante et l’air épouvanté des damnés, communiquant même aux saints et aux bienheureux une insolite agitation, qui correspond certes à leur fonction d’intercesseurs — ils tentent de fléchir le châtiment divin — mais qui est parfois si véhémente qu’on est en droit de se demander si c’est bien le sort de l’humanité pécheresse qui les fait trembler, et non pas plutôt le leur. « L’humanité, même sauvée, commente Chastel, perd son assurance en présence de Dieu, dans l’événement prodigieux du Dernier Jour. » Quant aux anges porteurs des instruments de la Passion, figure traditionnelle des Arma Christi, tels qu’on les voyait si souvent, au siècle précédent, sur les images de dévotion ou sur les messes de saint Grégoire, sagement disposés à la façon d’un blason, ils sont ici emportés dans un vaste naufrage contre lequel il leur faut déployer toute leur énergie. Toute l’architecture doctrinale semble chanceler dans le séisme de l’Apocalypse.
Cette intrusion, cette effraction du Jugement Dernier dans la théologie de la chapelle, murs latéraux et voûte, est matériellement démontrable : pour exécuter son immense fresque, Michel-Ange dut détruire deux lunettes où il avait peint lui-même les ancêtres du Christ (parmi lesquels Abraham, Isaac et Jacob), l’image des premiers papes, à commencer par l’image du Christ lui-même, fondateur de l’Église, les deux fresques qui représentaient, dans la partie médiane, Moïse sauvé des eaux et la Nativité de Jésus, enfin le retable peint à fresque, au-dessus de l’autel, sur lequel Pérugin avait représenté l’Assomption de la Vierge. Michel-Ange avait une haute idée de la valeur de ces œuvres, et ce n’est pas sans hésitation qu’on prit la décision de suivre ce parti radical. Le Jugement Dernier n’achève nullement ce que la voûte avait commencé, il commence plutôt un autre monde en lequel le cosmos symbolique et allégorique du christianisme néoplatonicien n’a désormais plus cours. Il est vrai qu’on pourrait objecter que la scène du Jugement Dernier apparaît comme un complément, non comme une réfutation, du système théologique élaborée par l’iconographie précédente : en effet l’ère ante legem était représentée par la voûte, l’ère sub lege par la série des ancêtres du Christ et par les pendentifs représentant les miracles salvateurs du peuple d’Israël, et plus encore par les scènes de la vie de Moïse, enfin l’ère sub gratia par les scènes de la vie du Christ. Manquait la quatrième ère, in pace, qui commencera avec la résurrection de la chair et l’admission des bienheureux au sein du paradis. Or, c’est précisément ce que représente la fresque du mur oriental. Pourtant, on ne saurait ignorer que c’est là une curieuse façon d’évoquer un âge qu’Augustin disait devoir être celui de « la paix » : cet universel tumulte exprime sans doute la violence de l’Apocalypse, mais nullement la paix des âmes bienheureuses. C’est ainsi que l’Histoire sainte, dont l’interprétation théologique assurait la clôture et le sens, s’ouvre sur un abîme béant au sein duquel toutes certitudes semblent englouties.
Dans cet effondrement, seule demeure la dramaturgie du corps humain, unique théâtre qui soit digne aux yeux de Michel-Ange de représenter le mystère du Salut et de la Damnation. Quand il l’affirme, Vasari ne cherche pas seulement à esquiver, par des déclarations purement esthétiques, les querelles théologiques provoquées par la fresque de Michel-Ange, il souligne surtout un point essentiel dans la conception de l’œuvre : « Dans la pensée de cet homme extraordinaire, il ne s’est agi que de montrer la perfection et l’harmonie du corps humain dans la diversité de ses attitudes, et en outre les mouvements passionnels et ceux qui comblent l’âme, content de s’en tenir à ce registre — où il l’emporte sur tous les artistes — en montrant la route du grand style, du nu et la science du dessin. » Formidable mêlée des corps qui fait songer à une œuvre que Michel-Ange exécuta alors qu’il travaillait encore pour les Médicis, vers 1492 (il avait alors dix-sept ans), un bas-relief représentant une Bataille de centaures. La mêlée, sur cette sculpture extraordinaire, résulte moins de l’enchevêtrement des corps qu’elle ne semble la matrice de laquelle les corps procèdent, en un grouillement qui fait songer au travail d’une gestation. Les dessins préparatoires pour le Jugement Dernier évoquent un semblable essaim organique, le mystère d’une génération infinie et proliférante, plutôt que l’acte souverain d’un juge qui exclut, qui partage et ordonne.
Usant d’une perspective virtuose qui lui permet d’en varier l’attitude sans jamais se répéter, Michel-Ange impose ici une vision très anatomique et organique du corps de l’homme. A la beauté idéalisée des éphèbes de la voûte, il substitue des corps plus lourdement athlétiques, et n’hésite pas à dépraver la beauté, que ses sonnets platoniciens disaient toujours divine, dans les grimaces horribles des damnés — ce qui correspond, il est vrai, à l’iconographie traditionnelle de l’enfer — mais aussi par l’évocation curieusement morbide des phases de la résurrection. On sait que, selon saint Paul, la résurrection de la chair s’effectuera in ictu oculi, en un clin d’œil. Il n’en va pas de même ici. Michel-Ange se souvient des très remarquables fresques peintes par Signorelli (1499-1502) dans la chapelle Saint-Brice de la cathédrale d’Orvieto : les ressuscités y sont représentés à l’état de squelettes, avant d’être recouverts de la chair radieuse en laquelle se façonnera le corps glorieux. Michel-Ange prolonge et approfondit ici cette intuition, en représentant des morts qui s’éveillent terriblement à la vie, des vivants qui semblent encore morts, les étapes intermédiaires entre la mort et la vie, l’état d’un cadavre larvaire, cette chose qui n’a aucun nom en aucune langue. Condivi, le biographe de Michel-Ange (1553), l’avait bien remarqué quand il écrivait : « Certains, selon la prophétie d’Ézéchiel, n’ont rassemblé que leur squelette, d’autres l’ont à moitié vêtu de chair, d’autres enfin entièrement. Les uns nus, les autres vêtus des habits et des draps dans lesquels ils furent enveloppés quand on les porta dans la fosse, et cherchant à s’envelopper dans ces étoffes. Certains ne semblent pas encore bien éveillés et, regardant vers le ciel, restent comme incertains de l’endroit où la justice divine les appelle. » Le miracle de la résurrection prend alors l’aspect d’un phénomène physiologique, il se matérialise en inversant les étapes de la putréfaction. Processus anatomique, formation lente et difficile, le miracle de la résurrection perd évidemment de sa probabilité. Les contemporains l’ont bien ressenti : il y a quelque chose dans cette œuvre qui évoque l’audace d’une profanation.
L’Antiquité demeure présente dans le Jugement comme sur la voûte, mais ce n’est plus par les figures grandioses des Sibylles, qui participaient à l’accomplissement du mystère chrétien, mais par des figures grimaçantes qui évoquent des diables de carnaval : Charon qui, selon le texte du Dante, frappe à coups de rame les damnés qui se précipitent dans l’Achéron et sont poussés sur la rive où les attend Minos, juge d’enfer, un serpent enlacé autour de sa taille. Il y a peut-être plus d’humour que de terreur dans cette évocation des êtres diaboliques. C’est ainsi que nous savons que la figure de Minos est en fait le portrait d’un dignitaire de la cour pontificale, Biagio de Cesena, maître des cérémonies. Alors que le pape lui demandait son sentiment devant la fresque non encore achevée, Biagio aurait déclaré, s’il faut en croire Vasari, « qu’il était inconvenant d’avoir fait dans un lieu si noble tant de figures nues qui montrent même leurs parties honteuses. Ce n’était pas un ouvrage pour la chapelle du pape, mais pour des bains publics et des auberges (da stufe e d’osterie). Michel-Ange, ajoute Vasari, en fut fâché et pour se venger il représenta aussitôt ce personnage sous la figure de Minos en enfer avec un grand serpent autour des jambes au milieu des diables. » Condivi ajoute que Biagio se plaignit auprès du pape et demanda à ce qu’on qu’on supprimât ce détail, et que le Saint-Père lui répondit qu’il avait autorité sur le ciel, mais qu’il ne pouvait rien sur ce qui se passe en enfer. On ne trouvera pas de semblables détails, qu’on peut dire « réalistes » et profanes, sur la voûte, qui demeure majestueusement symbolique et ne condescend pas à l’allusion. En revanche, ils se multiplient sur le Jugement Dernier : on y reconnaît l’autoportrait certain de Michel-Ange lui-même sur la peau écorché de saint Barthélémy, le diable Charon aurait les traits du connétable de Bourbon, responsable du sac de Rome, et l’on reconnaîtrait Jules II en enfer, Vittoria Colonna au paradis, Dante, saint Barthélémy tenant la peau de Michel-Ange serait un portrait de l’Arétin, et on trouverait encore en enfer Paolo et Francesca, Martin Luther, Savonarole… Ce ne sont là que quelques-unes des attributions rapportée par la tradition, mais il est vrai que rien de bien solide ne les vérifie. Il n’est pourtant pas dépourvu de sens que ce soit à propos de cette fresque, et non pour la voûte, que se soit exprimé ce besoin d’attributions à des personnages historiques : en identifiant les hommes de ce monde sur le Jugement Dernier, on laisse entendre qu’il ne s’accomplit pas en l’autre monde, mais bien en ce monde, qui est peut-être le seul.
La fresque de Michel-Ange provoquera un retentissant scandale. L’abondance païenne de ces nudités choque l’Église qui se trouve alors à un tournant de son histoire (les premières assemblées du concile de Trente se tiendront à partir de 1545) et cherche une restauration dogmatique pour surmonter la crise de la Réforme. Si Michel-Ange exprime d’une façon grandiose l’incertitude qui sera désormais celle des temps modernes, il l’exprime toutefois en un langage en lequel l’Église ne pouvait pas se reconnaître. On soupçonnera une intention hérétique, Michel-Ange rencontrant alors Vittoria Colonna, marquise de Pescara, à l’église San Silvestro du Quirinal, qui était alors un peu la chapelle des intellectuels. Ce cercle spirituel se réclamait d’un espagnol, Juan de Valdès, proche d’Érasme, et cherchait une solution de conciliation avec les Réformés. Ce mouvement fut durement réprimé dès que fut accompli le tournant doctrinal de la Contre Réforme, et Michel-Ange compromis par cette fréquentation. Mais c’est surtout l’indécence des nus qui paraîtra, au sein de la chapelle pontificale, insupportablement outrageante. L’année de la mort de Michel-Ange, un fervent admirateur du maître, Daniel de Volterra, et son atelier de braghettone, ou poseurs de culottes, recouvrira les nudités les plus offensantes, et corrigera certaines positions dont on avait dénoncé l’obscénité. A quatre-vingt-cinq ans, vers 1560, Michel-Ange lui-même voulait habiller les nudités du Jugement Dernier, et il l’aurait fait lui-même s’il en avait eu la force. Dans une lettre adressée à Charles Borromée de septembre 1561 (trois ans avant sa mort), il déclare qu’il « voulait l’arranger, se faisant un cas de conscience de laisser après lui une pareille chose. » Sous le règne de Grégoire XIII (1572 – 1585), qui prit une part active à la Contre Réforme, on détruisit huit mètres carrés de la fresque pour surélever le sol dans la région de l’autel. Et sous celui de Clément VIII (1536 – 1605), on envisagea même une destruction totale de la chapelle, dont l’iconographie semblait alors parfaitement scandaleuse.
Nous avons oublié ces querelles. Mais nous n’oublierons pas de sitôt la fresque de Michel-Ange. A soixante ans passés, le maître sut radicalement renouveler sa manière et inventer une image qui exprime adéquatement les angoisses des temps modernes. Pourtant, ce ne pouvait être là le style que l’Église romaine cherchait à opposer aux violentes critiques des réformés. Dans une lettre célèbre, le poète l’Arétin reprochait à Michel-Ange de donner prise, par ses insolences, aux railleries des luthériens : « Le scandale dû à la licence artistique de Michel-Ange pourra faire intervenir les luthériens en raison du peu de décence de ces figures qui découvrent leurs parties honteuses dans les abîmes infernaux et dans le ciel » (à Enea Vico, janvier 1546). Ce style nouveau, que l’Église alors attend, un art de propagande qui saura enseigner par la séduction de l’extase plutôt que par l’effroi de l’infini, ce sera l’art qu’on dira plus tard « baroque ». Si la voûte semble à nos yeux pré-maniériste (la récente restauration a permis de redécouvrir les raffinements extrêmes du coloris : 1980-89 pour la voûte, 1989-94 pour le Jugement), le Jugement Dernier peut bien être dit pré-baroque. Mais c’est un baroque tourmenté et sauvage, que la rigueur doctrinale n’a pas su encore s’approprier ni soumettre à son seul service. Le Jugement Dernier de Michel-Ange est ainsi une œuvre intermédiaire, entre un cosmos platonico-chrétien et une doctrine renouvelée, à la lumière des critiques de la Réforme, du Salut et de la Grâce. Surgi en un temps d’incertitude, au sein d’une Église encore hésitante dans le choix de ses stratégies, il a su exprimer le désarroi d’une société et d’une civilisation exceptionnelles, qui se sont trouvées brutalement précipitées dans la violence de l’histoire. Et c’est sans doute grâce au tourment qui se réfléchit en lui qu’il paraît, aujourd’hui encore, si proche de nous, et toujours emblématique de notre modernité.
A l’issue de la conférence, un dialogue s’est établi entre l’assistance et le conférencier. On lira ci-dessous les questions posées et les réponses apportées.
Q — S’agissant de la voûte, le projet et ses modifications résultent-ils d’une discussion avec le commanditaire?
R — Vasari s’est plu à souligner l’indépendance de l’humeur mélancolique de Michel-Ange, qui ne se pliait pas volontiers aux exigences du pape Jules II ou à celles du duc Cosme 1er de Médicis. C’est ainsi qu’il nous raconte qu’au pape qui souhaitait constater de lui-même l’avancement des travaux sur la voûte de la chapelle, Michel-Ange répondit que Sa Sainteté n’avait qu’à grimper sur l’échafaudage dont il avait lui-même conçu le dispositif, sachant pertinemment qu’une telle escalade était tout à fait impossible au vieux pape perclus de rhumatismes. Et quelques années auparavant, le pape lui ayant refusé une audience, l’artiste irrité s’enfuit des États de l’Église pour se réfugier à Florence. Michel-Ange paraît ainsi le modèle de l’artiste indépendant qui n’obéit qu’à son génie et se rebelle contre le despotisme des Princes. Il convient pourtant de modérer : Vasari, qui veut promouvoir l’autorité de l’artiste souverain, est tenté de grossir le trait. Il reste qu’en ce qui concerne la voûte de la Sixtine, nous ne connaissons aucun programme théologique auquel le peintre aurait été contraint de se soumettre. On a cité, je l’ai dit plus haut, Égide de Viterbe ou Marco Vigerio, mais ce sont des hypothèses qu’aucun document ne vient étayer. En outre il y a cette lettre extraordinaire de 1532, en laquelle Michel-Ange assure que le pape lui a donné carte blanche pour la composition de la voûte. On ne peut donc se référer ici qu’aux néoplatoniciens, et à Ficin en premier lieu, que le jeune artiste à connus à Florence, du temps qu’il travaillait pour Le Magnifique. Rappelons toutefois qu’il n’a jamais suivi le cursus des études humanistes, qu’il ignorait le latin et que, placé en apprentissage dès l’âge de treize ans dans l’atelier de Ghirlandajo, il dut se former lui-même. Il semble donc peu vraisemblable qu’il ait conçu seul la très complexe composition de la voûte ; comme il est invraisemblable que le pape et la cour de Rome aient renoncé à exercer leur contrôle en un tel lieu. Pourtant, ce ne serait pas la première fois qu’avec Michel-Ange l’invraisemblable devient réel. Ajoutons que tout ceci vaut pour la voûte, et non pour Le Jugement dernier, dont nul ne conteste qu’il s’agit d’une libre création.
Q : Dans La création d’Adam, le Créateur est environné de créatures, et son bras gauche entoure une jeune fille : qui est-ce?
R : On a beaucoup spéculé sur cette énigmatique figure. Nous pouvons remarquer en premier lieu qu’il n’est pas du tout certain qu’il s’agisse d’une jeune fille. Ce trois-quarts bien dessiné ressemble étrangement à certains Ignudi, que l’on interprète comme des anges aptères : Dieu serait donc tout simplement entouré de ses anges qui précèdent, comme on sait, la création de l’homme. Il est vrai cependant que nombreux sont ceux qui ont cru voir une femme sous le bras gauche du Créateur. Les identifications sont alors très diverses, toujours intéressantes, mais jamais fondées : il s’agirait de Lilith, la première femme, selon la Kabbale, façonnée par Dieu et précédant Adam (on invoque alors les liens qui unissaient Pic au kabbalisme) ; ou bien il s’agirait de l’idée d’Eve encore virtuelle dans l’esprit divin, ou bien de celle de la Vierge, ou bien d’une allégorie de l’Église, ou bien encore une image de l’âme humaine, ou même, a-t-on imaginé, de la Béatrice de Dante… Ces gloses ne reposent sur aucun texte déterminant.
Q : La création d’Adam ne montre-t-elle pas, dans la mélancolie du premier homme, l’écart entre le moment matériel et le moment spirituel de la création?
R : Comme l’a montré Panofsky dans une célèbre analyse, l’iconographie de la Mélancolie, qui passe depuis Ficin pour l’état de l’âme géniale en proie à l’inspiration, est assez précise : il s’agit d’une figure assise, le menton appuyé sur la main, souvent sur le poing, et le coude appuyé sur le genou. Telle est la pose de Melancholia I de Dürer (1514), celle du Jérémie de la voûte de la Sixtine, ou bien encore celle de Laurent, il Pensieroso, méditant, dans la chapelle des Médicis, au-dessus de l’Aurore et du Crépuscule. Ce n’est nullement celle d’Adam. Dans La Création d’Adam, ce que nous croyons être de la mélancolie est plutôt l’inertie d’une créature matérielle à laquelle le souffle divin est insufflé par le contact de l’index, et qui se soulève lentement de terre. Adam n’est pas mélancolique : il s’arrache au sommeil de la matière et naît à l’Esprit.
Q : Que faut-il penser de l’interprétation d’Alain dans un de ses Propos (« Ecce homo »), qui voit dans la séparation entre les deux doigts la naissance d’une liberté responsable? N’est-ce pas l’anticipation de ce que montrera Le Jugement dernier, comme si l’autre espace trouait déjà la voûte?
R : On est en effet tenté d’interpréter cette scène comme une séparation, plutôt que comme une création : le Créateur semble abandonner sa créature sur ce rocher ingrat, il la condamne, dirions-nous aujourd’hui, à la liberté. On a souvent lu en ce sens, en effet, la célèbre fresque, et l’on se réfère alors au texte de Pic qui devait servir d’introduction aux neuf cents « conclusions », l’Oratio de hominis dignitate, Le Discours sur la dignité de l’homme. Il y a dans ce texte un passage fameux, en lequel Dieu s’adresse à sa créature, lui déclarant qu’elle est libre de faire elle-même son salut, qu’il lui appartient de se façonner elle-même, de s’élever plus haut que les anges, ou de tomber plus bas que les bêtes. Ce texte, de loin le plus cité de l’œuvre de Pic, a un accent moderne, et il y a presque un demi siècle, on croyait y voir une anticipation de la liberté sartrienne. Méfions-nous cependant de l’illusion rétrograde du vrai dont parlait Bergson, qui nous porte à déchiffrer le passé à la lumière du présent. Si l’on veut être fidèle à l’esprit de son auteur, le texte de Pic, profondément chrétien, n’a de sens que référé à une théologie de la grâce. Il en va sans doute de même pour Michel-Ange, qui ne saurait concevoir une volonté autonome, une existence qui ne serait plus inspirée par le souffle divin.
Q : Raphaël dans L’École d’Athènes a représenté Héraclite sous les traits de Michel-Ange. Évoque-t-il ainsi seulement la mélancolie de Michel-Ange? N’est-ce pas aussi l’évocation du devenir et de l’emportement qui entraîne toutes les figures du Jugement dernier?
R : C’est en 1510 que Raphaël termine la fresque de L’École d’Athènes. On a reconnu aussitôt, dans la figure d’Héraclite assis au premier plan,, un portrait de Michel-Ange, de même que dans celle de Platon, debout au centre en compagnie d’Aristote, un portrait de Léonard de Vinci. Comme l’a montré Panofsky en se référant à Ficin, mais aussi à Agrippa de Nettesheim, la mélancolie est alors perçue comme la folie surhumaine du génie créateur hanté par l’idée de l’œuvre à venir. Michel-Ange lui-même se prête à cette interprétation en insérant son autoportrait — présumé — dans la figure du prophète Jérémie en penseur mélancolique, figure exécutée vers 1511, donc contemporaine de la fresque de Raphaël. Cela dit, la mélancolie de Jérémie, qui se lamente sur les ruines de Jérusalem, n’a de signification que dans la composition générale de la voûte, dans le système de sa théologie, et non comme une prémonition du séisme du Jugement dernier, qui surviendra près de trente ans plus tard, et dont, comme j’ai tenté de l’expliquer, le chaos s’oppose en tous points à la composition savamment ordonnée qui le surplombe.
Q : Peut-on dire que Michel-Ange, en figurant la création divine, exalte la création artistique et, dans celle-ci, la sculpture, au point de peindre en sculpteur?
R : J’ai souvent pensé, mais c’est là un sentiment personnel sans valeur objective, que le Créateur, sur la fresque de La Création d’Adam, évoque le peintre posant la dernière touche sur ce magnifique nu antique qui joue ici le rôle d’Adam : il suffirait d’ajouter un pinceau au bout de l’index divin. Plus généralement, il est vrai que, pour les hommes de ce temps, l’artiste de génie reçoit de Dieu le don de communiquer à ses œuvres le souffle de vie. Pour Dürer, il ne s’agit pourtant que du simulacre de la vie, et tandis que Dieu enfante la beauté, l’artiste n’engendre que des monstres ou des chimères ; pour Michel-Ange, une authentique puissance créatrice possède l’artiste en proie à l’enthousiasme. C’est bien pourquoi, lui qui fut sculpteur, architecte, peintre et poète, se disait plus volontiers sculpteur — il signait ses lettres « Michelangelo scultore », mais jamais « pittore » — que peintre. C’est en effet en le façonnant dans la glaise, en le sculptant, que Dieu créa Adam. On a beaucoup reproché à Michel-Ange de peindre en sculpteur. Il faut plutôt dire que la sculpture est à ses yeux le prototype de toute création artistique. Il y eut à Florence, dans la première moitié du XVIe siècle, et même au-delà, une longue polémique, le paragone, sur la prééminence relative des deux arts, la peinture ou la sculpture. Pour Léonard, c’est la peinture qui est le premier des arts : una cosa mentale, un art tout intellectuel, art libéral et non mécanique, le tableau donnant chair au dessin qui délimite l’idée (il concetto), une image érudite et subtile, d’un extrême raffinement. Pour Michel-Ange au contraire, assez aristotélicien en ce sens, la sculpture est le premier des arts : seul le sculpteur réussit, au prix d’un travail titanesque, à arracher la forme du sein de la matière où repose sa puissance. Il prétend dans l’un de ses sonnets ne pas avoir sculpté La Nuit, mais l’avoir seulement dégagée du marbre où elle sommeillait depuis toujours. Pour lui, le véritable artiste n’est pas ce peintre savant qui tient son pinceau du bout des doigts, mais un travailleur de force, recouvert de la poussière et des éclats de la pierre, qui affronte passionnément la résistance du marbre (il avait pour ce matériau un véritable amour et choisissait lui-même ses blocs avec le plus grand soin). On peut dire qu’il peint de la même façon, et considère l’exécution de l’œuvre comme une sorte d’épreuve de force, se lançant à lui-même un défi dont il recule toujours les limites. C’est ainsi qu’il refuse la préparation de Sebastiano pour une peinture à l’huile, sur la paroi orientale du Jugement dernier, et choisit délibérément de peindre à fresque, ce qui exige une exécution beaucoup plus rapide et périlleuse. Sans doute lui fallait-il se mettre dans cette situation extrême pour se juger digne de transmettre le mouvement et la vie aux figures de son imagination. C’est pourquoi les colosses de la Sixtine, Sibylles, patriarches et prophètes, ressemblent à des sculptures : quelques-uns d’entre eux ont été réalisés avec une vitesse déconcertante, et tous semblent s’éveiller à la vie comme Isaïe, se détournant vers l’ange qui lui fait signe, s’éveille à l’Esprit.
Bibliographie
Augustin, « Question 66 », in De diversis questionibus LXXXIII ; Œuvres ; Mélanges doctrinaux, tome X, Paris, Desclée de Brouwer, 1952, p. 234-255.
Ficin, Marsile, Les Trois livres de la vie, Paris, Fayard, « Corpus », 2000.
Ficin, Marsile, Commentaire sur« Le Banquet » de Platon, présenté et traduit par Marcel Raymond, Paris, Les Belles Lettres, 1978.
Ficin, Marsile, Théologie platonicienne de l’immortalité de l’âme, trad. Marcel Raymond, Paris, Les Belles Lettres, tome I (livres I-VIII), 1964 ; tome II (livres IX-XIV), 1964, tome III (livres XV-XVIII), 1970.
Pic de la Mirandole, Jean, Œuvres philosophiques, trad. O. Boulnois et G. Tognon, préf. G. Tognon, suivis d’une étude sur « Humanisme et dignité de l’homme selon Pic de la Mirandole », par O. Boulnois, Paris, Presses universitaires de France, 1993.
Sur Michel-Ange, les sources sont :
Michel-Ange Buonarotti, Lettres, trad. Marie Dormoy, deux vol., F. Rieder, Paris, 1926.
Michel-Ange Buonarotti, Poèmes, trad (avec l’italien) par P. Leyris, Paris, éd. Mazarine, Imprimerie Nationale, 1983.
François de Hollande, De la peinture : dialogues avec Michel-Ange (1548), trad. S. Matarasso-Gervais, Aix-en-Provence, Alinea, 1984.
Condivi, Ascanio, Vie de Michel-Ange, (1553), prés. et trad. par B. Faguet, Paris, éditions Climats, 1997.
Vasari, Giorgio, « Vie de Michel-Ange Buonarroti » (1550 et 1568), in Les Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes, trad. sous la dir. d’A. Chastel, tome 9, Paris, Berger-Levrault, 1985, p. 169-340.
Travaux :
Baldini, Umberto, Michelangelo scultore, Milan, Rizzoli, 1973.
Camesasca, Ettore, Tout l’œuvre peint de Michel-Ange, introd. Ch. de Tolnay, Paris, Flammarion, 1967.
Chastel, André, « Le “scandale” du Jugement dernier (1545) », in Chronique de la peinture italienne à la Renaissance, 1280-1580, Fribourg, Office du livre, 1983, p. 188-207.
Chastel, André, « Les Ignudi de Michel-Ange », in Fables, formes, figures, Paris, Flammarion, « Idées et recherches », 1978, t. I, p. 273-292.
Chastel, André, Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique, Paris, Presses universitaires de France, 1982 [1959].
Chastel, André, Marsile Ficin et l’art, préf. de J.Wirth, Genève, Droz, 1996.
De Vecchi, Pier Luigi, Michel-Ange peintre, Paris, Cercle d’Art et Milan, Jaca Book, 1984.
Guazzoni, Valerio, Michel-Ange sculpteur, suivi des « Rime », texte de Enzo Noè Girardi, Paris, Cercle d’Art et Milan, Jaca Book, 1984.
Klibansky, Raymond, Panofsky, Erwin et Saxl, Fritz, Saturne et la mélancolie, Paris, Gallimard, 1989.
Nova, Alessandro, Michel-Ange architecte, Paris, Cercle d’Art et Milan, Jaca Book, 1984.
Panofsky, Erwin, « Le mouvement néoplatonicien à Florence et en Italie du nord » et « Le mouvement néoplatonicien et Michel-Ange », in Essais d’iconologie ; les thèmes humanistes dans l’art de la Renaissance, trad. Cl. et B. Teyssèdre, Paris, Gallimard, 1967, p 203-254 et p. 255-340.
Note
– Un texte célèbre semble confirmer la totale liberté que revendiquait Michel-Ange dans la composition de ses œuvres. Dans le troisième dialogue de De la peinture : dialogues avec Michel-Ange, que le jeune François de Hollande publie, après son séjour à Rome, en 1548, et dans lequel il prétend rapporter les conversations qu’eurent le peintre et Vittoria Colonna, marquise de Pescara, parmi d’autres savants et humanistes, dans l’église San Silvestro du Monte Cavallo, on lit ce discours attribué à Michel-Ange, en réponse à son interlocuteur qui s’interrogeait sur la licence des peintres dans la représentation des grotesques : « Je suis heureux de vous dire pourquoi on a coutume de peindre ce que l’on n’a jamais vu au monde, et combien de raison et de vérité se trouve en une si grande licence ; bien que certains, qui l’entendent mal, aient coutume de dire que le poète lyrique Horace écrivit les vers qui suivent pour stigmatiser les peintres : Pictoribus atque poetis/Quid libet audendi semper fuit æqua potestas/Scimus et hanc veniam petimusque damusque vicissim. Ces vers ne font pas injure aux peintres, ils les louent au contraire et les avantagent puisqu’ils disent que les peintres et les poètes peuvent tout oser, j’entends oser ce qui a leur préférence. » (trad. S. Matarasso-Gervais, Alinea, 1984, p. 67-68). Sur la fortune de cette citation d’Horace (Art poétique, 9-11), on lira l’étude d’André Chastel, « Le Dictum Horatii quidlibet audendi potestas et les artistes (XIIIe-XVIe siècle) », in Fables, Formes, Figures, Paris, Flammarion, 1978, I, p. 363-376.
Jacques Darriulat, Maître de conférence à l’Université Paris IV-Sorbonne