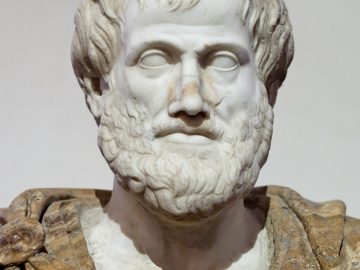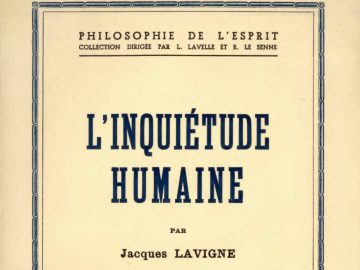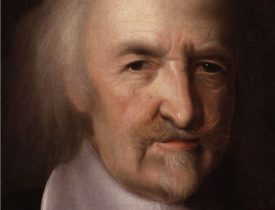Regardons-y d’un peu plus près.
Lorsque Sartre dit que «l’enfer, c’est les autres», il ne se place pas en premier lieu dans le domaine de la moralité : il le fait d’abord et avant tout en se plaçant au cœur de sa conception de la condition humaine. On se rappelle que pour Sartre, l’être humain est fondamentalement libre, au sens où il ne répondrait pas à une prédestination. D’où sa célèbre formule : «l’existence précède l’essence». En premier lieu nous existons, et c’est notre existence concrète qui déterminera notre essence, c’est-à-dire la définition de «qui nous sommes». Bien sûr, cette liberté fondamentale ne nie pas qu’il y ait un ensemble de contraintes qui puissent entrer en ligne de compte, d’où la facticité. Il faudrait donc savoir reconnaître le poids des contraintes, ne pas voiler notre facticité, sans se dérober à notre responsabilité quant à la définition de «qui» nous devenons. La liberté apparaîtra donc comme une manière de constamment et perpétuellement assumer ses possibilités de choisir, et par là même, elle apparaîtra comme une constante et perpétuelle (re)mise en définition de notre essence, de «qui» nous sommes. Face à cette liberté fondamentale, il faudra alors éviter ce que Sartre appelait la mauvaise foi, c’est-à-dire cette manière d’être où l’on perd de vue la responsabilité et le poids de nos propres choix, soit en refusant de choisir, soit en refusant d’assumer (ou de voir) la responsabilité de nos actes, soit en refusant de se montrer tel que l’on est. En d’autres termes, pour éviter la mauvaise foi, il faudrait être «authentique», ce qui n’est cependant pas si évident lorsqu’on tente d’examiner ça d’un point de vue pratique: par exemple, comment s’assurer qu’on ne donne pas trop peu de poids à notre passé, niant qui nous avons été, ou qu’au contraire on n’y donne pas trop de poids, s’engluant dans un passé qui nierait les possibilités de façonnement de notre identité. Quelle est la juste mesure, lorsqu’il n’y a justement pas de mesure a priori?On rencontre là l’un des paradoxes de cette authenticité : il faudrait être fidèle à soi-même, à qui l’on est, mais notre liberté fondamentale fait pourtant en sorte qu’on ne pourra jamais prétendre avoir une essence déjà-donnée ou déjà-fixée, puisque c’est notre manière d’exister qui redéfinira constamment et perpétuellement «qui» l’on est. Dès lors, à quoi faudrait-il être fidèle exactement, s’il n’y a pas un «modèle» prédéterminé auquel se conformer, si notre essence est constamment et perpétuellement en redéfinition? Cette situation paradoxale constitue en fait la racine du phénomène de la mauvaise foi, celle-ci venant de pair avec la liberté humaine, lui collant à la peau comme son ombre. Bref, la notion de mauvaise foi, chez Sartre, désigne précisément cette constante possibilité de s’engluer dans les facticités, ou au contraire d’y être aveugle, au cours de la constante esquisse de notre «identité»…
Dans cette mesure, les autres deviendront indispensables à la connaissance que nous pouvons avoir de nous-mêmes, en même temps qu’ils nous offriront des visions inévitablement tronquées, déformées ou déformantes de nous-mêmes. Comment ne pas sombrer dans la mauvaise foi si on ne tient jamais compte de l’interprétation que les autres peuvent avoir de nos actions. Mais à l’inverse, comment ne pas sombrer dans la mauvaise foi si on ne s’en remet qu’à l’interprétation des autres. Encore là, quel est le «juste milieu», quelle est la juste «mesure»? En fait, si nous n’avons pas d’essence (une définition de notre identité) avant notre existence, la difficulté à bien saisir «qui l’on est» se pose autant lorsque c’est nous qui portons un regard sur nous-mêmes que lorsque ce sont les autres qui le font. Cette condition humaine fait donc en sorte que les autres nous seront tout autant indispensables qu’aliénants, lorsque nous tenterons de nous définir et de nous comprendre; ce qui teintera l’ensemble des relations avec autrui, l’être humain oscillant alors sans cesse entre un pôle où il donne davantage de place à sa propre liberté dans sa tentative de se définir (empiétant dès lors sur d’autres libertés) et un pôle où il donne davantage de place à la liberté d’autrui (empiétant dès lors sur sa propre liberté dans la définition de son identité) [1].
On est alors mieux à même de comprendre pourquoi, selon Sartre, «l’enfer, c’est les autres» – ces «autres» qui sont tout autant indispensables à la perpétuelle définition de notre être qu’ils ne viennent contraindre cette redéfinition…
Et Le placard, dans tout ça
Venons-en enfin au film Le Placard. Une des clés du film est dans cette réplique : «ne changez surtout pas, vous verrez, c’est le regard des autres qui va changer». La trame du film est, dans ses grandes lignes, plutôt simple : un comptable (François Pignon) dans une usine de dérivés du caoutchouc, jusqu’alors perçu comme plutôt grisâtre et relativement anonyme, est menacé de devenir encore plus effacé : il sera sous peu touché par un licenciement. C’est alors que son nouveau voisin (Belone) lui suggère de laisser croire qu’il est homosexuel, afin de faire en sorte que l’employeur ne puisse pas supporter le regard que les autres pourraient porter sur ce licenciement, même si les motifs véritables n’ont rien à voir avec de la discrimination. Ne pouvant pas feindre d’être ce qu’il n’est pas, c’est alors que Belone suggère à Pignon de ne rien changer à ses comportements… Et effectivement, c’est d’abord les spectres interprétatifs des autres, de leurs regards, qui se modifient. En cela, on retrouve tout au cours du film une bonne illustration, sous diverses facettes, de ce jeu où «l’enfer, c’est les autres».
Mais, signe que la définition de soi ne se fait jamais en vase clos, Pignon a beau connaître la vérité sur ce qu’il n’est pas, la modification du regard des autres entraînera aussi une modification de Pignon. Aussi, il aura l’impression que ce n’est que depuis cet événement qu’il a «commencé à se comporter comme un homme», redéfinissant au passage ses rapports avec son fils, qui jusque-là le fuyait, et réévaluant lors d’un repas le regard qu’il portait sur son ancienne femme, dont il dira que, «perdu dans son obsession, [il] avait perdu de vue qui elle était» mais que là, «enfin [il] respire». Au final, le personnage de Pignon livre en quelque sorte une autre clé de ses rapports avec autrui, lorsqu’il dit que : «toute ma vie on m’a traité de chiant, maintenant vous me traitez de chieur, je vois ça comme une promotion.» Le personnage se situant alors à l’orée du pôle où il donne davantage de place à sa propre liberté, ce qui empiète dès lors inévitablement sur d’autres libertés dans la définition de son identité – pour reprendre les termes de la conception sartrienne des rapports avec autrui…
_______
[1] Voir notamment le chapitre sur «Les relations concrètes avec autrui», dans l’Être et le néant.
Patrice Létourneau est enseignant en philosophie au Cégep de Trois-Rivières depuis 2005. Outre son enseignement, il a aussi été en charge de la coordination du Département de Philosophie pendant 8 ans, de juin 2009 à juin 2017. Il est par ailleurs l’auteur d’un essai sur la création, le sens et l’interprétation (Éditions Nota bene, 2005) ainsi que d’autres publications avec des éditeurs reconnus. Il collabore à PhiloTR depuis 2005.