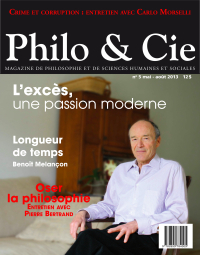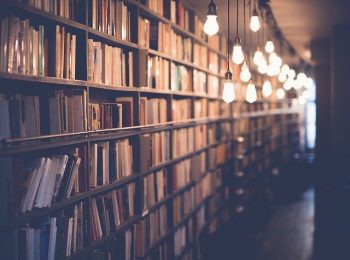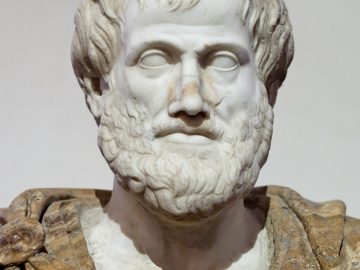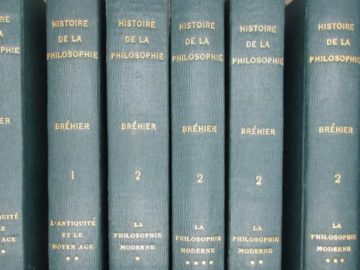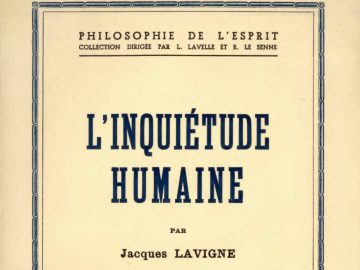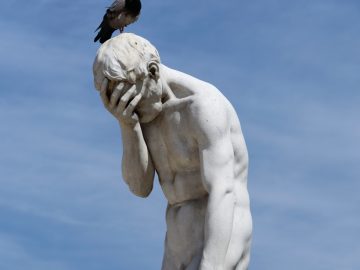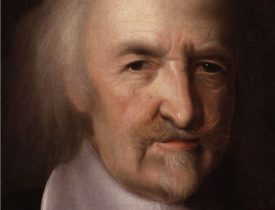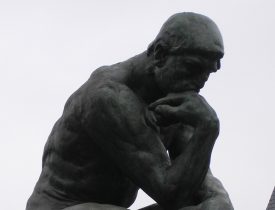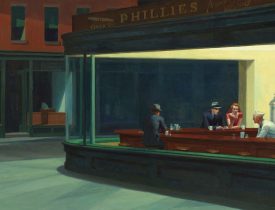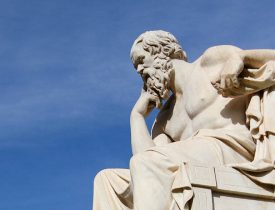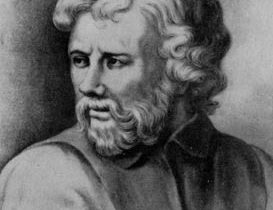Présentement à l`affiche, au Québec, dans plusieurs salles de cinéma, les cinéphiles et les intéressés peuvent visionner le drame biographique franco-allemand de la cinéaste allemande…
Le 5e numéro de Philo & Cie, qui est paru le 18 juin 2013, est consacré à la question de l’excès, considéré comme une passion…
[NDLR : l’article qui suit a d’abord été publié dans la revue « Philosopher. La revue de l’enseignement de la philosophie au Québec », Numéro…
Le 20 mai dernier, le directeur général du cégep, monsieur Raymond-Robert Tremblay, a assisté à plusieurs présentations de travaux de synthèse des finissants du programme…
[NDLR : article originaire de La Dépêche] Le 20 mai dernier, le directeur général du cégep, monsieur Raymond-Robert Tremblay, a assisté à plusieurs présentations de…
C`est vendredi, le 31 mai 2013 à 17h00 qu`a eu lieu au restaurant La Piazza dans le Vieux Trois-Rivières une rencontre pour souligner le départ…